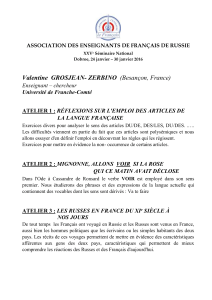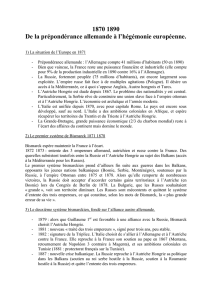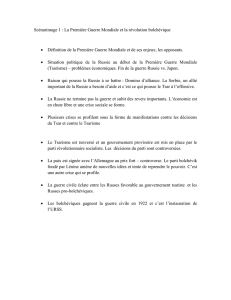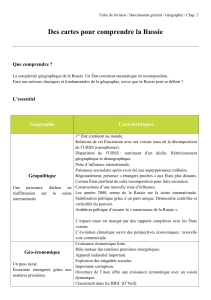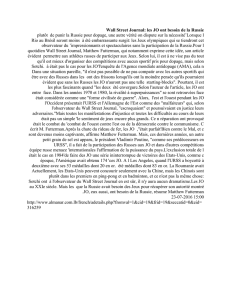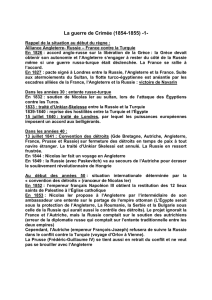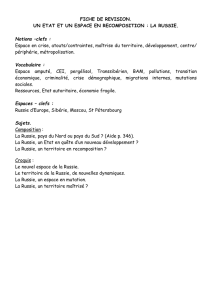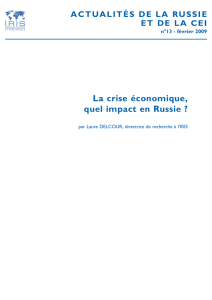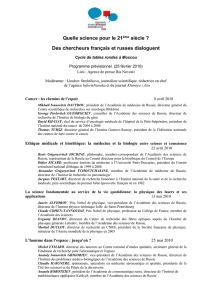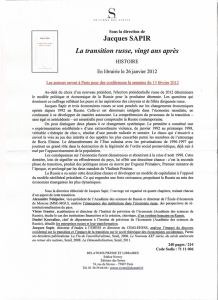La IIIe République jusqu`en 1914

La IIIe République jusqu’en 1914
6. Le concert des nations 1870-1914
Introduction
1. 1870-1890 : l’arbitrage bismarckien
1.1. Une chape de contraintes
Le poids de la défaite
Le système bismarckien
1.2. La recherche de l’identité
Dans les relations avec l’Allemagne
Dans les relations avec l’Angleterre
1.3. Les limites du magistère bismarckien
L’exemple italien
L’exemple russe
2. 1890-1914 : les rivalités nationales
2.1. Le nouvel ordre international
Des conditions nouvelles
Les divergences d’intérêts
2.2. Le bouleversement des alliances
La France et la Russie
La France et l’Angleterre
La France et l’Italie
2.3. La montée des tensions
L’opposition franco-allemande au Maroc
Les autres sources de conflit
Conclusion

La IIIe République jusqu’en 1914
6. Le concert des nations 1870-1914
« Pour comprendre les origines de la guerre de 1914, rechercher une
explication moniste, qui privilégierait un facteur parmi d’autres (cause
économique, cause politique, cause “sentimentale” ou “morale”, etc.),
revient à dissocier artificiellement un morceau de la réalité ; celle-ci se
présente comme un complexe, où se mêlent étroitement les conditions
politiques internes et externes, les transformations et les structures
économiques, les mentalités collectives, sans oublier le rôle des
hommes. Ce sont plutôt les mouvements de chacun de ces secteurs qu’il
convient d’analyser pour en dégager les convergences. »
Girault (René) -
Diplomatie européenne et impérialisme, 1871-1914, Paris, Masson, 1979,
p. 247.
Introduction
Au lendemain de Sedan, la France se retrouve à nouveau dans une situation diplomatique difficile. Vaincue par
la jeune et ambitieuse Prusse, soumise aux volontés de Bismarck, elle est au ban des nations.
Pourtant, elle n’est pas totalement à genoux. Sa puissance économique est réelle. Ses positions financières
sont intactes, le Second Empire lui a fourni de solides structures. Autre élément, non négligeable, son unité
nationale. L’idée d’appartenir à une même nation est fortement ancrée dans l’esprit des Français. Certes, ils ont
voté conservateur aux élections de février 1871, mais les volontaires n’ont pas manqué aux armées levées par
Gambetta pour assurer la défense du pays.
En fait, c’est la situation intérieure critique qui pousse le gouvernement provisoire à en finir le plus
vite possible avec l’occupation prussienne.
Deux périodes s’individualisent assez bien, ordonnées autour de l’exercice du pouvoir par Bismarck : la date
charnière est 1890.
1. 1870-1890 : l’arbitrage bismarckien
1.1. Une chape de contraintes
1.1.1. Le poids de la défaite
Elle est isolée. La tournée des capitales européennes que Thiers avait faite à l’automne 1870 l’avait convaincu
de la résignation nécessaire à laquelle la France devait se résoudre devant le peu d’empressement des autres
pays d’Europe à se joindre à elle contre la Prusse. Il fallait attendre, d’autant que les problèmes intérieurs
étaient prioritaires (règlement de la question de la Commune).
La France fit donc amende honorable et présenta un projet conservateur et modeste, se défendit d’être le pays
révolutionnaire que l’on redoutait, à l’image de ses ambassadeurs. C’est ce qu’on a appelé la « politique de
recueillement ».
Elle est l’obligée de la Prusse. Bismarck, en dépit de la victoire, redoutait la revanche de la France et souhaitait
pour cela une application stricte du traité de Francfort (10 mai 1871). Dans tous les cas, les clauses lui
permettaient de contenir la puissance française :

— Ou bien les Français payaient l’indemnité de guerre de cinq milliards dans les délais et ils étaient, de toute
façon, affaiblis.
— Ou bien ils ne payaient pas et l’occupation de la France par les troupes allemandes constituait un gage de
contrôle.
La France paya donc les 5 milliards. Un premier emprunt fut lancé le 20 juin 1871, car les deux premiers
milliards devaient être acquittés en mai 1872 et le solde dès mars 1874.
1.1.2. Le système bismarckien
Un fondement : la puissance allemande. En 1871, avec 41 millions d’habitants, l’Allemagne se trouvait au
second rang en Europe, derrière la Russie. L’essor démographique s’est accompagné d’un vigoureux
développement économique qui va d’ailleurs se parachever dans les années qui suivent le conflit avec la
France grâce en partie à l’indemnité exigée par le traité de Francfort1.
Les conditions de son hégémonie sont donc particulièrement bien réunies. Elle dispose d’une impressionnante
volonté de puissance, incarnée par le « chancelier de fer » qui bénéficie, en outre, d’une remarquable liberté de
manoeuvre, tant par la confiance que lui accorde son souverain, Guillaume 1er, que par l’organisation des
pouvoirs qui le libère de toute responsabilité devant le Reichstag.
Un moyen : le réseau d’alliances tissé par Bismarck
— Le système des trois empereurs. Bismarck réalisa « l’entente des trois empereurs ».
Des accords furent passés le 6 juin 1873 entre Guillaume 1er et Alexandre II, ce qui ne fut pas difficile à cause
des bonnes relations traditionnelles entre la Prusse et la Russie et le rôle économique joué par l’Allemagne
en Russie (elle est son principal fournisseur et les capitaux allemands se sont investis dans l’industrie
textile et métallurgique de Saint-Pétersbourg).
Quant à l’Autriche, elle avait abandonné toute ambition dominatrice sur les territoires allemands et préférait
consacrer ses ambitions à un rôle dans les Balkans. Bien qu’elle fût rivale de la Russie dans cette partie de
l’Europe, Alexandre avait peu à ce moment-là peu à attendre d’une république « révolutionnaire » (la
France) et préférait se rapprocher des monarchies.
— La Duplice. Au seuil des années 1880, Bismarck conclut avec l’Autriche la Duplice (7 octobre 1879).
— Le renouvellement du traité des trois empereurs. Bismarck réussit à joindre la Russie à la Duplice. Le tsar
Alexandre II avait été assassiné (13 mars 1881) et son successeur, Alexandre III ne voulait pas être isolé
contre l’Angleterre et ne souhaitait pas pactiser avec un régime républicain. Un nouveau traité des trois
empereurs est conclu (18 juin 1881).
— La Triplice. Le 20 mai 1882, l’Italie rejoint la Duplice et forme ainsi avec les deux pays allemands la Triplice
et ce, malgré la question des provinces irrédentes qui l’opposait à l’Autriche. L’entrée dans l’alliance austro-
prussienne de l’Italie pouvait paraître étonnante à cause du contentieux qui existait entre l’Autriche et l’Italie.
Mais Rome avait mal accepté la politique menée par la France en faveur du Pape après 1871 et sa
participation à la victoire de Mentana (3 novembre 1867). D’autre part, les deux pays étaient en concurrence en
Tunisie et les conflits qui opposaient dans le midi de la France les immigrés italiens à la population nationale ne
favorisaient guère un rapprochement. L’Italie avait besoin d’un allié puissant avec lequel elle commerçait
activement, même si la France détenait 80% de sa dette extérieure.
1.2. La recherche de l’identité
1.2.1. Dans les relations avec l’Allemagne
Les tensions (1873-1875). Bismarck n’avait pas obtenu tout ce qu’il désirait. Le système des trois empereurs
était caduc, à cause de la rivalité russo-autrichienne pour la défense des populations chrétiennes de l’empire
ottoman. D’autre part, la Russie ne désirait finalement pas voir une France totalement écartée des relations
internationales et affaiblie. Du coup, le relèvement de la France ne paraissait pas si inévitable.
— L’indemnité de guerre avait été honorée (en montrant d’ailleurs le crédit de la France auprès des banquiers

internationaux et donc, d’une certaine façon, sa puissance relative) et les troupes allemandes ne pouvaient plus
occuper le territoire français.
— En Allemagne, avec le Kulturkampf, Bismarck avait maille à partir avec les catholiques des États du sud qui
trouvèrent des soutiens en France, parmi les partisans de l’Ordre moral.
— Le vote d’une nouvelle loi militaire, en 1875, permit à la France de mieux encadrer son armée. Elle provoqua
la réaction du chancelier allemand. Le Post publia l’opinion de l’état-major prussien, favorable à une guerre
préventive contre la France, ce qui confirmait aussi à l’ambassadeur de France à Londres un collaborateur
proche de Bismarck. Les réserves de l’Angleterre, souhaitant que Bismarck « calme les inquiétudes de l’Europe
» et celles de la Russie qui ne souhaitait pas voir une Allemagne hégémonique en Europe (le tsar rencontra
personnellement Bismarck) provoquèrent le recul de Bismarck qui, selon l’opinion des historiens, ne semblait
pas vouloir aller jusqu’à la guerre.
La détente (1875-1887). Des raisons propres à l’évolution des deux pays et aux relations internationales
expliquent cette évolution :
— En France, la deuxième partie des années 1870 fut largement dominée par les problèmes intérieurs (lois
constitutionnelles, crise parlementaire et conquête de la République par les Républicains).
— La première crise balkanique (révolte engagée par les populations chrétiennes de l’empire ottoman),
l’émergence de la Serbie et la volonté du tsar d’en finir avec les Turcs préoccupaient l’opinion. L’intervention
heureuse de la Russie aboutit à la défaite du Sultan et à la signature du traité de San Stefano (3 mars 1878).
Mais il fut refusé par l’ensemble des grandes puissances, et surtout de l’Angleterre qui ne voulait pas voir une
Turquie asservie à la Russie et cette dernière occuper une position stratégique de premier ordre en
Méditerranée. Le déséquilibre engendré par cette crise provoqua un revirement de Bismarck à l’égard de la
France.
— Pour Bismarck en effet, les orientations étaient toujours simples : détourner la France de toute idée de
revanche et de reconquête des deux provinces perdues. Pour ce faire, il appuya sans réserve les ambitions
coloniales des Français, ce qui permettait de préserver l’équilibre européen sans remettre en cause la
domination allemande. La présence de Ferry aux affaires fut incontestablement une aubaine pour Bismarck. En
effet, toute idée de guerre contre l’Allemagne était à repousser pour le Français.
— Face au système d’alliances mis en place par Bismarck, particulièrement efficace, Ferry avait aussi besoin
d’un appui indirect du chancelier pour faire pression sur l’Italie (Tunisie) ou sur l’Angleterre (Extrême-Orient,
colonies). Il repoussa cependant d’aller jusqu’où Bismarck aurait souhaité le mener : conclure une alliance, qui
aurait eu pour effet d’isoler l’Angleterre mais surtout de la brouiller avec la France, sans compter les réactions
immédiates qui se seraient exprimées chez les patriotes français, alors actifs.
Au Congrès de Berlin (15 juin-15 juillet 1878), Bismarck déploya une activité diplomatique intense dans laquelle
il marqua, entre autres choses, sa volonté d’établir avec la France des relations plus cordiales. Il accepta et
favorisa même l’expansion coloniale de la France. Le contrôle de la Tunisie qui s’inscrit dans ce cadre, satisfit
une partie de l’opinion française mais provoqua la rupture entre les deux soeurs latines : l’Italie, humiliée, fut
contrainte — comme on l’a vu — de se rapprocher de la Duplice pour trouver une aide possible contre la
France et l’Angleterre (alors que c’est l’Allemagne qui avait tiré les ficelles...).
Autre élément fondamental de ce congrès : la mauvaise humeur des Russes, conscients de ne pas avoir tous
les moyens d’exploiter leur victoire militaire sur les Turcs et contraints de renoncer aux avantages
considérables que leur avait donné le traité de San Stefano. Leçon reçue pour un possible renversement des
alliances.
Nouvelles tensions (1887-1889). La France était en quelque sorte condamnée aux conquêtes coloniales avec
les avantages qu’elle avait tirés du Congrès de Berlin. Mais, sur le front intérieur, Ferry en subit les
conséquences : il fut mis en minorité et l’agitation nationaliste favorisa le développement du boulangisme.
Berlin s’inquiéta, malgré les déclarations d’apaisement exprimées par le ministère des Affaires étrangères et
l’ambassade de France à Berlin.
Bismarck voulut-il brusquer les choses en arrêtant Schnæbelé, attiré en territoire allemand pour être arrêté et

accusé d’espionnage ? La libération de Schnæbelé obtenue, la guerre fut évitée ; mais les nationalistes
s’étaient convaincus de l’action décisive de Boulanger et du recul de Bismarck. La démission du gouvernement
écarta Boulanger des affaires, mais l’agitation antiallemande resta forte. En fait, le chancelier allemand profita
du conflit pour obtenir de son Reichstag des crédits supplémentaires.
1.2.2. Dans les relations avec l’Angleterre
Elles sont très largement dépendantes de leurs rivalités coloniales.
L’Afrique. La concurrence qui opposait les deux pays s’inscrivait dans celle, plus générale, que se faisaient tous
les pays européens sur le continent au tournant des années 1880.
— L’Angleterre, qui s’était heurtée à la république boer du Transvaal, s’était installée en 1881 dans le bas Niger
et, en 1885, en Afrique orientale.
— La France avait pris pied à Obock (1882) et établi en 1885 son protectorat sur Madagascar.
— L’Italie créa la colonie d’Érythrée.
— L’Allemagne se lança aussi dans l’aventure. En 1884, sur la pression des milieux armateurs de Hambourg et
de Brême, elle établit son protectorat sur le sud-ouest africain. L’explorateur Nachtigal dirigea l’occupation du
Togo et du Cameroun. Elle crée aussi la colonie d’Afrique orientale qui, joignant le Congo belge à l’océan
Indien, interdit aux Britanniques la liaison Le Cap-Alexandrie.
— Les rivalités européennes se dégradèrent à propos du Congo. Le roi des Belges, Léopold II, fondateur et
président de l’Association internationale africaine, avait chargé le journaliste et explorateur Stanley de procéder
à l’exploration du moyen Congo. C’était, vers l’ouest, contrarier les intérêts des autres puissances.
La France, avec Savorgnan de Brazza, s’était lancée dans l’exploration de l’Ogooué.
Le Portugal et l’Angleterre, alliés, souhaitaient contrôler la côte du Cabinda à l’Angola et par conséquent,
prétendaient posséder des territoires de part et d’autre de l’embouchure du Congo.
L’Allemagne indirectement, souhaitait bénéficier de ces rivalités pour obtenir des territoires, quitte d’ailleurs à
conclure des accords avec la France (on comprend aussi un peu mieux l’aménité de Ferry à l’égard de
Bismarck).
Une conférence internationale était inévitable. Elle eut lieu à Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885
donnant en principe l’accès de toutes les grandes puissances au Congo. Autour du fleuve, se formait un « État
indépendant du Congo », international, qui revint en 1890 à la Belgique et dont la souveraineté fut attribuée à
Léopold.
L’Égypte. Depuis le percement du canal de Suez en 1869, l’Égypte était devenue le passage obligé pour se
rendre aux Indes : les navires britanniques assuraient 80% du trafic du canal. On comprend dès lors la volonté
des Anglais de mieux contrôler l’évolution intérieure de la vice- royauté d’Égypte. C’est ainsi que les relations
avec la France se dégradèrent.
En effet, la présence française ne s’était pas démentie depuis le début du siècle et les relations entretenues
avec les pachas d’Égypte étaient restées toujours été fécondes. Mais ces relations s’étaient envenimées à la fin
des années 1860 quand le khédive d’Égypte s’était engagé dans une politique de rénovation coûteuse,
entraînant une collaboration financière des puissances européennes.
Les Anglais eurent alors eu la politique la plus adroite : en 1875, incapable de faire face à une échéance de 100
millions de francs, le khédive vendit — avec l’accord du ministère français des Affaires étrangères dirigé par
Decazes — ses 177 000 actions de la Compagnie de Suez au gouvernement britannique alors qu’un
consortium français dirigé par la Société générale s’était proposé pour les racheter.
En 1878, la dette avait atteint 2,5 milliards de francs. La vente des actions n’avait pas permis d’apurer les
comptes. Français et Anglais imposèrent donc la création d’une « Caisse de la Dette publique » gérée par deux
commissaires européens, un « condominium » franco-britannique enlevant au khédive une partie de ses
pouvoirs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%