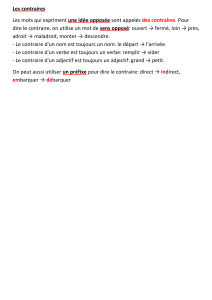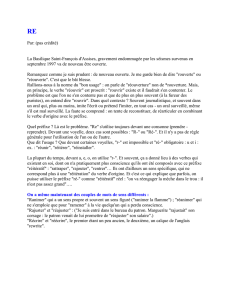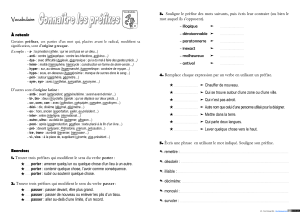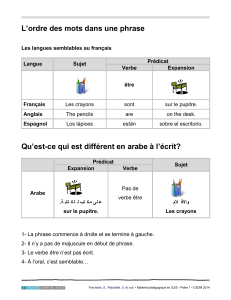Agay (Saint-Raphael) - 26 – 29 juin 2010
publicité

Ecole d’été organisée par SEDYL (Structure et Dynamique des Langues) en partenariat avec le LLACAN et le CRLAO – Agay - 26 – 29 juin 2010 Samedi 26 juin 9h-12h30 Dimanche 27 juin Lundi 28 juin Phrase complexe (coord. S. Vassilaki) Alexandru Mardale : Remarques comparatives sur le supin et l'infinitif en roumain Outi Duvallon : La particule finnoise –hAn : comment un pronom logophorique devient-il un connecteur de justification ? Deth Thach: kɑː : de l'intra- à l'interpropositionnel Denis Paillard : A propos de la phrase complexe avec coordonnant Mardi 29 juin Nominalisations (coord. S. Vassilaki) Préfixation (coord. Denis Paillard) Katharina Haude : Subordination en movima: référence à des événements et états Odile Lescure : Nominalisation et subordination dans une langue caribe des Guyanes Francesc Queixalos : La nominalisation en sikuani Hélène Le Guillou de Penanros La préfixation verbale en lituanien Denis Paillard : le verbe préfixé comme prédicat complexe Deth Thach (en collaboration avec D. PAILLARD) Contribution à l’étude sémantique et syntaxique du verbe en khmer. Déjeuner 12h30- 14h 14h-16h00 Phrase complexe (suite) première conférence 17h-19h : Anton Antonov (INALCO/CRLAO/SeDyL): Vers une typologie et une diachronie de l'allocutivité S. Gadjeva : l’article défini en bulgare Agnès Ouzounian : Le joncteur t'e en arménien : diachronie et synchronie Jean-Bosco Sima : le syntagme nominal bantou Sophie Vassilaki : Le joncteur pou du grec moderne : diachronie et synchronie Deth Thach et Dara Non : Deux verbes copulatifs en khmer Pause, puis diner à 19h 20h3021h45 Stéphane Robert (LLACAN) Jacqueline Vaissière (Sorbonne-Nouvelle) Guillaume Segerer Konstantin Pozdniakov (LLACAN) Les acquis de la phonétique française La linguistique cognitive : (théorie et méthodes expérimentales) Linguistique quantitative : un monde ouvertures et enjeux à découvrir Comité de programmation : Anaïd Donabédian, Sophie Vassilaki, Konstantin Pozdniakov, Anton Antonov, Denis Paillard, Christine Bonnot. Conférence Résumés : CONFERENCES : Jacqueline Vaissière (Laboratoire de Phonétique et de Phonologie) Une plateforme multisenseurs au service d’une modélisation intégrée en phonétique et phonologie (en parole normale et pathologique). Il est un fait établi que les tendances universelles dans les variations des sons dans le temps et dans l’espace ou les asymétries récurrentes au sein des systèmes sonores sont largement explicables par la combinaison d’un ensemble de facteurs physiologiques, articulatoires, acoustiques, aérodynamique et perception (PA3P) et par l’interaction entre les paramètres segmentaux et suprasegmentaux, qui exercent sur chaque système des influences contradictoires qui tendent à le désorganiser : l’état d’une langue résulte de l'interaction entre l’action centrifuge du système phonologique, tendant à la symétrie, et l’action centripète des facteurs phonétiques PA3P. Le laboratoire LPP a mis en place une plate-forme multisenseurs pour l’étude de la parole normale et pathologique, dont le but est de fournir des données pour alimenter des modèles d’interaction entre les paramètres et de participer à une modélisation intégrée en phonétique et phonologie. Elle permet d’étudier de façon non invasive en parallèle les mouvements de tous les organes de la parole (et donc les corrélats phonétiques de tous les traits phonologiques) et leurs conséquences acoustiques et aérodynamiques: 1) les mouvements de la langue (échographie, palatographies statique et dynamique), 2) les états de la glotte et les mouvements des plis vocaux (EGG, EPGG –brevet LPP), 3) les mouvements du voile du palais (mesures aérodynamiques avec un masque sans distorsion acoustiques – brevet LLP, système EVA d’Aix en-Provence, accéléromètre, micro nasal), 4) mouvements des lèvres et du visage (système Qualisys avec capteurs infrarouges et possibilité de 60 marqueurs). La plateforme a une extension à l’Hôpital Pompidou, pour des techniques plus invasives, nécessitant souvent la présence d’un médecin : fibroscopie, endoscopie avec tube avec caméra ultra-rapide, « nasographie » (appareil fait maison). Elle est complétée par un ensemble de systèmes de synthèse courant, et par le modèle articulatoire de Maeda, et par une station classique pour des études de perception. Une partie des instrumentations, semi-invasives, est localisée à l’hôpital européen George Pompidou. Le but de cette présentation est une introduction à la plate-forme, instrumentation après instrumentation. Des études sur des langues particulières de familles très diverses pourraient être menées et contribueraient à alimenter une base de données physiologiques originale pour l’étude typologique et les universaux. Nous rappellerons succinctement les apports de la phonétique française (théorie et méthodes expérimentales), entre la fondation de la phonétique expérimentale par l’Abbé Rousselot, à la fin du XIX° siècle à nos jours. Guillaume Segerer, Konstantin Pozdniakov (LLACAN-Inalco) Linguistique quantitative : un monde à découvrir Prenant comme point de départ notre article paru en 2007dans Linguistic Typology (Pozdniakov & Segerer : Similar Place Avoidance: A Statistical Universal, LT 11-2, pp. 307-348), nous proposons une exploration des techniques statistiques appliquées à la linguistique. A l'aide de nombreux exemples tirés de travaux récents, nous entendons montrer que l'application de techniques simples, lorsqu'elle est menée correctement, permet de faire des découvertes inattendues et des prévisions rigoureuses, aussi bien pour la description synchronique des systèmes que pour les études diachroniques. Anton Antonov (INALCO/CRLAO/SEDYL) Vers une typologie et une diachronie de l'allocutivité Je m’intéresse à l’allocutivité définie comme l’encodage morphologique de l’interlocuteur dans une forme verbale donnée alors même que ce dernier n’est pas un actant du verbe. Cette définition du terme est notamment celle que l’on utilise dans le cas du basque qui possède un éventail complet de formes « allocutives » qui encodent un interlocuteur de 2e personne du singulier (qui n'est pas un argument du verbe), en distinguant deux formes à chaque fois qui sont fonction du sexe de l’interlocuteur. Ce fait est d’autant plus intéressant que le basque est complètement dépourvu de la catégorie du genre par ailleurs, et qu’elle ne semble pas a priori reconstructible pour la proto-langue. Par ailleurs, en basque, l’utilisation d’une forme allocutive est obligatoire dès lors qu’on utilise le pronom dit « familier » de 2e personne du singulier, dont l’utilisation relève de contraintes sociolinguistiques différentes selon les dialectes, et qui n’est pas le pronom de 2e personne par défaut. Toujours est-il que du moment que ce pronom est utilisé, toutes les formes verbales dans le discours, à l’exception de celles apparaissant dans les subordonnées, les énoncés exclamatifs ou interrogatifs, présentent automatiquement ces formes allocutives qui tiennent compte du sexe de l’interlocuteur. Des formes morphologiquement semblables existent en bedja et en tchétchène, mais le phénomène ne semble pas présenter le même niveau de grammaticalisation. Par ailleurs, le datif dit "éthique" de nombre de langues indo-européennes pourrait être envisagé comme une des étapes dans le processus de grammaticalisation qui a donné naissance aux formes allocutives du basque. Dans cet exposé, je me propose de présenter les données, les hypothèses et les premiers résultats d'une étude en cours sur la typologie et la diachronie de ce phénomène ATELIER PHRASE COMPLEXE 9h00-9h45 Alexandru Mardale (INALCO & SeDyL FRE 3326) Remarques comparatives sur le supin et l'infinitif en roumain (présentation basée sur un article écrit avec Elena Soare, paru dans FdL n°30/2007, pp. 141-152) Notre contribution se propose d’examiner les propriétés d'une forme verbo-nominale du roumain, le supin, par comparaison avec l’infinitif nominalisé et d'autres formes verbo-nominales. Dans un premier temps, nous montrons quelles sont les différences entre les noms verbaux authentiques et le supin, et nous proposons une analyse morphologique de cette forme. Dans un deuxième temps, nous analysons les propriétés d’interprétation du supin et de l’infinitif nominalisés. Les deux nominalisations ne se prêtent pas aux deux types de lecture connus comme événementielle et résultative depuis Grimshaw (1991). Alors que l’infinitif admet les deux, le supin n’admet que la première. Cette différence sera mise en corrélation avec la structure aspectuelle de ces nominaux, à savoir avec l’existence d’un Aspect syntaxique (dans le cas des nominalisations infinitives) et avec l’existence d’un Aspect hérité du verbe-base (dans le cas des nominalisations supines). Enfin, nous arriverons à la conclusion que les structures analysées ici ne présentent pas le même degré de "perfection nominale", en raison d'une dérivation différente, d’une part, et de l’existence d’une structure fonctionnelle différente, d’autre part. 9h45-10h30 Outi Duvallon (INALCO & SeDyL FRE 3326) La particule finnoise –hAn : comment un pronom logophorique devient-il un connecteur de justification ? Mon exposé portera sur la particule énonciative finnoise –hAn (-han ~ -hän) qui est habituellement définie comme une marque de la connaissance partagée, glosable par « comme on le sait, il est bien connu que ». On considère qu’il s’agit là d’une valeur de base dont découlent des effets de sens divers qui varient en fonction du contexte. Certains emplois de –hAn sont tout de même problématiques du point de vue de la définition habituelle, du fait de la difficulté de les ramener à l’idée de la connaissance partagée. Qui plus est, une théorie récente sur l’origine de la particule (Laitinen 2002) retrace un processus de grammaticalisation où cette idée de la connaissance partagée n’est pas mise en avant. La particule –hAn est un élément qui ne participe pas au contenu propositionnel de l’énoncé, mais qui agit sur la façon dont l’énoncé se situe dans son contexte, sur la façon dont il est présenté par le locuteur, etc. L’idée que soulignent les études portant sur cet élément est celle de la dépendance contextuelle de l’énoncé qui l’abrite. Cependant, on dispose de relativement peu d’information d’ordre grammatical ou distributionnel sur les contextes d’emploi de -hAn. Je me suis alors donné comme objectif d’étudier l’organisation macro-syntaxique des unités qui se forment autour des énoncés comportant la particule. Cette approche est fondée sur l’hypothèse qu’il existe des régularités structurelles qui conditionnent l’emploi de -hAn. Je me propose dans cet exposé d’esquisser un aperçu sur la particule –hAn dans un examen qui l’abordera sous trois aspects différents : 1) la présentation de –hAn selon les grammaires, 2) deux théories sur son origine et 3) l’examen de ses emplois problématiques du point de vue la définition habituelle et l’élaboration d’une hypothèse nouvelle sur sa valeur. Pour terminer, je reviendrai sur l’idée de la connaissance partagée. 10h30-11h15 Joseph Deth Thach (INALCO & SeDyL FRE 3326) kɑː, de l'intra- à l'inter-propositionnel En khmer moderne, kɑː est défini comme une particule lorsqu’il est utilisé à l’intérieur d’une proposition et comme une conjonction de subordination lorsqu’il est placé entre deux propositions. Il est souvent rendu en anglais par ‘also, so, too, then, therefore’ (Headley: 1977) - en fait, dans beaucoup de ses emplois kɑː ne peut être traduit en français ou anglais. Parmi les valeurs qui lui sont associées on peut citer les valeurs de conséquence, consécution, concession, concomitance, contraste et adition. On notera qu’il est difficile de tracer une séparation nette entre emplois intra-propositionnels et emplois inter-propositionnels. Dans l’exposé, je montrerai qu’il est possible de rendre compte des valeurs locales telles que conséquence, consécution, concession etc. à partir d’une hypothèse sur l’identité sémantique de l’unité. Une telle hypothèse permet de rendre compte de la continuité qui existe tant au niveau sémantique que syntaxique entre emplois intra- et emplois inter-propositionnels. 11h15-12h00 Denis Paillard (LLF-Paris7) A propos de la phrase complexe coordonnée Le terme de coordination est généralement utilisé pour désigner des constructions « when there are to identifiable constituents which have the same semantic role and together form a larger constituent » ‘Haspelmath, 2005). Dans cette perspective on s’intéresse avant tout aux coordonnants comme et, and, … (conjonction), mais, but,..(coordination adversative) et ou, or, … (disjonction). En nous appuyant sur des données empruntées à différentes langues (russe, khmer ancien et moderne, japonais, haoussa,…) nous proposerons d’étendre la notion de coordination à d’autres types de constructions (intra- et inter-propositionnelles mais aussi discursives). La notion de ‘symétrie’ (souvent utilisée pour décrire la coordination : « si A est coordonné à B alors B est coordonné à A ») sera (re)définie comme le résultat d’une double mise en relation. 12h00-12h30 Discussion 14h00-14h45 Agnès Ouzounian et Anaïd Donabédian (INALCO & SeDyL FRE 3326) Le joncteur թէ, t‘ē, en arménien : diachronie et synchronie T‘ē présente en arménien une combinaison d’emplois typologiquement peu répandue et dont la description dépasse des dichotomies telles que subordination/coordination, discours direct/indirect. 1. T’ē est un introducteur de complétive, qui entre dans une série paradigmatique avec or ‘que’ [introducteur de complétive, de relative et de subordonnée finale], dont il couvre une partie des emplois et avec lequel la substitution n’est le plus souvent pas agrammaticale, même si elle est parfois discursivement peu convaincante. Il apparaît surtout dans les complétives logophoriques (contenu de parole ou de pensée). 2. Les emplois de t‘ē croisent ceux de la conjonction et‘ē ‘si’, mais plus rarement. 3. T‘ē peut introduire un contenu de parole ou de pensée dans d’autres contextes syntaxiques et avec tous les modes et modalisateurs, ce qui rapproche l’énoncé d’un discours direct. Il peut à ce titre introduire l’expansion d’un verbe comme d’un nom issu d’un verbe de type logophorique, mais il peut aussi lui-même fonder la logophoricité. 4. Un examen des emplois coordonnants de t‘ē à la lumière de ces emplois montre que la valeur logophorique de t‘ē y est préservée, ce qui constitue sa spécificité en arménien moderne par rapport à et‘ē (arm. cl.). De même, l’interrogatif composé de t‘ē, mit‘ē ‘est-ce que vraiment’, s’oppose à l’interrogatif artyok‘ ‘est-ce que’ en ce que le contenu propositionnel introduit par mit‘ē permet de supposer une instance énonciative sous-jacente (distincte du locuteur, d’où la valeur de mise en doute), ce que artyok‘ n’implique pas. Il semble utile a priori de distinguer t‘ē subordonnant et t‘ē coordonnant, qui apparaît, accentué, dans des structures à double focus (la corrélation peut mettre en focus parallèle une série de noms comme une série de subordonnées, avec une série de cas intermédiaires). Ainsi, malgré cette apparente distinction formelle (accentuation), t‘ē a donc une unité fonctionnelle dont il faut rendre compte. 14h45-15h30 Sophie Vassilaki (INALCO & SeDyL FRE 3326) Aspects diachroniques et synchroniques du joncteur pou (grec moderne) Dans cette communication, je me propose d’examiner certains aspects diachroniques et synchroniques du joncteur (subordonnant) invariable pou « que » (atone) du grec moderne qui alterne (non-librement) avec trois autres joncteurs dans la subordination complétive du grec moderne : oti, pos « que » (complétives assertives) et na « que » [ou infinitif : « je veux partir »] (complétives non-assertives). Comme il a été bien mis en évidence notamment par les travaux de Nicholas (1999, The story of pu : The grammaticalization in space in time of a Modern Greek complementiser), l’étude de pou ne peut être envisagée en dehors d’un cadre constitué de trois paramètres : contact de langues (aire de convergence balkanique), koinéisation des dialectes néohelléniques et effets de l’état diglossique. Pou est issu de l'adverbe relatif-indéfini de localisation (situation/position) ópou « partout où, où que, là où (on est) » (tonique) corrélativement lié à poú interrogatif (tonique) «où est-ce ?», selon le schéma suivant : ópou > opoú > pou. Pou sert par ailleurs de pronom relatif « universel » ( : qui, que, dont, lequel, duquel, auquel, avec/par lequel). Le relatif pou apparaît (sous forme de ópou / opoú) vers le Ve/VIe siècle de notre ère et marque un changement majeur dans le système de relativisation du grec : le passage d’un système flexionnel (accord avec l’antécédent) et mobile à base d’un paradigme de pronoms qu- (hos, hostis, hosper) à une forme invariable pouvant couvrir un vaste éventail de fonctions. Nous étudierons un corpus d’énoncés illustrant les différentes distributions (et collocations) de pou-joncteur et nous discuterons les différentes hypothèses émises sur le mode de construction de l’identité de ce marqueur qui, bien qu’introduisant des subordinnées à verbe fini, présente certains traits relevant de la subordonation à formes non-finies. Lundi 28 juin 2010 9h00-9h45 Katharina Haude (CNRS, SeDyL FRE 3326-CELIA) Subordination en movima: référence à des événements et états En movima (isolat, Amazonie bolivienne), les phrases subordonnées complétives et adverbiales sont des syntagmes nominaux, formant des arguments et adjoints, respectivement. Elles contiennent un article, et le prédicat est morphologiquement marqué, ce qui peut être interprété comme un indice de nominalisation. Pourtant, les phrases subordonnées sont marquées par des catégories qui sont normalement considérées comme des signes de finitude, relevant typiquement de la catégorie verbale : temps, personne, et aspect lexical. Aucune de ces catégories n’est marquée si systématiquement sur des prédicats matrices. Comment est-ce que l'on peut expliquer ce phénomène peu ordinaire? Le marquage de la personne est facile à comprendre : comme il est typologiquement courant, les phrases subordonnées sont obligatoirement possédées; c’est parce que le marquage de possession en movima est identique au marquage de la personne sur le verbe transitif qu’il ne sert pas comme preuve à l’existence d’une nominalisation. Les deux morphèmes « nominalisants » indiquent si le prédicat subordonné dénote un événement ou un état, ce qui n’est pas formellement différencié sur les prédicats matrices. Le temps est marqué sur l’article en movima, qui est obligatoire dans tout syntagme nominal (avec des mots simples il indique aussi des catégories spatiales). Comme les phrases subordonnées renvoient à des situations, qui ne sont pas temporellement stables, l’article permet une différentiation entre trois catégories temporelles. L’exposé va comparer les propriétés de base des phrases matrices et des phrases subordonnées en movima, en discutant les notions de nominalisation, de temps nominal, et de finitude. 9h45-10h30 Odile Renault-Lescure (IRD, SeDyL FRE 3326-CELIA) Nominalisation et subordination dans une langue caribe des Guyanes Le kali’na est une langue relativement bien connue grâce aux travaux de Hoff sur le Carib du Suriname (variété du kali’na parlée dans l’ouest du pays), concrétisés dans une première description phonologique et morphologique détaillée parue en 1968, suivie d’articles morphosyntaxiques. Ils ont été repris dans les analyses comparatives et diachroniques de Gildea (1998) sur la famille caribe. Ces auteurs reviennent dans des travaux récents sur certains aspects des phrases et constituants phrastiques nominalisés (Gildea 2008, Hoff 2009). Nous présenterons les phénomènes de nominalisation en kali’na, variété orientale parlée en Guyane française, en insistant sur les aspects moins décrits et en apportant quelques données originales rencontrées dans cette variété. Les principaux points abordés concerneront (1) les ajustements qui permettent à la langue de produire des constructions nominalisées et (2) la morphosyntaxe de ces formes non-finies qui occupent une fonction primordiale dans la subordination, mais aussi des fonctions de constructions finies, comme phrases indépendantes. Ces dernières constructions, jusqu’à présent non étudiées dans cette langue, et absentes du Carib décrit per Hoff, seront analysées et comparées aux formes finies des phrases indépendantes. 10h30-11h15 Francesc Queixalos (CNRS, SeDyL FRE 3326-CELIA) La nominalisation en sikuani Cet exposé s’inscrit dans la discussion en cours sur la relation, en particulier diachronique, entre subordination et nominalisation. Le sikuani a quelques traits remarquables à soumettre à ce débat : aucun morphème ne s’est spécialisé dans la nominalisation ; le mécanisme est hautement régulier et productif ; les actants sont récupérés selon des règles d’une certaine complexité, et de façon hybride (morphologie nominale / verbale) ; enfin, toutes les positions syntaxiques des compléments (actants, adjoints du prédicat verbal, modificateurs dans le syntagme nominal) sont accessibles aux formes nominalisées, bien que certaines de ces positions puissent également accueillir de vraies subordonnées à verbe fini. 11h15-12h30 Discussion, conclusions et perspectives ATELIER PREFIXATION Trois exposés de 50 minutes et 30 minutes de discussion(s) Hélène LE GUILLOU DE PENANROS La préfixation verbale en lituanien: un système complexe mobilisant plusieurs plans de variation En lituanien, l'adjonction d'un préfixe à une base verbale est source de déterminations de la base verbale réparties sur 4 domaines: 1. L'aspect: l'adjonction d'un préfixe à une base verbale d'aspect processus donne dans certains cas un verbe de même sens mais d'aspect événement: kepti (cuirepro) / iškepti (cuireévé) pirkti (acheterpro)/ nupirkti (acheterévé) skaityti (lirepro) / perskaityti (lireévé) 2. Les déterminations quantitatives ou qualitatives du procès: laukti (attendre) / išlaukti (attendre tout un certain temps) skinti (cueillir) / priskinti (cueillir beaucoup) pinti (tresser) / papinti (tresser un peu) 3. Les phases du procès: le préfixe peut avoir une valeur inchoative, résultative, terminative: kalbėti (parler) / prakalbėti (commencer à parler) linguoti (bercer) / užlinguoti (réussir à endormir en berçant) judėti (bouger) / pajudėti (se mettre à bouger) 4. Les nouveaux lexèmes: le verbe préfixé à un sens très différent de celui auquel correspond la base verbale. Sa distribution peut également être très différente. aiškinti (expliquer) / išaiškinti (dépister) dėti (poser) / padėti (aider) galėti (pouvoir) / nugalėti (vaincre) Le système est complexe dans la mesure où il y a douze préfixes en lituanien et que : 1. tous les préfixes n'ont pas les mêmes valeurs (si la plupart des préfixes sont représentés dans les 4 domaines cités ci-dessus, ils n'ont par exemple pas tous de valeur inchoative) 2. un même préverbe n'a pas la même valeur avec toutes les bases verbales avec lesquelles il se combine (on leur reconnaît entre 3 et 16 valeurs selon les préfixes). Le traitement traditionnel de la préfixation en lituanien consiste à définir chaque préfixe en établissant un classement ordonné des différentes valeurs qu'il peut avoir selon la base verbale avec laquelle il se combine. Paulauskas (1957) opère une distinction entre valeurs lexicales et valeurs grammaticales du préfixe. Les valeurs lexicales sont elles-mêmes réparties en valeurs fondamentales (spatiales), valeurs dérivées et valeurs exceptionnelles. Cette présentation morcelée des fonctions du préfixe, outre les différents problèmes qu'elle pose (détermination du nombre de valeurs, primauté du spatial sur le notionnel, désémantisation du préfixe dans les cas des valeurs grammaticales), néglige l'identité du préfixe. Nous proposons un modèle alternatif de description de la préfixation dans la mesure où il traite de façon unifiée les différentes valeurs du préfixe. Ce modèle pose qu'un verbe préfixé est un prédicat complexe, issu de la combinatoire entre les prédicats que sont le verbe et le préfixe. On considère en effet que le préfixe est une forme de prédicat : plus précisément c’est un relateur de type X R Y. Par ailleurs, on définit l'identité sémantique de chaque prédicat par une Forme Schématique qui permet d’articuler directement cette identité à sa variation. Enfin on distingue plusieurs plans de variation mettant en jeu la syntaxe du verbe préfixé d’une part, les différentes combinatoires entre les schémas prédicatifs associés au verbe et au préfixe d’autre part, les différents modes de lexicalisation des composantes de la relation établie par le préfixe (X et Y). On montrera, à travers l'exemple du préfixe iš-, comment un tel calcul se met en œuvre et rend compte des valeurs observées. Denis PAILLARD. La préfixation en russe : le verbe préfixé comme prédicat complexe. Nous défendrons l’hypothèse qu’en russe et en français un verbe préfixé est un prédicat complexe, produit de la combinatoire entre la base et le préfixe, considéré comme un prédicat à deux places. Dans le cadre de cette combinatoire, un élément a de la base est reconstruit dans l’espace du préfixe. Concernant le russe, nous montrerons que la dérivation d’un verbe perfectif par préfixation d’une base (le plus souvent imperfective) n’est pas un phénomène d’ordre aspectuel, contrairement à l’usage qui en est fait très souvent dans la littérature consacrée à l’aspect. Deth THACH (en collaboration avec D. PAILLARD) Contribution à l’étude sémantique et syntaxique du verbe en khmer. À propos de trois préfixes : / b+ nasale/, /pʰ-/, et /pr-/ Les préfixes / b+ nasale/, /pʰ-/, et /pr-/ ont toujours été traités par les grammairiens et les linguistes spécialistes du khmer comme des allomorphes servant à former, à partir d’une base verbale monosyllabique, des causatifs (voir Jenner (1969) et Lewitz (1967, 1968 et 1969)). Or force est de constater qu’il existe des bases verbales en khmer à partir desquelles il est possible de former deux, voire trois verbes préfixés différents. L’objectif du présent exposé est de cerner d’une part l’apport sémantique de chacun des trois préfixes à la base verbale, et d’autre part, les changements syntaxiques entre les verbes préfixés et les bases verbales. Nous défendons l’hypothèse que ces trois préfixes ont une propriété commune à savoir l’agentivation du procès exprimé par la base. Mais selon les préfixes en jeu, le statut de l’agent n’est pas le même : - avec / b+ nasale/ : l’agent est le valideur du procès exprimé par la base : le verbe préfixé est du type accomplissement avec une syntaxe SVO ; - avec /pʰ-/ : l’agent est dans un rapport d’extériorité au procès exprimé par la base : dans ce cas, on peut parler de construction causative. - Avec /pr-/ : l’agent est un argument du procès mais le procès exprimé par le verbe préfixé n’est pas interprété comme un accomplissement. Cette hypothèse sera confrontée aux données où pour une même base on a deux ou trois verbes préfixés et à celles où seul un des préfixes est possible. EXPOSES INDIVIDUELS : Snejana Gadjeva (Inalco) L’article défini en bulgare L’article défini postposé est un des traits caractéristiques de la langue bulgare qui, d’un côté, le distingue des autres langues slaves à flexion casuelle morphologiquement complexe et qui, d’un autre côté, le rapporoche typologiquement des langues balkaniques, en occurence l’albanais et le roumain. Cet exposé présente la première étape d’une recherche en cours visant à cerner les convergences et les divergences dans l’expression de la définitude par l’article défini dans les langues balkaniques dont il est typique. Ainsi, il fait le point sur l’appartition, la morphologie et les valeurs sémantiques de l’article défini en bulgare. SIMA MVE Jean-Bosco, LLACAN-CNRS (UMR 8135) Etude comparative du systeme nominal possessif en français standard et en fang ntumu (a 75) : morphologie et syntaxe. Dans ce travail nous faisons une approche transversale entre une langue du sud (le fang ntumu A75) et une langue du nord (le français standard) qui présentent des prédictions structurales homogènes. A la lumière des données de notre analyse, nous associons ces prédictions à des principes de constituance où dépendances morphologiques et dépendances syntaxiques seraient intimement liées. Nous proposons d’expliquer ces contraintes dans le cadre de la grammaire générative et plus précisément de la théorie X-barre et de la morphologie distribuée. Dara Non (LLF) Paris Diderot, Joseph Deth Thach (SEDYL) INALCO, Étude de deux verbes copulatifs en khmer : kɨː et ciɜ Il existe quatre façons en khmer pour rendre la construction N1+être+N2 du français. Nous pouvons avoir soit N1 2, soit N1+kɨː+N2, soit N1+ciɜ+N2, soit N1+ kɨː-ciɜ+N2. L’objectif de notre présent exposé est d’explorer les données afin de cerner les différentes interprétations et emplois de ces quatre constructions. Dans un premier temps, nous allons examiner tous les emplois et valeurs de kɨː et de ciɜ lorsqu’ils ne sont pas en concurrence. Dans un deuxième temps, nous analyserons les contextes où ces quatre constructions sont en concurrence. Enfin, nous proposerons des caractérisations sémantiques et syntaxiques pour chacun des deux verbes copulatifs étudiés.