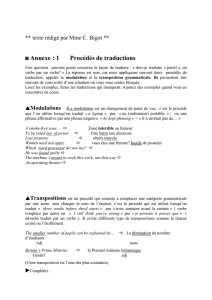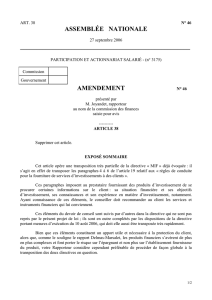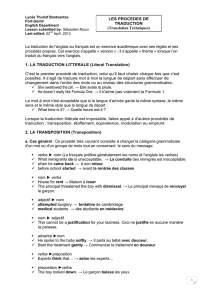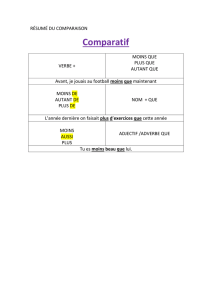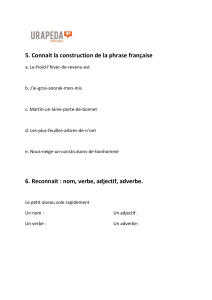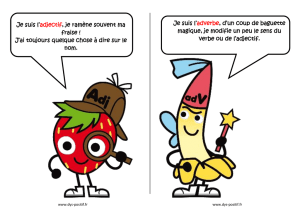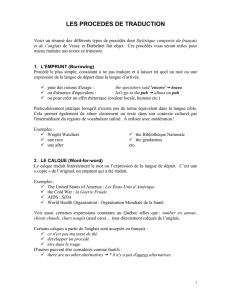PAПSSY CHRISTOV P R O B L E M E S DE LA TRANSPOSITION

PAПSSY CHRISTOV
P R O B L E M E S
DE LA TRANSPOSITION LINGUISTIQUE
PRESSES UNIVERSITAIRES
“SAINTS CYRILLE ET METHODE”
Трудът е îдîбрен çà печàт с решенèе нà
Êàтедрà Рîмàнсêè ôèлîлîгèè
îт 24 .2.1999 г.

Редàêтîр: дîц.д-р Êрàсèмèр Петрîâ
Пàèсèé Хрèстîâ - àâтîр, 1999
Êънчî Дàнеâ - худîжнèê
PAПSSY CHRISTOV
P R O B L E M E S
DE LA TRANSPOSITION LINGUISTIQUE
PRESSES UNIVERSITAIRES
“SAINTS CYRILLE ET METHODE”
Velico Tirnovo, 1999

TABLE DES MATIERES
Introduction: Position et transposition……………….......…........
Chapitre I. Les transpositions au niveau phonétique
et phonologique……………..........................................
Chapitre II. Les transpositions dérivationnelles…………….......
A. La conversion comme transposition……..........................
B. La suffixation comme transposition………........................
La substantivation……………………............................
La verbalisation……………………...............................
L’adjectivation………………………...........................
L’adverbialisation…………………..............................
C. La préfixation comme transposition…………….............
D. La dérivation parasynthétique comme transposition…....
Chapitre III. Les transpositions syntagmatiques…………….....
A. Le substantif comme objet de transposition.......................
Transpositions intracatégorielles………………............
Transpositions intercatégorielles……………….............
B. Le verbe comme objet de transposition…………..............
Transpositions intracatégorielles………..........................
Transpositions diathétiques………...................
Transpositions aspectuelles……….....................
Transpositions modales………….......................
Transpositions temporelles……….....................
Transpositions de la personne grammaticale......
La subduction comme transposition……............
Transpositions intercatégorielles……………….............
C. L’adjectif comme objet de transposition………................
Transpositions intracatégorielles………….....................
Transpositions intercatégorielles…………….................
D. L’adverbe comme objet de transposition………................
Transpositions intracatégorielles…………...................
Transpositions intercatégorielles…………...................
Chapitre IV. Les transpositions au niveau de la phrase……….
A. Transpositions dans le cadre du syntagme verbal……....
B. Transpositions par réduction de la phrase simple…........
C. Transposition du syntagme nominal en phrase simple…...
D. Transpositions au niveau de la phrase complexe……......
Transposition qui aboutit à une proposition-mot............
Transposition qui aboutit à une proposition-syntagme...
Transposition qui aboutit à une proposition-phrase…....
Chapitre V. Les transpositions au niveau lexico-sémantique…..
Les mécanismes de la transposition lexico-sémantique..
Les tendances dans le changement de sens………........
Les tropes comme réalisation contextuelle des
transpositions sémantiques……......................................

Conclusion.................................................................................
Résumé en bulgare....................................................................
Bibliographie.............................................................................
INTRODUCTION
POSITION ET TRANSPOSITION
Les efforts des savants qui s’étaient proposé de ranger la linguistique dans le groupe des
sciences exactes avaient pour but d’établir le caractère systématique de la langue. On peut
supposer qu’un système puisse comprendre des sous-systèmes organisés sur des principes
spécifiques. Il est de notoriété commune que toute théorie a pour principe générateur le rapport
entre le général et le particulier. “La pensée construisant la langue inscrit son action entre des
limites - qu’elle se donne selon le problème à résoudre - et entre ces limites se donne la liberté
d’un mouvement dans les deux sens”1. Le rapport en question organise la matière linguistique
aussi bien au niveau du système global qu’au niveau des sous-systèmes. Le général et le
particulier sont les deux positions extrêmes entre lesquelles, par des saisies plus ou moins
précoces ou tardives, se présente l’évolution des éléments de chaque système. Il est bien évident
que tout élément linguistique occupe, dans le système respectif, une position sous-tendue par
certaines références. La valeur d’un élément dépend de la position qu’il occupe. On a une valeur
de système (dans notre cas une valeur de langue) quand les caractéristiques de cet élément au
niveau du système correspondent aux références de la position où il se trouve. Etant donné le
dynamisme du système linguistique, il est à prévoir qu’un élément puisse prendre, pour des
raisons d’ordre différent et par des moyens appropriés, une position autre que celle qui lui est
réservée dans le système et grâce à laquelle le système est édifié. On est alors en présence d’un
changement de position - d’une transposition. Le général est, donc, ce qui est posé dans le
système, alors que pour obtenir le particulier on a deux voies à suivre: la première est celle qui
reste dans le cadre des références propres à la position en système; en suivant la deuxième voie

on transgresse ces références et l’élément s’avère dans une position dont les références sont plus
ou moins éloignées de celles de la position initiale. Dans ce cas il sera question d’un particulier
obtenu par transposition. Un élément en position initiale doit être considéré, au niveau du
système, comme un fait général, et un élément en transposition - comme un fait de discours. En
d’autres mots, la position initiale est ouverte, de l’ordre de la compétence, elle rend compte de la
fonctionnalité du système; la transposition est résultative, de l’ordre de la performance, elle rend
compte du fonctionnement linguistique. Il faut donc étudier la transposition comme une
corrélation entre la fonctionnalité des faits et le fonctionnement linguistique2. Pour bien prendre
connaissance de ces mécanismes, il faut procéder à l’analyse des éléments qui en sont concernés.
La transposition en tant que phénomène linguistique est signalée par un grand nombre de
chercheurs, mais, à notre connaissance, elle n’a pas été objet d’une étude plus détaillée qui
couvre tous les niveaux linguistiques. Dans son ouvrage Eléments de syntaxe structurale, Lucien
Tesnière parle de translation (la parenté sémantique entre transposition et translation est plus
qu’évidente). Selon Tesnière “la translation consiste à transférer un mot plein d’une catégorie
grammaticale dans une autre”3. Charles Bally4 souligne qu’ «au fond de toute substitution on
aperçoit une transposition d’une catégorie dans une autre» et il parle d’un échange fonctionnel
dans les cas de passage tels que paternel - de père et qui appartient au père. Les éléments
engagés occupent des niveaux d’analyse différents (respectivement le niveau du mot, le niveau
du syntagme et le niveau de la phrase) et c’est le contexte qui les fait changer de position pour
leur communiquer des références positionnelles différentes. A la suite de Ch. Bally nous
pourrions affirmer que cet échange résulte d’une transposition réalisée au niveau respectif: de
père - niveau syntagmatique (le translateur de forme avec le substantif qui suit, mais qui est déjà
sorti de son assiette nominale et privé de ses références catégorielles, un adjectif fonctionnel) et
qui appartient au père - niveau phrastique (le pronom relatif qui, à part son rôle référentiel, a, lui
aussi, une fonction translative - il fait passer (il transpose) la proposition en adjectif fonctionnel.
R. Martin considère la transposition comme “un mécanisme syntaxique par lequel on crée
au niveau du discours des substantifs, des adjectifs et des adverbes fonctionnels au moyen
d’opérateurs tels que les prépositions et les conjonctions”5.
Il y a lieu de faire un parallèle entre transformation et transposition. Dans les cas de
trasformation il y a un changement de forme - un passage d’une forme à une autre. Les
transformations sont codifiables. C’est ce qui explique le fait que depuis longtemps déjà sont
rédigées des grammaires transformationnelles6. Les transpositions ne regardent pas que la forme,
elles peuvent avoir pour objet aussi bien le côté formel que le côté sémantique. Une grammaire
transpositionnelle ( si l’on se décide à en faire une) devrait couvrir un champ bien plus large
parce qu’il faudrait prendre en considération l’ensemble des faits de langage où l’on constate un
écart des références positionnelles qu’un élément donné possède dans le système auquel il
appartient.
Le problème de la transposition trouve un fondement théorique incontestable dans les
ouvrages de Gustave Guillaume et de ceux qui ont fait l’école guillaumienne. Le guillaumisme se
présente comme “une linguistique de position, une linguistique regroupant trois disciplines: la
psycho-mécanique, science de la pensée en action de langage, la psycho-systématique, science du
système de représentation, et la psycho-sémiologie, science des signifiants”7. La théorie
guillaumienne repose sur quelques points cardinaux qui nous intéressent particulièrement, à
savoir:
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
1
/
124
100%