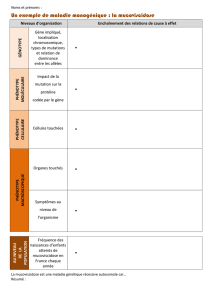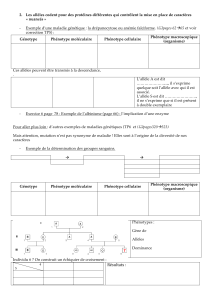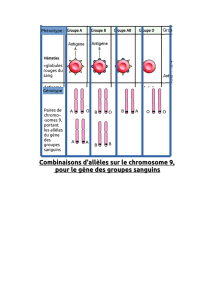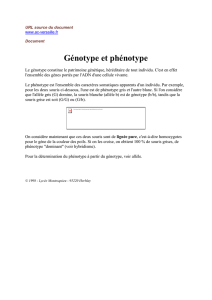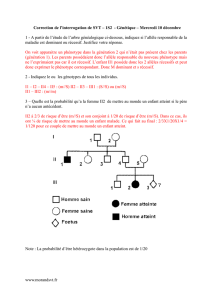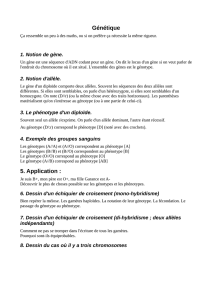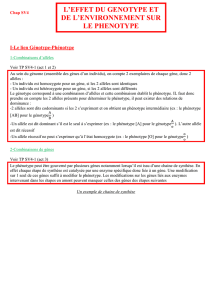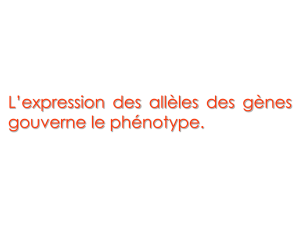I. Des génotypes différents peuvent entraîner le même phénotype

RR - 16/04/17 - 769783461 - 1/5
Complexité des
relations entre génotype et
phénotype
I. Des génotypes différents peuvent entraîner le même phénotype
A. Nous portons deux allèles de chaque gène
► TP 1. L’albinisme d’après Bordas p. 68 et 69.
B. Plusieurs gènes sont généralement impliqués dans un même phénotype
► TP 2. Le xéroderma FACULTATIF
II. L’expression d’un gène peut être modulée
A. Environnement et alimentation peuvent influer sur le phénotype
► TP 3. Le cancer colorectal
B. Des interactions géniques peuvent intervenir dans un phénotype
III. On peut prévoir un génotype avant qu’il soit observable phénotypiquement
A. Les techniques de la médecine prédictive sont diverses
► TP 4. Portée et limites de la médecine prédictive
B. La médecine prédictive a deux visages
OBJECTIF
Le phénotypes moléculaire, cellulaire ou macroscopique sont
l’expression de l’information génétique de l’ADN, c’est à dire du
génotype.
Alors que le génotype est permanent, certains phénotypes ne
s’expriment pas en permanence (ex. le bronzage).
On cherche à préciser dans quelles conditions un génotype
s’exprime en phénotype.
I. Des génotypes différents peuvent entraîner le même
phénotype
A. Un phénotype dominant correspond à au moins deux génotypes
► FIGURE 1. Caryotype humain
Première ES
Chapitre
2.2
4 semaines

RR - 16/04/17 - 769783461 - 2/5
Chez l’Homme, comme dans de nombreuses espèces, les chromosomes forment
des paires de chromosomes homologues qui portent les mêmes gènes aux
mêmes endroits (locus). Pour un gène donné un individu possède donc deux
allèles qui déterminent son génotype.
S’il porte deux fois le même allèle et il est dit homozygote.
Accompagnement. L’écriture des génotypes est exigible.
Exemple. Le gène codant la bêta hémoglobine se trouve sur le chromosome 11 et existe
sous deux formes alléliques HbA et HbS (voir chapitre 2.1 TP n°2).
- Un individu de génotype HbA//HbA produit de l’hémoglobine A uniquement, son
phénotype est [non malade] ;
- Un individu de génotype HbS//HbS produit de l’hémoglobine S uniquement, son
phénotype est [drépanocytose].
S’il porte deux allèles différents et il est dit hétérozygote.
Exemple. Un individu de génotype HbA//HbS produit de l’hémoglobine S mais aussi
suffisamment d’hémoglobine A pour être de phénotype [non malade].
Un phénotype est dit récessif quand il ne s’exprime qu’à l’état homozygote et
dominant quand il s’exprime aussi bien à l’état homozygote qu’à l’état
hétérozygote. Dans ce dernier cas, deux génotypes différents ne correspondent
qu’à une seul phénotype.
Exemple. Dans le cas du gène de l’hémoglobine, le phénotype [non malade] est
dominant et le phénotype [drépanocytose] est donc récessif.
Dans le livre on parle d’allèle dominant ou récessif. C’est un excès de langage. Il
vaut mieux parler de phénotype dominant ou récessif.
Par convention on note :
- en majuscule l’allèle codant un phénotype dominant ;
- en minuscule l’allèle codant un phénotype récessif ;
- entre crochets, un phénotype.
On a donc : A//A ou A//a donne [A] et a//a donne [a].
On parle parfois d’allèle dominant ou récessif . C’est un abus de langage car tous
les allèles s’expriment, il faut parler de phénotype dominant ou récessif.
► TP 1. Les génotypes du phénotype albinos
B. Plusieurs gènes sont généralement impliqués dans un même
phénotype
La biosynthèse d’une molécule fonctionnelle est souvent une suite de plusieurs
réactions chimiques successives qui affectent une molécule initiale ou
précurseur. Chaque réaction est catalysée par une enzyme différente. Puisque
les enzymes sont des protéines elles sont chacune codée par un gène différent. La
défaillance d’un seul de ces gènes entraîne la défaillance de toute la chaîne de
réactions. Dans ce cas on parle de caractère multigénique (= polygénique).
► FIGURE 2a. Chaîne des réactions conduisant à la pigmentation de la peau
► FIGURE 2b.1. Chaîne de biosynthèse d’une molécule fonctionnelle (RR)
► SCHEMA COURS d’après figure 2a et/ou 2b.
Exemples :
- la pigmentation de la peau (voir livre p. 68 et 69 et TP 1) ;
- les groupes sanguins (voir livre p 79) ;
- pigmentation des yeux de la Drosophile ; rétinites pigmentaires ; xéroderma etc.
Dans le cas de la pigmentation de la peau il faut en outre deux molécules différentes
(mélanine et myosine cf. TP1) pour obtenir un phénotype pigmenté. La mélanine (au
moins) est elle même issue d’un chaîne de biosynthèse à partir de la tyrosine.

RR - 16/04/17 - 769783461 - 3/5
► TP 2. Le xéroderma FACULTATIF
Uniquement si on a le temps ou si c’est un choix (voir aussi Didier 1S p. 183).
POSSIBILITE de placer ici le TP 3
II. L’expression d’un gène peut être modulée
A. Environnement et alimentation peuvent influer sur le phénotype
Chaque cellule contient la totalité de l’information génétique de l’individu.
Pourtant elle n’en exprime qu’une partie. Parmi les facteurs capables d’influencer
l’expression de tel ou tel gène se trouvent des facteurs de l’environnement
comme l’exposition au soleil ou la température par exemple.
Chez l’Homme, l’exposition au soleil facilite la synthèse de mélanine (bronzage).
Les chats siamois élevés à l’extérieur ou sous climat froid sont plus foncés que ceux
élevés en intérieur ou sous climat chaud. Inversement la lièvre variable, qui vit en
région polaire ou en altitude, a un pelage blanc en hiver et brun en été. Chez les
mammifères, le tyrosine est transformée en mélanine par la tyrosinase. Chez le chat
siamois l’activité de la tyrosinase diminue quand la température augmente alors que chez
le lièvre une enzyme qui dégrade la tyrosinase est produite quand la température est
basse. (livres 1°S Didier p. 180, Belin p.225, Nathan p. 78.)
► FIGURE 2b.2. Rôle des facteurs externes sur le phénotype (RR)
► FIGURE 3. La drépanocytose expliquée aux jeunes malades dans Bordas p
71.
Alimentation ou environnement peuvent influer sur les conséquences
macroscopiques d’un phénotype moléculaire.
La polymérisation de l’HbS se fait en milieu pauvre en dioxygène et en eau et elle
est accélérée par la température. Les malades atteints de drépanocytose connaissent la
conduite à avoir pour éviter de se mettre dans cette situation.
Les hortensias ont des fleurs roses sur un sol pauvre en calcaire et bleues s’ils sont
cultivés en présence de sulfate d’alumine (coloration réversible). En fait les pigments
des fleurs (des anthocyanes de anthos : fleur et cyano : bleu) sont roses en milieu acide
et bleus autrement (Nathan 1e S p 76).
► TP 3. Le cancer colorectal Ici ou en début de II.
FACULTATIF. Si le temps manque, simplement commenter les documents de TP
en cours (voir aussi Didier 1S p. 183)
B. Des interactions géniques peuvent intervenir dans un phénotype
Les personnes qui possèdent certains allèles développent certaines maladies
(cancers ou maladies cardio-vasculaires) plus souvent que les autres. Ces allèles
de prédisposition (= de susceptibilité) sont transmis, il y a donc une
prédisposition familiale à certaines maladies.
Le fait de posséder un allèle de prédisposition indique simplement un risque plus
grand de développer la maladie et non une certitude. Inversement, le fait de ne
pas posséder d’allèle de prédisposition, ne met pas forcément à l’abri de la
maladie.

RR - 16/04/17 - 769783461 - 4/5
Tout se passe comme si la présence de ces allèles de prédisposition rendait plus
sensible aux facteurs de l’environnement.
► FIGURE 2b.3. Interactions géniques et phénotype (RR)
Exemples :
- obésité ;
- maladies cardio-vasculaires ;
- certains cancers etc.
III. On peut prévoir un génotype avant qu’il soit
observable phénotypiquement
La médecine prédictive permet de prévoir l’apparition d’une maladie (c’est à
dire d’un phénotype) avant qu’elle ne se déclare. Cela est valable chez l’adulte
comme chez le fœtus, on parle alors de diagnostic prénatal.
► FIGURE 4. La réalisation de tests génétiques dans Bordas p. 74.
A. Les techniques de la médecine prédictive sont diverses
1. On peut identifier un phénotype avant la naissance
L’échographie permet d’observer l’organisation externe et interne (phénotypes
macroscopiques) du fœtus. Sous contrôle échographique on peut réaliser les
prélèvement fœtaux en vue de l’établissement de caryotypes (phénotypes
cellulaires) ou d’analyses biochimiques (phénotypes moléculaires).
L'amniocentèse (du grec kentêsis "action de piquer") est une ponction du liquide
amniotique à travers la paroi abdominale de la mère. Cet examen indolore s'effectue vers
la 17e semaine d'aménorrhée. Outre du liquide amniotique on obtient des cellules fœtales
desquamées. La choriocentèse ou biopsie fœtale est un prélèvement de villosités
choriales (futur placenta). L'intérêt de cette technique est d'être utilisable dès la 10e
semaine d'aménorrhée. La cordocentèse est prélèvement de sang fœtal au niveau du
cordon ou du placenta à partir de la 20e semaine.
2. On peut identifier certains génotypes
Il est parfois possible de détecter une maladie génique par analyse directe de
l'ADN. On identifie alors directement le génotype et on en déduit le phénotype
avec certitude. Cette analyse peut se faire soit à la suite d’un prélèvement fœtal
soit, lors d’une fécondation in vitro, directement sur des cellules embryonnaires
avant implantation dans l’utérus maternel. Dans ce dernier cas on parle de
diagnostic pré-implantatoire.
► TP 4. Portée et limites de la médecine prédictive
B. La médecine prédictive a deux visages
Elle permet d’engager divers traitements de manière précoce :
- des traitements médicaux permettant d’atténuer les effets de certaines
maladies génétiques (trisomie 21, phénylcétonurie, mucoviscidose etc.) ;

RR - 16/04/17 - 769783461 - 5/5
- la chirurgie néonatale permet de réparer certaines malformations
congénitales ;
- la thérapie génique permet, grâce aux méthodes de la transgenèse, d’agir
directement sur les causes des maladies géniques.
L’interruption de grossesse (voir chapitre 3.2) est une solution de dernier recours.
Elle est autorisée (loi du 15 janvier 1975 dite "loi Veil") dans le cas de maladies
génétiques particulièrement graves et reconnues incurables. Contrairement à
l'interruption volontaire de grossesse (I.V.G.) qui n'est possible que dans les dix
premières semaines (au stade embryonnaire), l'interruption thérapeutique de
grossesse est possible jusqu'à la fin de la grossesse. Elle nécessite l'avis de deux
médecins mais c'est, avant tout, le couple qui en décide.
La médecine prédictive pose de nombreux problèmes bioéthiques :
- la tentation de l'eugénisme qui prétend améliorer l'espèce humaine et/ou
éliminer les individus considérées comme anormaux ;
- le risque de ségrégation génique car, dans un proche avenir, il sera possible
d'établir, au moins partiellement, la « carte d'identité génétique » d'un individu.
Cela permettra de prédire certaines maladies bien avant qu'elles ne se déclarent,
donc de mieux soigner. Le risque existe que cette "carte d'identité" soit utilisée
pour obtenir un emploi ou pour justifier de sa qualité de « normal ».
En l'absence de cadre bioéthique clairement reconnu, ce n'est pas aux biologistes
de décider de la mise en oeuvre de telle ou telle possibilité technique, mais à la
Société. En France un Comité Consultatif National d'Éthique, regroupant des
personnalités morales et scientifiques, est chargé d'émettre des avis sur les limites
à imposer à ces techniques. Il agit actuellement dans le cadre de la loi de
bioéthique de 1994.
BILAN
Si certains phénotypes sont l’expression directe du génotype, d’autres
résultent de l’interaction de plusieurs gènes ainsi que de facteurs de
l’environnement. Dans ce cas on parle de phénotype multifactoriel.
Les connaissances en génétique humaine permettent dès à présent de
soigner de nombreuses maladies, dans un proche avenir cette possibilité
sera augmentée grâce à la médecine prédictive qui pose cependant de
nombreux problèmes éthiques.
1
/
5
100%