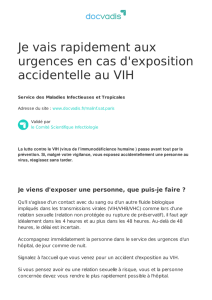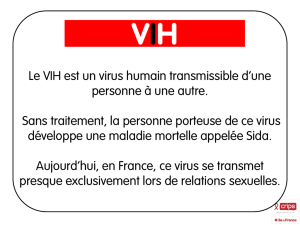4. Histoire naturelle de l`infection à VIH

1
Information de base sur le VIH/SIDA
1
1. Liste d'abréviations .............................................................................................. 1
2. Historique de la découverte du VIH/SIDA ........................................................ 2
3. Transmission et prévention ................................................................................. 2
4. Histoire naturelle de l'infection à VIH ............................................................... 4
5. Comment diagnostiquer le VIH … ..................................................................... 5
6. Détermination des stades cliniques du VIH....................................................... 6
7. Traitement antirétroviral (TAR) ........................................................................ 6
En résumé ................................................................................................................. 6
Mode d'action des ARV ........................................................................................... 7
ARV utilisés dans les projets MSF ......................................................................... 8
Prophylaxie et traitement des infections opportunistes ....................................... 8
Quand débuter le traitement................................................................................... 8
Préparation et support au traitement .................................................................... 9
8. TB et VIH.............................................................................................................. 9
1. Liste d'abréviations
ARV Antirétroviral
AZT Zidovudine
CDF Combinaison à Dose Fixe
CDV Conseil et dépistage volontaires
COB Centre Opérationnel de Bruxelles
D4T Stavudine
EFV Efavirenz
FDA Food and Drug Administration
FTC Emtricitabine
HAART Highly Active Antiretroviral Treatment = Traitement
antirétroviral hautement actif
INNTI Inhibiteurs Non-Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse
INTI Inhibiteurs Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse
IO Infection Opportuniste
IP Inhibiteurs de Protéase
IST Infection Sexuellement Transmissible
LPV/r Lopinavir/Ritonavir (Kaletra)
PEP Post Exposure Prophylaxis = Prophylaxie post-exposition
PTME Prévention de la Transmission Mère-Enfant
PVVIH Personnes vivant avec le VIH
TAR Thérapie antirétrovirale
TARc Thérapie antirétrovirale combinée
TB Tuberculose
TDF Tenofovir
3TC Lamivudine
1
Sophie Duterme et Line Arnould, septembre 2006. Nos remerciements à Hélène Rousse,
Caroline Maes, Peter Saranchuk et Pierre Humblet pour leur relecture approfondie et leurs corrections.
Révision en mai 2010 par Sylvie Moinié et Line Arnould. Toutes les suggestions pour une prochaine
édition sont les bienvenues. Merci de les envoyer à li[email protected]

2
2. Historique de la découverte du VIH/SIDA
1980-1981 : Plusieurs patients, principalement des homosexuels, présentent une
association de maladies rares et une déplétion de leur immunité. Les
premières études indiquent que ces pathologies sont transmises par le
sang et lors de rapports sexuels et que les homosexuels ne sont pas les
seuls à en être affectés. Ce syndrome est appelé SIDA "Syndrome
d'Immuno-Déficience Acquise".
1982 : Des travaux émettent l'hypothèse d'une origine virale du SIDA.
1983 : Le virus est isolé.
1984 : Les premiers tests de diagnostic du VIH (basés sur la détection
des anticorps) sont développés. Il apparaît que l'AZT (la Zidovudine,
un antirétroviral) agit contre le virus VIH.
1985 : L'AZT est autorisé avant la fin des expérimentations pour soigner les
patients atteints du SIDA.
1986 : La communauté scientifique s'accorde pour utiliser la terminologie
"VIH". Un autre type du virus est isolé : le VIH2 (concentré
principalement en Afrique de l'Ouest).
1996 : Les tri-thérapies sont introduites, combinant trois médicaments
différents pour le traitement du VIH/SIDA.
2004 : Les premières formulations combinées en version génériques sont
approuvées par le FDA, les prix des CDF continuent à diminuer.
Le SIDA peut se soigner mais il demeure incurable et il n'existe pas
encore de vaccin.
3. Transmission et prévention
Tout d'abord, le VIH n'est pas transmis par les contacts fortuits du quotidien (poignées
de main, baisers …), par l'air ou par les piqûres d'insectes !
Les principaux modes de transmission du VIH sont les suivants :
- Transmission sexuelle
o Rapport sexuel anal et vaginal : risque de transmission élevé
(particulièrement en présence d'une infection sexuellement
transmissible, pendant les règles, en cas de rapport sexuel traumatisant,
face à un partenaire infecté dont la charge virale du VIH est haute, …)
o Fellation, analingus, cunnilingus : risque de transmission moindre
mais présent, particulièrement en cas de lésion buccale et d'éjaculation
dans la bouche, en présence de lésion des muqueuses et/ou pendant les
règles de la partenaire
Prévention de la transmission sexuelle : utilisation du
préservatif
2
(préservatif féminin ou masculin). Dans les pays
où nous travaillons, vous verrez probablement le message ABC
2
Une lubrification adéquate est importante pour empêcher une rupture du préservatif, mais seuls les
lubrifiants aqueux doivent être utilisés. Les lubrifiants à base d'huile tels que la vaseline, la cold-
cream, les lotions corporelles, le beurre, … qui entament la structure du préservatif ne doivent PAS être
utilisés.

3
sur la prévention : abstinence, fidélité, utilisation du
préservatif.
D'autres mesures évoquées pour réduire le risque de
transmission sont la promotion du test de dépistage du VIH, le
traitement des infections sexuellement transmissibles, le
planning familial, … La circoncision masculine réduit le
risque d’acquisition du VIH. D'autres méthodes sont encore à
l'étude : l'utilisation de microbicides
3
, le diaphragme,
l'administration de certains médicaments antirétroviraux en
guise de prophylaxie, les vaccins, ...
- Sang (transfusion sanguine à risque, échange de seringue, contamination par
piqûre d'aiguille, ...)
Prévention : Test de dépistage des dons de sang destinés à la
transfusion, matériel d'injection à usage unique, port de gants
en cas de contact avec du sang et lors de procédures médicales
invasives, respect des précautions universelles, …
- Transmission de la mère à l'enfant (pendant la grossesse, l'accouchement et
l'allaitement)
Prévention : administration d'une prophylaxie anti-VIH
(monothérapie ou triple thérapie) ou traitement de la mère
pendant la grossesse et du bébé à la naissance et/ou durant
l’allaitement maternel (12 mois)
4
. Dans certains contextes,
vous pouvez encore trouver le lait de remplacement (au lieu de
l’allaitement maternel). Notez que l'abréviation PTME signifie
"Prévention de la Transmission Mère-Enfant".
Prophylaxie Post-Exposition (PEP)
Lorsqu'une personne est en contact avec des fluides corporels potentiellement infectés
(contamination par piqûre d'aiguille, rapport sexuel sans préservatif ou avec un
préservatif déchiré, …), le risque d'infection par le VIH peut être fortement réduit par
l'administration de la PEP.
La PEP diminue le risque d'une infection par VIH mais n'est pas efficace à 100%. Les
médicaments utilisés peuvent entraîner des effets secondaires. La PEP ne remplace
pas les mesures préventives telles que :
- le respect des "précautions universelles" dans l'exercice des activités
médicales,
- les pratiques sexuelles sécurisées, l'utilisation systématique du préservatif lors
de relations sexuelles.
La PEP consiste en l'administration de 2 ou 3 médicaments anti-VIH (antirétroviraux)
suite à une évaluation du risque et pendant une période de 4 semaines. Le traitement
doit être initié endéans les 48 heures de l'exposition, mais le plus tôt sera le mieux (de
préférence dans les 4 premières heures et au plus tard avant 72 heures).
3
Exemple de microbicides à l'étude : gels vaginaux pouvant empêcher la pénétration du virus VIH
dans le corps
4
Rapid Advice, Use of antiretroviral drugs for treating pregnant women and preventing HIV infection
in infants, WHO, November 2009

4
MSF offre la PEP à son personnel en cas d'exposition accidentelle au sang ou
d'exposition sexuelle. Veuillez contacter la personne médicale responsable de la PEP
dans votre projet le plus rapidement possible en cas de contact potentiellement
infectieux. Ensemble, vous évaluerez le risque d'infection et la pertinence d'une PEP.
Vous recevrez des informations complémentaires relatives aux médicaments utilisés
et à la procédure mise en place pour vous aider dans la décision de suivre ou non la
PEP. (Directives MSF - PEP – 2005 : seront révisées en 2010).
N'hésitez pas à vous adresser à la personne médicale de votre choix au cas où vous
auriez des questions concernant le risque de transmission, les mesures de prévention
et la PEP.
4. Histoire naturelle de l'infection à VIH
Le VIH pénètre le corps par la muqueuse du vagin, de la vulve, du pénis, du rectum
(ou rarement par la muqueuse de la bouche). Le risque est accru si ces muqueuses
sont lésées (par une infection génitale par exemple).
Le VIH se multiplie dans les cellules humaines appelées cellules CD4. Celles-ci font
partie du système immunitaire (le système de défense du corps contre les infections).
En les utilisant comme une "usine à VIH", le virus détruit progressivement ces
cellules CD4. Lorsque le système immunitaire (ou de défense) est sérieusement
endommagé, le corps pourra être facilement envahi par des germes (virus, bactéries,
mycoses) qui normalement n'atteindraient pas une personne non infectée par le VIH.
Ces germes génèrent des "infections opportunistes" (opportuniste car profitant de la
faiblesse du système de défense).
Plusieurs années peuvent s'écouler entre le jour où la personne a été infectée par le
VIH et l'apparition des infections opportunistes.
Pendant ce temps, le patient peut ne pas savoir qu'il est infecté et transmettre
la maladie à d'autres !
Comme le VIH se reproduit rapidement, la quantité de virus dans le sang (également
appelée "charge virale") augmente et le nombre de cellules CD4 (détruites ou
inactivées par le processus) diminue, conduisant progressivement au SIDA
(Syndrome d'Immuno-Déficience Acquise = le 4ième et ultime stade de l'infection à
VIH).
Le graphique ci-dessous représente l'évolution dans le temps de la numération des
CD4 (carrés bleus) et de la charge virale (triangles rouges) en association avec
l'évolution clinique de la maladie. Une personne non-infectée par le VIH présente
normalement une numération des CD4 aux alentours de 1000. La médiane des CD4
chez les patients pris en charge dans les projets MSF est de 100 CD4. Le système
immunitaire d’une personne devient insuffisant en-dessous de 500 CD4. Lorsque le
taux de CD4 atteint 100, la personne a déjà été exposée à beaucoup d’infections
opportunistes et sa santé en est sévèrement affectée.

5
Une autre analogie couramment utilisée pour expliquer l'évolution typique d'une
infection à VIH est celle d'un train (la personne infectée par le VIH) approchant d'une
avarie de la voie ferrée (représentant le SIDA). Plus la numération des CD4 est
élevée, plus grande sera la distance entre la position actuelle du train et le
déraillement potentiel (SIDA). Mais plus la charge virale du VIH est élevée (et plus
la numération des CD4 est basse), plus le train s'approchera rapidement de l'avarie de
la voie ferrée.
5. Comment diagnostiquer le VIH …
Le système immunitaire essaiera par divers moyens de contrôler l'infection à VIH et
produira des anticorps contre le virus. Cependant, la production d'anticorps peut
prendre jusqu'à trois mois.
C'est pourquoi, le test du VIH peut être négatif durant les trois premiers mois de
l'infection (fenêtre sérologique) si la clinique de CDV (Conseil et Dépistage
Volontaires) utilise un test basé sur la détection des anticorps pour diagnostiquer une
infection à VIH. Malheureusement la personne infectée est très contagieuse pendant
ces trois premiers mois car la charge virale (quantité du virus dans le corps) est très
élevée.
5
Dans nos projets, nous utilisons des tests rapides semblables à celui ci-dessous. Pour
effectuer ce test rapide, vous ne devez pas prendre du sang avec une seringue ; il suffit
de prélever une goutte de sang par piqûre au bout du doigt en étant dans la salle de
conseil. La procédure diffère cependant d'un projet à l'autre (en fonction également
des réglementations du MdS). Des procédures existent pour confirmer un test VIH
positif et un contrôle de qualité doit être effectué. Lorsque la prévalence VIH est
supérieure à 10%, 2 tests rapides différents sont nécessaires pour poser un diagnostic,
lorsque la prévalence and égale ou inférieure à 10%, 3 tests rapides différents seront
nécessaires.
5
La charge virale diminuera après quelques semaines pour augmenter progressivement à nouveau au
cours des années.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%