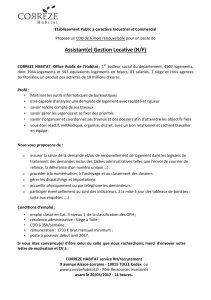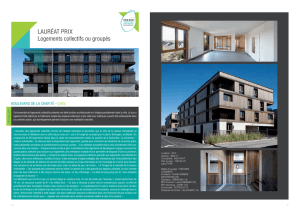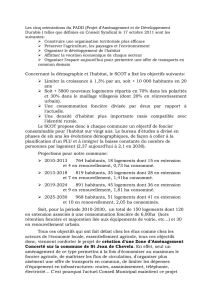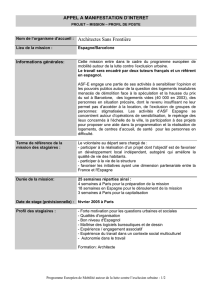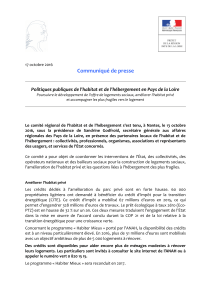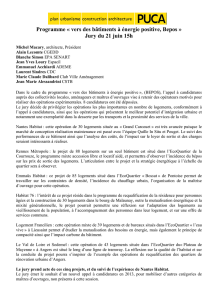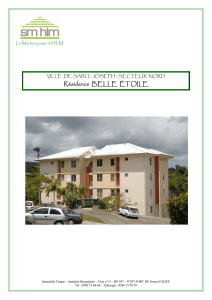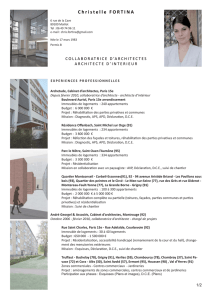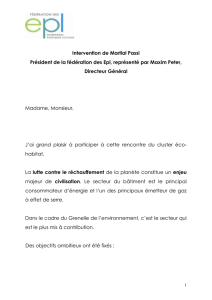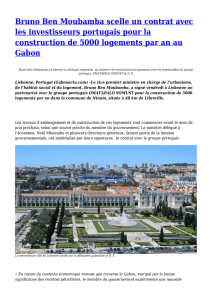Introduction

Introduction:
la ville, toujours synonyme de crise depuis le moyen âge où elle était considérée
comme le lieu de tous les péchés et de la décrépitude humaine, ne commença à être
réhabilitée qu'au XIXème siècle avec, par exemple, la réhabilitation de la ville de Paris par
le baron Haussmann. Mais cette action entraina elle aussi une crise avec l'exclusion des
populations pauvres de la ville intra muros pour les déplacer dans la banlieue parisienne;
ce schéma, repris par presque toutes les villes entraina une crise sociale à laquelle
s'ajouta l'urbanisation qui voyait le milieu rural se vider au profit de la ville de plus en plus
engorgée. Il fallut alors dés 1894 avec la loi Siegfried commencer à construire des
logements sociaux, construits par des organismes aidés par l'État, pour accueillir cette
nouvelle population souvent pauvre, venue en masse: Ces logements furent appelés
Habitats à Bon Marché. Dans le cadre de la Reconstruction d'après guerre, une loi de
1949 transforme les HBM en HLM, les actuelles habitations à loyer modéré, qui
deviendront peu après l'outil principal de l'État pour lutter contre la crise du logement de
l'après-guerre,survenue notamment par l'immigration, au moyen notamment des grands
ensembles et des zones à urbaniser en priorité, habitations construites médiocrement et
sans identité architecturale par urgence et par économie. ceci donna lieu à des barres et
des logements sans vie, malgré quelques expérimentations de grands architectes comme
Le Corbusier ou Tony Garnier. Aujourd'hui donc, l'idée que l'on se fait des logement
sociaux est très péjorative par leur architecture et par leur tissu économico-social souvent
pauvre, et l'État s'attelle donc à changer le paysage architectural de ces logements, en
imposant tout d'abord aux communes, par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain votée
en 2000, de consacrer au moins 20% de leurs constructions neuves à des logements
sociaux trop peu présents pour de plus en plus de demandes; en mettant en place des
normes pour une grande qualité de logement, et en faisant appel à de nouveaux
architectes novateurs en la matière par le lancement de concours architecturaux.
Quelles réponses sont donc proposées, au niveau architectural, à la crise du logement
social? Nous verrons que les projets, pour répondre aux demandes qui se font ressentir,
essaient de réhabiliter des logements existants, veulent concilier logements individuels et
collectifs et s'intéressent aux préoccupations environnementales.

I- Réhabilitation des logements
existants
Aujourd'hui, face à la dégradation de plus en plus en forte des logements sociaux,
beaucoup de communes essaient de trouver des solutions rapides et devant être efficaces
pour réhabiliter les quartiers dits "sensibles" : ils vont alors procéder à la destruction
brutale de grands ensembles. Détruire les barres et les tours peut être une bonne solution
à court terme pour redorer le blason de certaines communes dont le tissu économique et
social s'était appauvrie, et cela peut être payant politiquement au niveau des électeurs.
Mais à long terme, le quartier ou les logements sociaux qui ne peuvent pas tous être
détruits et reconstruits feront face aux mêmes problèmes; c'est pour cette raison que
certains architectes proposent non pas de reconstruire mais de réhabiliter un bâtiment
déjà existant, en lui donnant une réelle identité architecturale et en faisant en sorte qu'il
réponde au désir de ses habitants d'avoir une meilleure qualité de vie.
L'exemple de la réhabilitation de la tour Bois-le-Prêtre de 17 étages située dans le
XVIIème arrondissement de Paris est un très bon exemple de cette volonté de recycler un
habitat en l'adaptant au mode de vie actuel. Cette tour construite entre 1959 et 1969 par

Raymond Lopez, très connu pour ses architectures durant la période de Reconstruction, et
déjà réhabilitée dans les années 90, a encore fait l'objet d'un projet de transformation sous
l'impulsion de l'OPAC qui lança en 2005 un concours d'architecture dans le but de montrer
qu'une opération de réhabilitation pouvait se montrer moins onéreuse qu'une démolition-
reconstruction. Les organisations architecturales qui ont réussi à faire accepter leur projet
sont Frédéric Druot Architecture et Lacaton et Vassal Architectes qui proposent
d'augmenter la surface des 97 logements en prolongeant de 3 métres les planchers. Ainsi,
chaque logement est étendu sur l'extérieur par un «jardin d'hiver» et un balcon construits
grâce à une charpente métallique extérieure montée à sec, permise par la façade légère
d'origine facilement démontable. Cet épaississement des façades permet aussi de faire
environ 50% d'économie d'énergie en isolant thermiquement les logements.
Nous pouvons donc voir que les architectes du projet essaient de respecter le déjà
existant en prenant en compte les qualités que peut avoir le bâtiment issu des grands
ensembles «genre» pas toujours très bien vu, et aussi les remarques des habitants qui a
d'ailleurs poussé au choix de l'extension par l'extérieur qui évite le déménagement de la
plupart des locataires. De plus cette action de réhabilitation a coûté 100 000 euros par
appartement au lieu de 170 milles euros prévus pour un neuf, montrant ainsi que
économie de coût ne rime pas toujours avec médiocrité architecturale.
Dans cette optique de réhabilitation, d'autres bâtiments ont été réaménagés comme
le bâtiment du marais en 2008 situé dans la rue Turenne qui ne correspondait plus aux
demandes actuelles de logement: ce site comportant un mur aveugle complètement
insalubre entouré d'une étroite bande de terrain d'1,5 mètre sur 25 environs protégée par
un grillage bas propice à l'entassement d'ordures, a été pris en charge par un maitre
d'œuvre de logements sociaux: la SIEMP qui a confié a Chartier-Corbasson architectes le
soin de réaménager ces logements dont la réhabilitation a coûté cher par leur ancienneté
(Fin XVIIIème siècle). Ces architectes ont réussi à construire sur le petit espace vide
disponible un nouvel agencement de balcons renouvelant le genre, puisque les balcons se

retrouvent sur les côtés des logements et non plus sur rue ou sur cour. Le rideau de fer
très contemporain n'est pas destiné à recouvrir la forme du mur pignon d'origine qui reste
encore visible, mais valorise plutôt ce mur.
Pour changer l'image des logements sociaux, d'autres idées sont encore concrétisées
II- Conciliation de logement
individuel et collectif
L'image des logements sociaux est, pour la plupart, celle de bâtiments collectifs,
sans identité, dépersonnalisés, dans lesquels les habitants ne peuvent pas se reconnaître
et où ils ont l'impression de perdre leurs repères. Face à ce malaise, les maitres d'œuvres
essaient d'expérimenter de nouveaux projets qui n'hésitent pas à faire un mélange des
genres entre l'habitat individuel, qui donne à ses habitants un endroit complètement
personnel, et l'habitat collectif propre aux logements sociaux souvent regroupés.

Toujours à Paris, lieu de toutes les expérimentations au niveau des logements sociaux, et
plus précisément, à quelques centaines de mètres de la tour Bois-de Prêtre, un projet de
20 logements sociaux a vu le jour en 2006 à l'initiative du maître d'ouvrage Paris Habitat,
l'OPAC de Paris. Ce projet conduit par l'agence d'architecture Fantastic Stéphane Maupin
est une véritable nouvelle initiative dans la rue Pierre-Rebière où aucune habitation
sociale n'était présente. Ce bâtiment qui entre au sein d'un ensemble de 9 immeubles de
différents architectes, arrive à mettre en place des logements sociaux en plein cœur de
Paris en prenant le parti de réduire la rue de 25 à 12 métres pour permettre d'implanter un
bâtiment entre le trottoir et le cimetière des Batignolles. Le projet, au niveau architectural,
veut symboliser la lente mue du logement social collectif vers le logement social individuel
que l'on avait abandonné après-guerre; cette idée est illustrée par un bâtiment qui revêt à
sa base une façade de béton complètement austère avec des fenêtres sèchement
percées, un socle de béton qui s'échancre en forme de M pour laisser place à une série
de petites terrasses se faisant face et se terminant par des toits en bâtière donnant aux
appartements des allures de maisonnettes. Ce bâtiment avec le socle en forme de
monolithe blanc repoussant et les «maisons» apparentes en haut du bâtiment permet de
proposer une solution alternative à ces deux modes d'habitation classiques en faisant une
sorte d'hybridation des deux genres, qui permet dans le même temps l'appropriation de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%