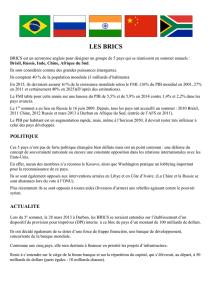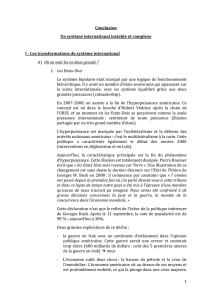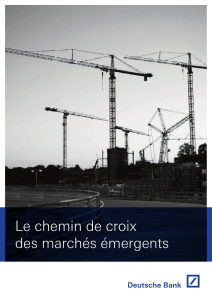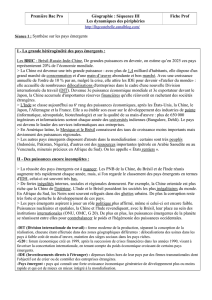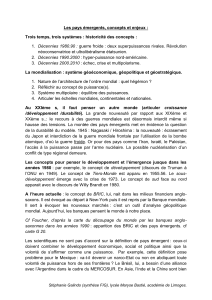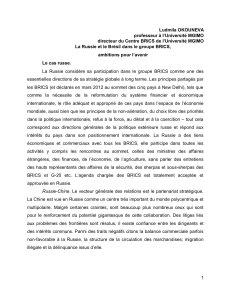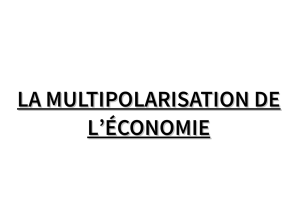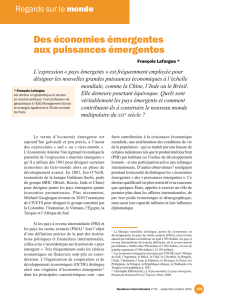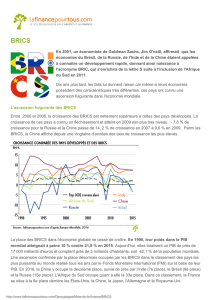On constate d`après l`histoire que le premier réflexe en période de

MODULE 2 : LA MONDIALISATION CONTEMPORAINE : RAPPORTS DE FORCE ET ENJEUX
2) LA MONDIALISATION, ARCHITECTURES, RIVALITES ET INTERDEPENDANCES
Leçon 14 : Tableau géopolitique et géoéconomique du monde actuel
Introduction
Les limites chronologiques et spatiales de la leçon
Monde actuel : monde multipolaire qui n’est plus marquée par l’hyperpuissance absolue des USA. Le
monde reste marqué par la mondialisation contemporaine et on est incontestablement dans un
monde marqué par la crise de 2008.
Dynamique en géographie : XXXXXXXXXXXXX
Décrire un monde qui est travaillé par un certain nombre de dynamiques qui sont principalement en
œuvre depuis la fin des années 70.
Les enjeux de la leçon
On doit faire un tableau géopolitique et géo économique. On doit donc parler de puissance,
d’espaces de territoires et d’états
Décrire l’espace mondial comme un espace d’échange qui rend les états de plus en plus intégrés et
interdépendants
Les états et leurs frontières ne sont plus des obstacles aux échanges.
Les relations entre les états sont suffisamment pacifiées et régulées pour permettre les échanges,
donc pas d’enjeu géopolitique majeur de conquête de territoire.
La compétition économique dans ce monde se déroule entre les acteurs qui pratiquent et
reconnaissent un certain nombre de règles qui peuvent régir la vie économique
XXXXXXXXXXX
Les relations entre les états sont d’avantage marqué par des enjeux géopolitiques que par des enjeux
d’autre nature.
Il y a ans ce monde une compétition économique qui est largement subordonnée à des enjeux
géopolitique
Partie à reprendre car Inès a mal copié.
Suite correctement tapée par Mgr TARDIEUX.
Il y a deux dynamiques mondiales présentes :
-Dynamique d’intégration (qui rapproche ses territoires)
-Dynamique de fragmentation

Ces deux techniques coexistent aujourd’hui dans le monde. Si elles sont chacune en œuvre, elles
n’affectent pas de façon identique l’espace. Ces deux dynamiques participent à la redéfinition des
hiérarchies des puissances politiques et économiques (la Russie joue à fond sur la fragmentation
pour s’imposer, la Chine est dans une logique d’intégration à l’échelle mondiale, et de fragmentation
à l’échelle régionale).
I. Des dynamiques d’intégration et d’interdépendance
croissantes des espaces sont toujours à l’œuvre dans le
monde
A. L’interdépendance passe par le maintien des flux de capitaux et des
marchandises à l’échelle du monde.
1. Des flux de capitaux et de marchandises marquent toujours l’espace mondial
a. Des flux de capitaux
•Lorsque l’on regarde l’évolution des flux d’IDE dans le monde, on constate qu’il y a deux années de
baisse : 2008 (-16%) et 2009 (-37%). Ces baisses sont suivies d’une reprise en 2010, mais qui ne
ramène pas au niveau record de 2006.
•La reprise des IDE depuis 2010 n’a pas nécessairement profité à tous les états et régions du monde.
Exemple : L’Europe occidentale réussi à récupérer plus d’IDE que les USA. Certains pays comme le
Royaume-Uni sont capables d’attirer des flux de capitaux massifs dès 2011 (qui dépassent
l’Allemagne et la France dans le cas du Royaume-Uni). La crise n’a pas affecté la capacité de la Chine
à attirer des IDE.
•Les flux de capitaux sont aussi constitués par les échanges sur le marché des monnaies pour
spéculer. Le marché des changes n’a absolument pas été affecté par la crise.
b. Des flux de marchandises
•Baisse des flux de marchandises en 2008 puis 2009. Mais ce qui est intéressant de constater, c’est
qu’après cette baisse, la reprise de 2010 a permis d’atteindre un niveau d’échange des marchandises
jamais atteint.
2010 : +22%

2011 : +19%
Cela ne veut pas dire que le volume des échanges à augmenter, mais que les échanges en terme de
valeurs d’importations et d’exportations augmente. (On fait donc une estimation des échanges en $.
Donc si le dollar se déprécie et que les prix augmentent, la croissance des échanges est en fait
factice.
La croissance des échanges va par la suite ralentir un peu. On ne peut donc pas dire que la crise ait
mise à mal la mondialisation d’après l’étude des flux de capitaux, ou de marchandises.
2. Les pôles traditionnels des flux de capitaux et de marchandises se maintiennent mais subissent la
concurrence de nouveaux pôles
a. Le poids de la Triade (USA JAPON EUROPE) toujours dominant mais en recul
•Les échanges sont toujours polarisés par le pôle de la Triade. (63% du commerce international se
joue entre ces trois pôles. C’est moi qu’avant : 72 % en 1993.
•Les 2/3 des exportations aujourd’hui sont toujours à destination des USA et de l’Europe. Dans la
DIPP actuelle (Division internationale du processus de production : concrètement, il s’agit du fait
qu’on fragmente la chaine production d’un produit. Une partie du produit est fabriqué sur un
territoire, une autre sur un autre territoire etc…).
La valeur ajoutée d’un produit est donc la somme des valeurs ajoutées des parties du produit fini.
•Les USA achètent des produits chinois pour lesquels ils ont vendu à la Chine des composants très
sophistiqués et sont envoyés en Chine. Lorsque la Chine exporte ces produits aux USA, une partie du
produit est donc américain. Donc l’étude du commerce extérieur d’un pays ne se fait pas qu’avec le
pourcentage d’importations ou d’exportations (balance du commerce extérieur) car un pays a pu
importer un produit qui vient en partie de son territoire.
b. Reclassement et déclassement des états
•Dans l’évolution du commerce mondial, les USA se retrouvent dans une situation ou leur part dans
le commerce mondial diminue face à celle de l’Europe.
•Montée en Europe de l’Allemagne, qui commence à s’imposer comme une puissance commerciale
majeure. La France se maintient toujours à la 5ème place du commerce international.
3. Un nouveau rapport au libre-échange et à la déréglementation semble s’instaurer

a. L’OMC ne parvient plus à libéraliser davantage les échanges
•Depuis les années 2000, l’OMC donne l’impression d’avoir du mal à continuer de libéraliser le
monde. Elle connait des difficultés qui s’incarnent dans une série de négociations commerciales
(cycle de Doha). Le cycle a commencé en 2001, suspendu en 2006, repris en 2011…
•Les raisons de cet échec :
-La transformation du commerce mondial, car il y a l’apparition de nouveaux acteurs (la Chine est
devenue membre de l’OMC en 2002 et sa part dans les échanges commerciaux n’a cessé de croitre,
et à l’inverse la part des USA est passée de 21% à 14%). Les revendications des pays émergents ne
peuvent plus être ignorées.
-On ressent une sorte de méfiance à l’égard de cette institution. L’OMC n’est peut-être pas assez
bien armée pour relancer la croissance économique. La mise en place du G20 semble plus à même de
prendre des décisions importantes.
-Les négociations sont très complexes à mener. En effet, les 153 pays membres appartiennent
chacun à des territoires où les tarifs douaniers sont tous différents.
•On peut dire que depuis 2006, l’OMC ne joue plus son rôle de libéralisation dans la mondialisation.
b. Un repli protectionniste provoqué par la crise ?
•On constate d’après l’histoire que le premier réflexe en période de crise est un réflexe de nature
protectionniste. Les pays qui appartiennent à l’OMC se sont engagés à ne pas tenir une politique
protectionnistes, et pratiquent donc le néoprotectionnisme, c’est-à-dire trouver toutes les
techniques possibles pour protéger les produits nationaux de la concurrence étrangère (exemple :
Renforcer les règles sanitaires sur certains produits/mettre en œuvre des opérations de sauvetage
des entreprises)
c. L’instauration de nouvelles règles
La crise de 2008 a fait prendre conscience du fait qu’il faut imposer des règles aux banques. Il existait
depuis les années 1970 le comité de Bâle qui était chargé de superviser les transactions bancaires.
On essaye d’imposer des règles aux banques au sujet de 2 choses essentielles :
-Les liquidités que possèdent les banques (il faut que les banques aient plus de liquidités, pour limiter
les conséquences des crises de confiance)
-Obliger les banques à avoir des actifs financiers qui permettent aux banques de résister aux
manifestations économiques.

B. L’intégration spatiale est marquée par le renforcement des organisations
régionales
CF P21 à 25
1. Les organisations régionales n’ont pas toutes le même degré d’intégration
2. Les organisations régionales ont un poids économique majeur
3. La dynamique actuelle est à l’agrandissement et à l’intensification de l’intégration
C. La recherche d’une nouvelle gouvernance mondiale témoigne de ces dynamiques
1. La gouvernance mondiale héritée est aujourd’hui en partie dépassée
a. L’ONU
La gouvernance mondiale héritée dépend de 2 périodes : 1ère gouvernance mondiale politique: 1945,
puis 1970 la gouvernance économique. Cette gouvernance mondiale n’est plus opérante.
Lorsqu’elle est créée en 1945, l’ONU est le reflet de l’ordre géopolitique et géoéconomique qui est
né en 1945. L’ONU est créée par les vainqueurs de la seconde Guerre mondiale :
- Place privilégié accordée aux grandes puissances. (droit de veto à la Chine, URSS, USA, France
et Royaume-Uni + ils peuvent choisir le secrétaire général de l’ONU. + Interventions militaires
sont plutôt dirigées par les 5 membres permanents)
- Beaucoup de critiques sont formulées à l’égard de l’ONU : L’ONU dans son fonctionnement
actuel n’est plus du tout en conformité avec l’ordre géopolitique du monde. En effet certains
pays très puissants comme le Japon et l’Allemagne sont mis à l’écart. De même l’Inde ne
comprend pas pourquoi elle ne pourrait pas faire partie de l’ONU.
- Les pays qui ont un poids à l’ONU n’ont plus un poids démographique aussi important
qu’auparavant.
b. Les institutions de Bretton Woods
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%