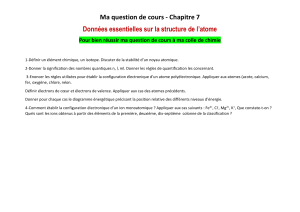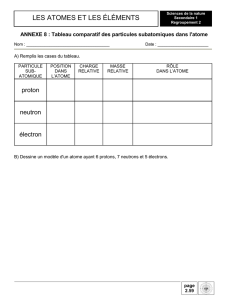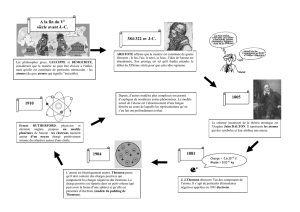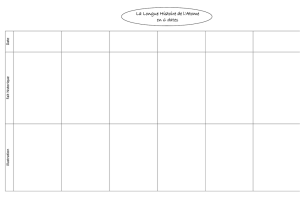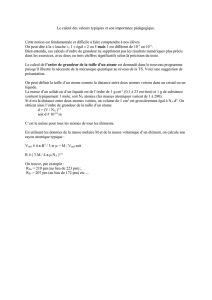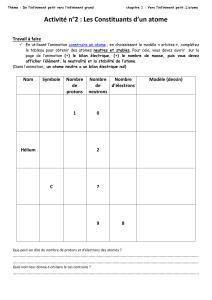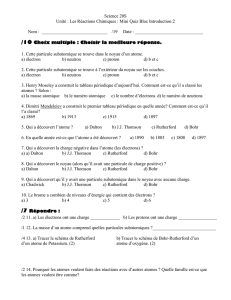Histoire des sciences : l`atome

1
Travaux Pratiques de CHIMIE n°6
Histoire des sciences : l’atome
Un compte-rendu personnel et informatisé vous est demandé. Il est possible de le rendre soit
en version papier, soit sous forme informatique au format PDF.
N’oubliez pas d’indiquer votre NOM Prénom et classe
Dans l’histoire des sciences, de quand date l’idée de l’atome ?
A quel personnage attribue-t-on la première théorie de
l’atome ?
D’où vient le terme « atome » ?
Comment se représentait-on les atomes ? (faire un schéma).
A la même période de l’histoire, quelle théorie décrivant la
matière rejette l’idée de l’atome ?
A qui l’attribue-t-on ?
D’après cette théorie, de quoi est constituée toute matière ?
Jusqu’à quelle époque, cette théorie dominera-t-elle le monde
de la chimie ?
Comment se nomment les chimistes durant cette période ? Quel
est leur but ?
Au début du XIXème siècle, quel physicien britannique reprend
l’idée d’atomes ?
Quelle est la caractéristique de l’atome,
A cette époque, que permet d’expliquer la théorie de l’atome ?
A la fin du XIXème siècle, qui découvrit l’existence des électrons ?
En 1906, quel est le modèle de l’atome de Thomson ? Comment
surnomme-t-on ce modèle ?
(Faire un schéma).
En 1911, à quoi Rutherford compare-t-il l’atome ? (faire un
schéma).
Quelle caractéristique de l’atome Rutherford découvre-t-il ?
Quelle expérience permit cette découverte ?
FAIRE ACTIVITE DOCUMENTAIRE PAGE 56
En 1913, quel est le modèle de l’atome décrit par Bohr ?
En 1932, quelles particules de l’atome découvre-t-on ?
1905, Modèle de Thomson
1911, Modèle de
Rutherford
1913, Modèle de Bohr
XIXème siècle, Modèle de
Dalton
Modèle ……………..

2
Le modèle actuel
A qui attribue-t-on le modèle actuel de l’atome ?
De quand date ce modèle ?
Selon ce modèle, peut-on représenter l’atome par un schéma ?
Quelle particule de l’atome n’est plus représentée par une
bille
mais une onde
?
Comment nomme-t-on la physique décrivant le modèle actuel de l’atome ?
Conclusion :
Il est nécessaire d'élaborer un modèle pour pouvoir expliquer différents phénomènes
et en prévoir les conséquences. Celles-ci, soumises à l'expérience, permettent de valider
le modèle, de l'améliorer ou de le rejeter.
Cependant, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser le modèle le plus complexe pour
expliquer de façon simple un certain nombre d'observations.
Il suffit de bien en connaître les limites.
………………
Pour répondre aux questions ci-dessus vous disposez des sites et documents suivants :
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/scphy/dochtml/4ieme/histatom/index.htm
http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/scphy/dochtml/3ieme/atome/histoir/histoire.htm
http://132.166.172.2/fr/pedagogie/Atome/atomes.html#composition
http://sciencesphy.free.fr/Atomes/ModeleActuel.htm
http://www.cdess.org/Chimie/Histoire_modele_atomique.pdf
http://www2.fsg.ulaval.ca/opus/scphys4/pdf/jeuderole.pdf
Document 1 : De l’atome de Démocrite aux atomes de Dalton
Les philosophes grecs anciens (Empédocle d’Agrigente, Ve siècle av. J.-C., notamment)
considéraient que la « nature des choses » s’expliquait par un savant mélange de quatre éléments :
le feu, l’air, l’eau et la terre.
Au IVe siècle avant notre ère, le philosophe Démocrite (env 460 - 370 av. J.-C.) pense que la
matière est formée de grains de matière indivisibles qu’il nomme atomes. En grec,
atomos
signifie :
« que l’on ne peut pas diviser ».
Pour lui, les atomes sont éternels. Ils sont tous pleins mais ils ne sont pas tous semblables :
ils sont ronds ou crochus, lisses ou rugueux ; ils s’assemblent pour former les objets qui nous
entourent. Démocrite n’a aucune preuve de ce qu’il avance. Sa démarche intellectuelle, purement
philosophique, relève de la spéculation.
les atomes de Démocrite
Le philosophe grec Aristote (384 - 322 av. J.-C.) rejette cette théorie et reprend l’idée des
quatre éléments. C’est sur cette fausse conception que vont reposer les travaux des alchimistes
pendant plus de vingt siècles.

3
La théorie de l’atome de Démocrite sera reprise comme hypothèse de travail par le
britannique John Dalton (1766 - 1844). En 1805, celui-ci suppose l’existence des atomes et postule
qu’il en existe plusieurs types : ils sont de forme sphérique pleine et ne peuvent pas être divisés.
Pas plus que Démocrite, il n’a de preuve expérimentale de l’existence des atomes.
le modèle de Dalton
Document 2 : A la découverte d’une particule mystérieuse
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’hypothèse de Dalton est acceptée par la communauté
scientifique, car c’est celle qui rend le mieux compte des propriétés de la matière.
En 1895, le britannique William Crookes (1832 – 1919) réalise une expérience qui va se
révéler importante pour élargir les connaissances sur l’atome. Il utilise un tube en verre dans
lequel l’air est raréfié. Dans ce tube, sont placées deux électrodes, entre lesquelles il applique une
tension d’environ 10 000 volts.
Il observe un rayonnement issu de la cathode et provoquant une luminescence sur les parois
en verre du tube. Il appelle ce rayonnement « rayons cathodiques ».
Crookes montre que ces rayons sont électriquement chargés car ils sont déviés par le champ
magnétique créé par un aimant.
En 1897, Le britannique Joseph John Thomson (1856 – 1940) prouve expérimentalement que
les rayons cathodiques sont constitués de particules portant une charge négative. Dans
l’expérience de Crookes, ces particules sont arrachées des atomes constituant la cathode.
Thomson propose alors un modèle dans lequel il compare l’atome à un plum-pudding, sorte de
gâteau aux raisins : l’atome est une boule pleine de matière chargée positivement et fourrée de
particules de charge négative. Dans un matériau solide comme l’or ou le fer, ces sphères sont
empilées de façon à occuper un volume minimal.
le modèle de Thomson
Document 3 : L’expérience de Rutherford
En 1909, la structure de l’atome reste encore du domaine des hypothèses. Le physicien
britannique Ernest Rutherford (1871 – 1937), voulant vérifier le modèle de Thomson, réalise avec
deux de ses élèves une expérience décisive.
Il bombarde une très fine feuille d’or avec des particules alpha (noyaux d’hélium chargés
positivement et émis par des atomes radioactifs) de taille bien plus petite que les atomes d’or.
En s’appuyant sur les connaissances de l’époque sur la matière, il s’attend à voir les particules
rebondir sur la feuille d’or ; il est stupéfait de voir que la plupart de ces particules alpha la
traversent, comme si elle était faite de « trous ».. Il observe en effet que seule une infime minorité
de particules alpha semble rebondir sur la feuille d’or : une sur 100 000 ; de plus la grande
majorité des particules alpha ne sont pas déviées par la traversée de la feuille. Parmi celles qui
traversent la feuille d’or, certaines sont déviées et d’autres ne le sont pas. En 1911, après une
longue réflexion, Rutherford propose un nouveau modèle qui remet en doute l’idée admise jusque là

4
que les atomes sont des sphères pleines assemblées de façon compacte : l'atome est constitué d'un
noyau chargé positivement, autour duquel des électrons, chargés négativement, sont en mouvement
et restent à l'intérieur d'une sphère. Le noyau est 104 à 105 fois plus petit que l'atome et concentre
l'essentiel de sa masse. L'atome est donc essentiellement constitué de vide.
le modèle de Rutherford
Document 4 : Les modèles les plus récents
Le modèle de Rutherford n'était pas satisfaisant car il n'était pas stable d'après les lois de
l'électromagnétisme. C'est pourquoi le physicien danois Niels Bohr a proposé un nouveau modèle de
l'atome dans lequel les électrons ne peuvent occuper que certaines orbites bien précises. Les
orbites des électrons ne sont pas quelconques mais "quantifiées". Les électrons peuvent passer
d'une orbite à une autre en émettant ou en absorbant certaine longueur d'onde de la lumière. Ce
modèle de l'atome permet d'expliquer les raies d'émission et d'absorption des atomes et notamment
de l'hydrogène sur lequel Bohr a travaillé.
Le modèle de Bohr est le dernier modèle de l'atome de la physique classique. Il est toujours
utilisé pour le grand public car il est facile à comprendre mais il ne permet pas d'expliquer tous les
phénomènes observés. Le modèle actuel de l'atome fait appel à la physique quantique :
En 1927 le physicien allemand Werner Heisenberg énonça le principe d'incertitude d'après
lequel il est impossible de connaître à la fois la position et la vitesse d'un électron. Le physicien
autrichien Erwin Schrödinger utilisa le principe d'incertitude d'Heisenberg pour proposer, en 1926,
un nouveau modèle d'atome qui conserve la présence et la structure du noyau mais qui rejette la
notion de trajectoire pour les électrons. Dans ce modèle on définit une zone dans laquelle la
probabilité de trouver l'électron est la plus grande. Le rayon de l'atome n'est plus le rayon de la
dernière orbite occupée comme dans le modèle planétaire de Bohr, mais il devient une zone de
probabilité.
1
/
4
100%