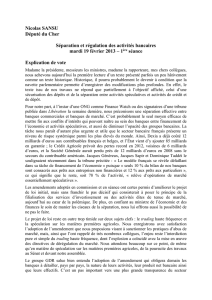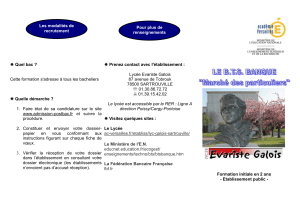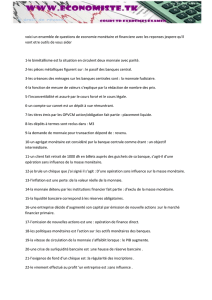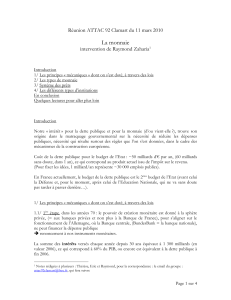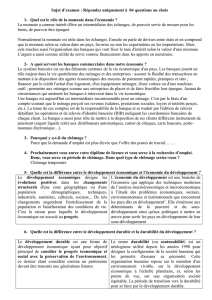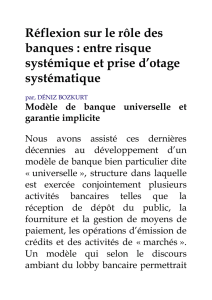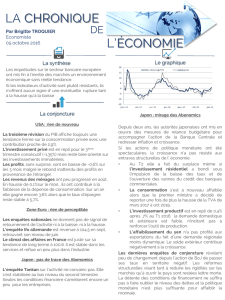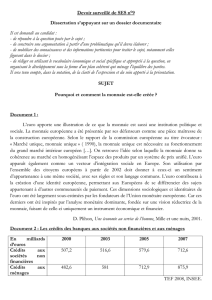Les relations complémentaires des institutions de microfinance et

1
Les Relations Complémentaires entre les Institutions de Microfinance et les
Institutions Bancaires Officielles dans les Pays en Développement.
Une analyse fondée sur la distinction des sphères monétaire et financière.
Koffi Sodokin
RESUME
Deux objectifs sont poursuivis dans ce papier. Le premier objectif est lié à
l’explication des paiements monétaires (formation des revenus monétaires) comme la base
d’une construction analytique de la fonctionnalité complémentaire des microstructures
financières populaires et des institutions bancaires officielles dans les pays en développement.
L’objectif second est de montrer que dans le processus de production des économies
en développement, une partie non dépensée des revenus monétaires créés dans la
consommation des biens produits est conservée après les opérations de paiements, sous forme
de dépôts auprès des microstructures financières populaires et des institutions bancaires
officielles. La part conservée auprès des microstructures financières populaires, quand elle ne
sert pas à financer l’achat des biens de consommation et des activités génératrices de revenus,
est souvent déposée auprès des institutions bancaires officielles. C’est ce que semble
confirmer le fonctionnement actuel des microstructures financières populaires dans le cas des
pays ouest africains. Les microstructures financières populaires sont complémentaires sur un
point de vue structurel aux institutions bancaires officielles. Elles constituent, à cet effet, un
« super compte » de dépôts de « facto » pour les agents économiques qui n’ont pas accès au
système bancaire officiel.
D'un point de vue fonctionnel et de part leur rôle dans le financement de l’activité
économique, d’une économie en développement, les microstructures financières populaires
provoquent des créations de revenus de nature nécessairement monétaire. Elles sont, à cet
effet, des banques de « facto » et sont fonctionnellement complémentaires aux institutions
bancaires officielles.
Nous illustrons finalement les relations complémentaires entre les microstructures
financières populaires et les institutions bancaires officielles dans un modèle Flux-stock à la
Lavoie et Godley.
Mots clés : Institutions bancaires officielles, microstructures financières populaires,
création monétaire, complémentarité, flux-stock, pays en développement.
Attaché temporaire de Recherche au Laboratoire d’Economie et de Gestion (LEG) : Université de Bourgogne.
Email : ksodokin@u-bourgogne.fr; tel : (+33)06.13.12.51.33

2
Introduction.
Le rôle prépondérant des microstructures financières populaires, dans les économies
des pays en développement ces dernières années, a suscité une littérature abondante. Les
travaux consacrés à l’analyse des sphères monétaire et financière dans les économies en
développement, ont surtout mis l’accent sur les politiques de réformes qui doivent permettre
une meilleure orientation des crédits.
C'est dans cette perspective que le développement des microstructures financières
populaires ces 25 dernières années a suscité de nombreuses études sur leur capacité à
constituer un véritable soutient financier pour le développement économique.
La question principale souvent posée par ces études, est celle qui est de chercher à
rendre compte de l’impact du fonctionnement des microstructures financières populaires sur
l’amélioration du niveau de vie des populations qui en bénéficient les services et sur le
développement économique des pays considérés en général.
1
Les microstructures financières populaires ont une fonction de plus en plus importante
dans le financement de la production des microentreprises. Il semble dès lors, que cette
fonction va au-delà du simple rôle d’intermédiaire financier qui leur est généralement
reconnu.
Quelle est l’interprétation analytique de cette fonction ? Cette question a été très peu
envisagée dans la littérature économique consacrée aux sphères monétaire et financière dans
les pays en développement. Une conception claire de la fonction véritable des microstructures
financières populaires, permet d’envisager une analyse de leur complémentarité avec le
système bancaire officiel dans une perspective fonctionnelle.
D’une manière générale, et comme nous l’avons déjà évoqué, les microstructures
financières populaires sont de purs intermédiaires financiers qui se contentent de transmettre
les épargnes entre les agents économiques à besoins de financement et les agents
économiques à capacités de financement.
2
Par ailleurs, tous les économistes sont d’accord sur le fait que les microstructures
financières populaires sont des intermédiaires qui financent des activités génératrices de
revenus d’une catégorie d’agents économiques qui n’ont pas accès au système bancaire
officiel
3
- et - qu’il faut, dans le cadre des politiques de réformes, essayer de trouver des
arrangements qui puissent permettre de créer des effets de synergies entre elles et les
institutions bancaires officielles
4
. C’est en outre pour toutes ces raisons que les soutiens
qu'elles reçoivent de la part des Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont salvateurs.
C’est également ce que nous confirment Hardy et al. [2003] lorsqu’ils écrivent que :
« Il est important de dire que le soutien des [institutions de microfinance] est
meilleur qu’une autre forme d’allocation de ressources limitées, et que ce soutien des
[des institutions de microfinance] n’a pas d’effets négatifs [sur l’activité
économique] »
5
.
1
Voir récemment Lapenu C.et al. 2004, pp : 51-68.
2
Voir à ce propos, Lelart M., 2002, p.15. ; Nsabimana André, 2004, p.45
3
Voir à ce propos, entre autres, les auteurs comme: Besley T. ; Levenson A.R., 1996, pp: 39-59 ; Besley T.,
1995, pp: 115-127; Besley T., S.Coate, G.Loury, 1994, pp:701-719; Besley T., S.Coate, G.Loury, 1993, pp: 792-
810; Burkett P., 1989, pp: 401-419.; Murdoch J, 1999, pp: 1569-1614.
4
Voir à ce propos, entre autres, les auteurs comme: G.Dimitri, D.Kessler et R.Meghir, 1991; Lelart M., 2000;
Gladston M. 1994, XVIII. ; Seibel D.H. ,1996, pp : 97-111.
5
Hardy C, Holden P., Prokopenko V., 2003, p. 151.

3
Les premières analyses qui ont essayé d’appréhender les structures monétaire et
financière dans les pays en développement sont les thèses bien connues de McKinnon [1973]
et de Shaw [1973]. Malgré les apports notoires de ces thèses qualifiées de « néolibérales »,
elles ne paraissent pas bien expliquer la réalité des sphères monétaire et financière dans les
pays en développement. Les effets attendus des mesures de réformes financières qui émanent
de ces thèses, n’ont pas été à la hauteur des espérances dans la majorité des pays considérés et
plus particulièrement dans les pays d’Afrique de l’Ouest par exemple, [Lambert et Condé
2002]
6
.
C'est, en outre, dans cette perspective critique que les thèses « néo-structuralistes »
[Taylor (1983), Wijnbergen (1983), Buffie (1984), Lim (1987)] semblent constituer une
alternative aux analyses « néo-libérales » et paraissent poser la base d’une analyse qui intègre
les microstructures financières populaires (les institutions de microfinance) et les institutions
bancaires officielles, dans un concept structurel du rapport de la finance à la production.
C’est aussi dans cette même ligne directive que nous proposons d’aller au-delà des
apports néo-structuralistes pour essayer de mieux saisir le fonctionnement des sphères
monétaire et financière des économies en développement.
Deux questions principales sont posées dans cette analyse. Elles sont les suivantes.
Comment peut-on interpréter, sur un point de vue tout à fait nouveau, la fonction des
microstructures financières populaires au-delà du simple rôle d’intermédiaire financier qui
leur sont généralement reconnu? Quelles sont les conséquences de cette nouvelle
interprétation sur l’analyse des sphères monétaire et financière dans les pays en
développement ?
Pour répondre à ces questions, nous présentons dans une première section la
distinction institutionnelle entre les microstructures financières populaires et les banques
officielles dans les pays en développement. Cette distinction institutionnelle permet de
déboucher sur une analyse complémentaire des microstructures financières populaires et des
banques officielles dans une perspective structurelle. Nous expliquons dans une deuxième
section les fondements théoriques qui nous permettent de progresser vers une nouvelle
interprétation de la fonction des microstructures financières populaires. Nous examinons dans
une troisième section les conséquences de ces fondements théoriques sur la conception
analytique de la fonction des microstructures financières populaires. Cette nouvelle
interprétation permet d'envisager une analyse complémentaire des microstructures financières
populaires et des institutions bancaires officielles dans une perspective fonctionnelle. Dans
une dernière section, enfin, nous illustrons les relations complémentaires entre les banques
officielles et les microstructures financières populaires dans un modèle stock-flux à la Lavoie
et Godley [2001-2002].
6
A. Lambert et K. Condé, 2002, pp : 829-846.

4
I. De la distinction institutionnelle à l’analyse structurelle de la complémentarité entre les
microstructures financières populaires et les institutions bancaires officielles dans les pays en
développement.
Quelle est la véritable fonction des microstructures financières populaires en tant
qu’intermédiaires financiers dans les pays en développement ? Une tentative de réponse à
cette question nécessite de saisir au préalable la distinction institutionnelle entre les
microstructures financières populaires et les banques officielles.
1.1. La distinction institutionnelle entre les microstructures financières populaires et les
institutions bancaires officielles.
Les crédits octroyés par les microstructures financières populaires ont deux utilisations
essentielles. Ils sont d'une part destinés au financement des dépenses de consommation des
agents économiques et d'autre part au financement des coûts de production des
microentreprises.
Les microstructures financières populaires qui font des crédits à des fins productives,
le font sur un fond d’épargnes (une partie non dépensée du revenu des ménages qui en sont les
détenteurs) constitué auprès d’elles. En quoi cette opération diffère-t-elle ou ressemble-t-elle à
celle effectuée par une banque officielle lorsque cette dernière finance les coûts de production
d'une entreprise? La réponse à cette question est liée à la nature de l’opération de création
monétaire. Quelle est la nature de l’offre de monnaie ? Seule une réponse tranchée à cette
question permet d’appréhender la fonction véritable des microstructures financières
populaires dans les pays en développement.
Mais avant de tenter de répondre à cette question, il paraît nécessaire de saisir au
préalable ce qui distingue structurellement les institutions bancaires officielles des
microstructures financières populaires dans les pays en développement.
1.1.1. Les institutions bancaires officielles dans les pays en développement.
Pour ne pas rentrer dans des détails qui ne sont pas importants pour l’étude présente,
mentionnons uniquement que le système bancaire officiel dans les pays en développement
d’une manière générale et en particulier dans les pays ouest africain
7
, est constitué d’une
banque centrale, de banques commerciales, de banques de développement, de caisses
d’épargne, de compagnies d’assurances et des caisses publiques de sécurité sociale. La sphère
monétaire et financière officielle est dominée par les banques commerciales et les banques de
développement, avec une structure principale qui est caractérisée par une grande participation
de l’Etat qui y dispose souvent de la majorité des parts. Les opérations de crédits de ces
institutions bancaires officielles, sont largement destinées aux entreprises de l’Etat et à
quelques grandes entreprises privées. Comparée aux opérations de crédits effectuées par les
microstructures financières populaires vis-à-vis des ménages et des microstructures
entrepreneuriales, la part des opérations de crédit des institutions bancaires officielles
demeure relativement faible.
8
7
Lorsque nous évoquons ces faits, nous ferons souvent référence à cet espace géographique comme exemple de
pays en développement.
8
M.K.Nissanke, 2001, 25,343-367.

5
1.1.2. Les microstructures financières populaires.
Les microstructures financières populaires sont des petites unités de financement auto-
organisées, plus ou moins institutionnalisées, spécialisées dans les opérations de crédits aux
ménages à faibles revenus et aux microstructures entrepreneuriales. Elles font de la
microfinance. Il s’agit principalement des organisations de type coopératif (les coopératives
d’épargnes et de crédit, les caisses villageoises, les mutuelles d’épargnes et de crédits), les
organismes financés par les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les groupes auto-
gérés et d'auto-assistance comme par exemple, les tontines et les associations rotatives
d’épargnes et de crédits. Ces organisations sont, d’une manière générale, qualifiées
d’informelles
9
ou semi-formelles, parce que n’étant pas soumises aux statuts légaux d’une
institution financière et ne faisant pas l’objet de réserves obligatoires dans leurs opérations de
collectes de fonds (dépôts de la part non consommée des revenus des ménages) et de crédits à
la production. On retrouve dans cette même ligne d’activités les prêteurs individuels et les
collecteurs de dépôts qui font également du crédit et sont généralement connu sous le nom de
tontiniers en Afrique de l'Ouest. Ces organisations ou agents privés répondent à la demande
de clients particuliers, généralement exclus du système bancaire officiel.
Les opérations de crédits des microstructures financières populaires sont
essentiellement basées sur l’épargne des ménages. C’est ce que nous montre par ailleurs leur
fonctionnement dans les pays d’Afrique de l’Ouest, pour l’année 2003 ( tableau 1). Comme
l'expliquent Lafourcade et al.[2005]: les microstructures financières populaires:
«…offrent de l’épargne comme service financier de base et l’utilisent comme
une source importante de fonds pour les prêts »
10
.
Tableau 1
A.T
Nbe d'IMF
Enc. Brute de Prêt
Epargne Totale
Nbre
d'Eprteurs
Nbre d'épargnants
A.Ouest
490
66
298
264
0.73
2.2
Pop.Totale
226
Source:
A. L. Lafourcade et Al. [2005]
Encours Brut de Prêts ( Enc. Brut de Prêt); Epargne Totale et Actif total (A.T) sont en millions de dollars
Nombres d'Emprunteurs ( Nbre d'Eprteurs) et Nombre d'Epargnants ( Nbre d'épargnants) sont en millions
Les données sont estimées pour l'année 2003.
Les crédits octroyés sont destinés au financement de la production de microstructures
entrepreneuriales aussi bien qu’au financement de l’achat des biens de consommations.
Succinctement, mentionnons que plusieurs autres organisations, comme les banques
commerciales, les institutions régulées spécifiques et les organisations non gouvernementales
9
Par ailleurs, la frontière entre les microstructures financières populaires connues sous le nom d’institution de
microfinance (aujourd’hui) paraît très mince. Voir, à ce propos, M.Lelart, 2002, p.15.
10
Lafourcade A.L. et Al., 2005, www.mixmarket.org. p.1
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
1
/
64
100%