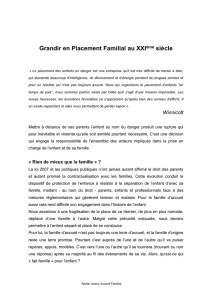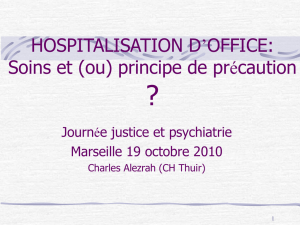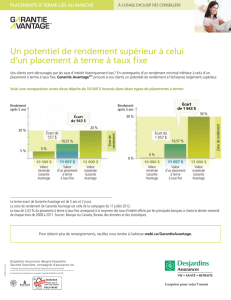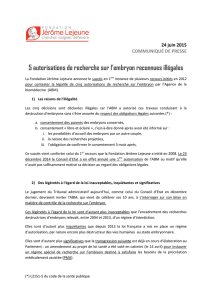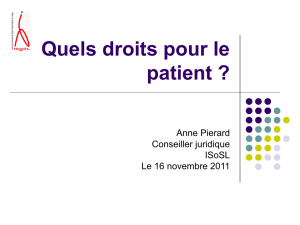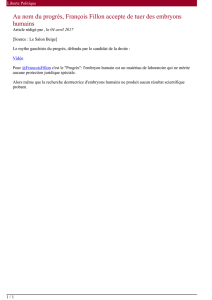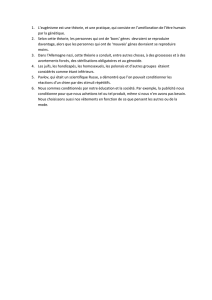CM(2001)9 Addendum - Addendum au rapport abrégé de la 21e

Délégués des Ministres
Documents CM
CM(2002)9-Add (Confidentiel) 29 janvier 2002
——————————————
785 Réunion, 27 février 2002
10 Questions juridiques
10.4 Comité directeur pour la bioéthique (CDBI)
Addendum au rapport abrégé de la 21e réunion du CDBI
Paphos, 13-16 novembre 2001
——————————————
Ce document contient les annexes confidentielles suivantes du rapport abrégé de la 21e réunion du
Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) :
Page
- Annexe I : Projet de Recommandation sur la xénotransplantation…………………….3
- Annexe II : Avant-projet de Protocole sur la protection de l’embryon et
du fœtus humains ………………………………………………………………………..13
- Annexe III : Avant-projet de Protocole sur la génétique humaine ………………....…...23
- Annexe IV : Projet de Recommandation Rec (...) ... du Comité des Ministres
aux Etats membres visant à assurer la protection des droits de l'homme et de
la dignité des personnes ayant des troubles mentaux, en particulier de celles
placées comme patients involontaires dans un établissement psychiatrique …………….35
- Annexe V : Avant-projet d’instrument sur l’utilisation, dans la recherche
biomédicale, de matériel biologique d’origine humaine et de données
à caractère personnel …………………………………………………………………...69

ANNEXE I
Projet de Recommandation Rec (…)…
du Comité des Ministres aux Etats membres
sur la xénotransplantation
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres;
Tenant compte de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et de la
dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine;
Tenant compte de la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à
des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques;
Considérant la Résolution (78) 29 sur l'harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux prélèvements, greffes et transplantations de substances d'origine humaine, du Texte
final de la 3e Conférence des ministres européens de la Santé (Paris, 16-17 novembre 1987) et la
Recommandation R (97) 15 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la
xénotransplantation;
Ayant à l’esprit la Recommandation 1399 (1999) de l’Assemblée Parlementaire relative à la
xénotransplantation ;
Prenant en compte l’insuffisance d’organes et de tissus d’origine humaine disponibles pour la
transplantation ;
Considérant que la xénotransplantation est une des réponses thérapeutiques possibles à cette
insuffisance ;
Notant que la xénotransplantation reste une activité expérimentale et que la recherche est
essentielle pour accomplir des progrès dans ce domaine ;
Conscient des risques de rejet et de maladie pouvant résulter du greffon animal sur le patient
receveur ;
Soucieux des risques éventuels que présente la xénotransplantation en matière de santé publique
et de transmission de maladies ;
Considérant qu’il est de la responsabilité de chaque Etat membre d’adopter les mesures
adéquates pour y répondre ;
Considérant que les préoccupations de santé publique peuvent prendre un caractère international
rendant nécessaire l’application de dispositions communes dans tous les Etats membres du
Conseil de l’Europe dans lesquels la xénotransplantation est envisagée ;
Considérant qu’une coopération mondiale entre Etats est nécessaire dans ce domaine ;
Considérant qu’aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu à moins qu’une efficacité et une
sécurité suffisantes n’aient été démontrées aux travers d’études pré-cliniques ;

Conscient que la nécessité d’une telle démonstration limitera considérablement le nombre de
xénotransplantations dans les années à venir, permettant ainsi une évaluation appropriée des
risques ;
Considérant que la xénotransplantation de cellules et de tissus est déjà en train d’être réalisée
dans de nombreux Etats d’Europe et à travers le monde et qu’une réglementation rigoureuse est
ainsi requise de manière urgente ;
Soucieux des questions éthiques et de bien-être liées à l’utilisation d’animaux pour la
xénotransplantation et la recherche qui y est associée ;
Notant la préoccupation du public quant aux questions relatives à la xénotransplantation et
soulignant l’importance d’organiser un débat public sur ce sujet ;
A. Recommande aux gouvernements des Etats membres :
- d’appliquer, dans l’élaboration et la révision de leur réglementation et de leur pratique en
matière de xénotransplantation, les principes et lignes directrices énoncés ci-après en vue
de réduire au minimum les risques de transmission de maladies connues ou inconnues et
des infections à la population ;
- d'assurer une large diffusion à la présente Recommandation, en particulier auprès de
toutes les personnes, instances et structures, publiques ou privées, responsables de
l'organisation et de la mise en oeuvre de la xénotransplantation.
B. Décide que la présente Recommandation devrait être réexaminée par un comité d’experts
à intervalles appropriés et au plus tard dans un délai de trois ans.
C. Charge le Secrétaire Général de porter le contenu de la présente Recommandation à
l’attention des Etats non-membres et des organisations internationales qui ont participé à son
élaboration.
LIGNES DIRECTRICES
Chapitre I - Objet et définitions
Article 1 – Objet de la Recommandation
La présente Recommandation couvre toute activité de xénotransplantation ayant un être humain
comme receveur.

Article 2 - Définition
Aux fins de la présente Recommandation, est considérée comme xénotransplantation toute
intervention impliquant la transplantation ou l’infusion chez un receveur humain de cellules,
tissus ou organes vivants d’origine animale (type A) ou de fluides, cellules, tissus ou organes
humains ayant eu un contact ex vivo avec des cellules, tissus ou organes animaux (type B).
Chapitre II – Dispositions générales
Article 3 – Xénotransplantation – le cadre
Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu dans un Etat qui ne disposerait pas d’un cadre
juridiquement contraignant destiné à régir la xénotransplantation. Ce cadre devrait avoir des
dispositions appropriées pour protéger les patients, la santé publique et les animaux utilisés. Il
devrait aussi respecter la réglementation générale applicable à la recherche biomédicale chez
l’homme ainsi que les recommandations complémentaires spécifiques à la xénotransplantation
figurant ci-après.
Article 4 – Conditions générales pour la xénotransplantation
Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu à moins qu’elle ne soit réalisée par une équipe
accréditée, dans un centre autorisé et conformément à un protocole dûment approuvé.
a) Les équipes réalisant la xénotransplantation devraient être qualifiées sur le plan
scientifique et devraient comprendre toute l’expertise nécessaire.
b) Les centres devraient avoir reçu l’agrément des autorités compétentes avant le début de la
xénotransplantation.
c) Avant qu’une transplantation n’ait lieu, tous les protocoles devraient être soumis à
l’approbation de l’instance reconnue par le droit national comme compétente pour évaluer les
activités de xénotransplantation. La procédure d’évaluation devrait comprendre un examen
indépendant du point de vue éthique et scientifique ainsi que de celui de la protection des
animaux.
d) Chaque membre de l’équipe chargée de la xénotransplantation devrait avoir approuvé le
protocole et sa mise en œuvre.
Article 5 – Meilleures pratiques internationales
Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu à moins qu’elle ne soit conforme aux
meilleures pratiques internationales en vigueur notamment en ce qui concerne :
i. la qualité de la xénogreffe,
ii. la pratique clinique,
iii. la sécurité biologique et la surveillance,
iv. le bien-être des animaux et
v. les questions éthiques.

Chapitre III – Démonstration pré-clinique de sécurité et d’efficacité
Article 6 – Démonstration pré-clinique de sécurité et d’efficacité
Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu à moins qu’une sécurité et une efficacité
suffisantes n’aient été démontrées à travers des études pré-cliniques. Ces études devraient avoir
fourni des données de référence pour une évaluation appropriée des risques en particulier à
l’égard de la sécurité des patients et de la santé publique.
Les études pré-cliniques devraient avoir :
i. démontré que la xénogreffe fonctionne de manière satisfaisante pendant un laps de temps
approprié sur des modèles pertinents. Ceci devrait être réalisé en faisant appel à une
méthodologie cliniquement applicable.
ii. évalué le risque d’événements adverses, de transmission d’agents infectieux cliniquement
pertinents, et des conséquences éventuelles d'une telle transmission, sur des modèles pertinents.
Chapitre IV - Dispositions concernant les patients participant à une xénotransplantation
ainsi que leurs proches
Article 7 – Conditions pour la participation d’un patient
Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu à moins que les conditions spécifiques
suivantes ne soient remplies :
i. Aucune autre procédure thérapeutique n’est disponible pour le patient.
ii. Les données provenant des études pré-cliniques et, le cas échéant, des études cliniques
antérieures, permettent d’attendre un avantage clair de la xénotransplantation.
iii. Les risques encourus par le patient ne sont pas disproportionnés par rapport au bénéfice
potentiel attendu de l’intervention.
Article 8 - Evaluation des risques pour la société
Les risques éventuels d’une xénotransplantation pour la société devraient être convenablement
évalués.
Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu à moins qu’à la lumière de toutes les mesures
de santé publique mentionnées dans la présente Recommandation, l’équilibre entre les bénéfices
potentiels et les risques éventuels ne soit acceptable.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
1
/
70
100%