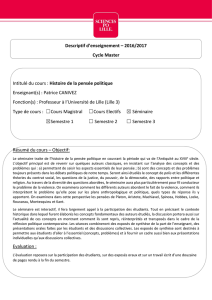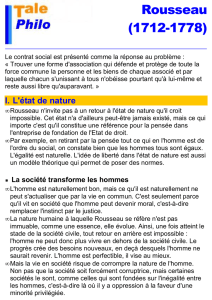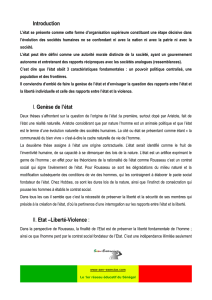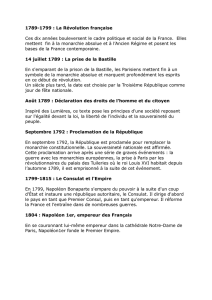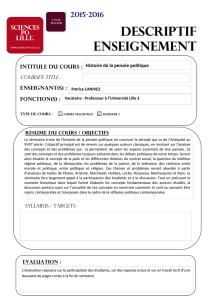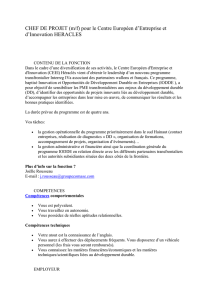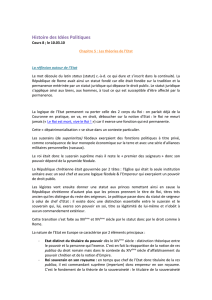Modernité et renouvellement du politique (dessein, objet, finalité

1
Modernité et renouvellement du politique
(dessein, objet, finalité)
Concernant la modernité, on a coutume depuis le milieu du XX° de diviser l’Histoire de
l’Europe en une histoire moderne et une histoire contemporaine. L’époque
contemporaine commence au début du XIX° ; l’Histoire moderne comprendrait les trois
siècles fondateurs de notre civilisation XVI – XVII – XVIII.
Ce terme de moderne qui aujourd’hui fait parfois ancien a été employé assez tôt dans
l’Histoire de l’Europe mais a trouvé ces lettres de noblesse à l’époque contemporaine
lorsqu’a été posée la querelle politique entre Anciens et Modernes. Jusqu’à une époque
récente, être affublé du terme de moderne était positif, inscrivant dans l’Histoire et dans
un courant politique dynamique construisant l’Histoire à travers le politique.
Il faut comprendre cette modernité à l’aune des grands changements qui surviennent à
la fin du Moyen-Age. Le XV est un siècle de rupture fondamentale dans notre Histoire.
Cette rupture, d’un point de vue anthropologique font basculer d’une société
traditionnelle à une société moderne : on parle de Temps Modernes. Cette période de la
modernité se définit comme une renaissance qui précise la nature de cette modernité.
Au XV, en terme d’évènements géopolitiques, en terme de révolution culturelle,
technique, scientifique, il y a des ruptures fondamentales (un « laboratoire de la
modernité »). Dans les sociétés européennes et occidentales, on est toujours marqué par
cette modernité certes débattue, mais dont nous sommes les héritiers.
A l’heure de la mondialisation aujourd’hui, certaines sociétés n’ont pas connu ces mêmes
ruptures. La mondialisation nous montre un monde complexe où on a l’impression que
tout le monde est entré dans ce temps mondial mais où les sociétés sont
fondamentalement différentes de ce que nous sommes. Les différences sont marquantes
entre les sociétés : nous regardons des sociétés structurés sur des principes différents à
l’aune de notre passé. Les éléments de tradition dans une société donnée nous étonnent
(Inde, Chine, Afrique). La plupart des sociétés n’ont pas vocation naturelle à remettre en
cause leur tradition. La remise en cause des savoirs hérités, de ce que nos pères
pensaient, n’est pas naturelle : elle est extraordinaire.
A partir du XV, les sociétés européennes ont décidé de ne plus penser comme elles
avaient pensé auparavant, croyance ou mode de vie : ne pas penser comme ses pères.
Cet élément constitue notre modernité.
Cependant tout n’est pas remis en cause. Le XVI, à travers la « Renaissance » assume le
passé mais change le présent et l’avenir des sociétés européennes.
Trois dates fondamentales
1453 : prise de Constantinople par les Turcs. L’empire Byzantin s’effondre en
abandonnant sa capitale historique. La chute de Constantinople, c’est l’installation aux
portes de la chrétienté de l’empire Ottoman (forme politique impériale et société fondée
sur un lien social religieux). En 1453, l’Europe perd le monde ancien. Elle fait le deuil

2
définitif de ce qui l’a fondé : la matrice romaine, l’héritage antique, l’idée d’un monde
unifié par la civilisation. Au XV, ce monde ancien, héritier de l’Empire Romain d’Orient
disparaît pour la chrétienté car aux mains d’un Empire considéré déjà comme étranger à
la civilisation européenne. L’Europe a d’abord fait son deuil du sud de la Méditerranée,
et fait alors le deuil de la partie orientale de la Méditerranée. L’idée d’une chrétienté
universelle s’efface progressivement. Depuis longtemps certes, Byzantins et Croisées se
combattaient, mais il restait un fond commun, une idée confuse de catholicité,
d’universalité portée par l’Antiquité et la Chrétienté. La Méditerranée était le centre
même de la civilisation. La chute de Constantinople est bien la perte du monde ancien,
d’une idée rêvée, virtuelle.
1492 : la découverte des Amériques par Christophe Colomb. L’Europe perd le monde
ancien pour découvrir un nouveau monde. L’Europe avait encore un ancrage très fort en
Méditerranée, mais par delà l’Atlantique, on découvre un Nouveau Monde, un Nouveau
Continent. La chute de Constantinople est intrinsèquement liée à une vision liée de
l’Europe, centre d’une Terre plate centre de l’univers et du cosmos, création de Dieu. Le
moment de Christophe Colomb démontre autre chose. Christophe Colomb, à la
recherche d’une nouvelle route commerciale, comptait découvrir les côtes de l’Inde,
prouvant que la Terre était ronde, en faisant le voyage inverse que ce qui avait guidé
l’Europe jusque là. Cette démonstration est capitale d’un point de vue anthropologique.
Les Européens prennent conscience qu’ils ne sont pas seuls au monde : le centre du
Monde était Jérusalem – Constantinople – Rome, et la chrétienté définissait les autres
civilisations comme une périphérie. On avait établi des relations commerciales avec la
Chine par exemple, ou les Musulmans, certes différents mais très proches de la
civilisation européenne. On ne découvre pas simplement qu’une terre vierge :
l’Humanité ne se limite pas à ce que l’Europe avait pu en penser, à ce que les Ecritures
disposaient. Les Indiens d’Amérique semblaient n’avoir aucun rapport avec les canons
culturels européens. Ces populations ne peuvent être placées dans aucune catégorie
mentale. La question est suffisamment impérieuse pour que l’Eglise se pose la question
de l’Humanité de ces Indiens : sont-ils des hommes, au sens anthropologique, culturel,
civilisationnel ? Avons-nous une commune humanité ? Dans ce cas, le plan divin les
concerne, il faut donc les convertir, les faire entrer dans notre humanité en les sauvant
de leur ignorance, en les sortant de leur condition inférieure. La découverte des
Amériques est débord et avant tout la conséquence d’une révolution culturelle et
scientifique du XV : Copernic, Galilée… Si la Terre est ronde, au milieu d’un univers sans
fin et sans limite, toutes les conceptions traditionnelles sont ébranlées. La modernité,
c’est à la fois cette science et les conséquences de cette révolution scientifique,
notamment sur les conceptions religieuses. Le Dieu chrétien est un Dieu de l’Antiquité,
un Dieu de proximité, qui intervient dans l’Histoire des hommes : les prophètes, les
Plaies d’Egypte, etc. si Dieu est créateur de l’Univers comme de la Terre et des Hommes,
il s’éloigne considérablement et ébranle toutes les conceptions traditionnels. C’est un
décentrement du monde. Sortira de cette crise, une nouvelle civilisation dite moderne.
L’Europe considère à partir du XVI qu’elle ne peut envisager ce monde qu’à partir d’elle
–même. Néanmoins on va convertir les Indiens à bien plus qu’une religion : un type de
société, une manière d’envisager le monde. L’Europe n’est plus tout le monde, mais elle
veut changer le monde. L’universalité avait été pensé dans un monde clôt, l’universalité
d’une civilisation héritée de l’Empire. Des modèles politiques se fondaient sur l’idée d’un

3
Empire chrétien uni. L’Europe n’abandonne pas sa source universelle mais la redéfinit
dans un monde ouvert plus grand, plus large, plus complexe que ce que l’on pensait : le
destin de l’Europe change : il faut civiliser, évangéliser, éduquer le monde. L’Europe
n’est plus tout le monde mais veut changer le monde, l’inscrire dans sa propre
universalité. Si l’universalité est différente de ce que la tradition avait affirmé, les
conséquences de la religion mais aussi des instituions et de la politique s’en trouvent
considérablement modifiées. La découverte de la complexité du monde est capitale pour
l’Europe. Ces Indiens existent et doivent être évangélisés : c’est une démarche de
reconnaissance de la complexité du monde.
L’universel est défini par l’Europe elle-même. La reconnaissance des Indiens comme des
être humains est ambiguë. Cette commune humanité est un renouvellement de la
conception de l’universalité : on inclut l’étrangeté dans l’universalité. L’Eglise affirme
cette nouvelle conception de l’universalité en la faisant rentrer dans la civilisation. La
Renaissance a bien ces deux facettes en permanence. Au bout du compte, ces peuples
indiens vont largement disparaître au profit d’une politique d’installation des
populations européennes sur ce sol du Nouveau Monde, considéré à la fois comme
habité et vierge.
La meilleure preuve de ces changements est donnée par ce terme d’Europe. Jusqu’au XV,
Europa est un terme très peu employé, très peu connu, terme savant connu d’une sphère
intellectuelle limitée, celle de l’Eglise. Ce terme est emprunté à la mythologie grecque, et
avait permis de définir l’aire éloignée du pourtour méditerranée. Ce terme d’Europe
passe du statut savant à la notion de civilisation : il est employé pour définir ce que l’on
appelait jusque là chrétienté. Ajouté au monde chrétien le mot européen reflète les
changements en cours au sein de cette chrétienté profondément en crise, avec la
recherche de la figure de l’Empereur, la conception du politique qui définit les fins du
politique par des finalités religieuses. Le terme d’Europe définit également la nouvelle
situation politique où en Europe ce n’est plus l’Eglise mais les monarchies chrétiennes,
les états européens qui gouvernent. L’Europe définit plus qu’un espace : une civilisation
unie, avec des états qui s’affirment comme souverains, comme n’obéissant à aucun
commandement extérieur. Ces changements fondamentaux ont un mot qui les définit :
Europe.
Les changements effectués par la chrétienté ébranlent fortement son magistère : la
chrétienté n’a plus les moyens de dépasser les divisions des états qui forment cette
chrétienté, cette Europe chrétienne fondée sur la diversité entre puissances politiques.
Ce monde nouveau s’émancipe de la tutelle religieuse.
Tout cela ne s’est pas fait en quelques années. C’est une montée en puissance des états,
une érosion du magistère politique de l’Eglise. Les ruptures du XV expliquent les
transformations du XVI. Dans la deuxième partie du XV, l’Europe connaît une crise
majeure, au sein du christianisme, avec l’avènement d’une dissidence religieuse qui va
pouvoir pour la première fois s’affirmer dans l’Histoire de l’Eglise : le protestantisme, la
réforme. La chrétienté unie n’est alors plus qu’une fiction. Cela participe à l’évacuation
de l’ancien ordre politique basé sur l’équilibre entre pouvoirs politique et spirituel.
Du XV à XVI il n’y a qu’un pas. L’Eglise catholique va tenir, se réformer profondément,
mais à côté, le protestantisme développe des formes politiques concurrençant l’ordre
politique traditionnel.

4
La laïcité relative des valeurs s’entend au sens que dans l’ordre politique, le pouvoir
suprême n’est plus exercé seulement par une puissance (l’Eglise), mais par des
puissances (l’Eglise et des Etats). Le religieux lui-même est remis en cause, au sens où
les rois eux-mêmes jouent un rôle dans le domaine religieux. La pluralité de puissances
caractérise l’Europe du XVI.
La laïcisation des valeurs s’accompagne d’une relativisation jamais connue du message
de l’Eglise. A partir du XVI, si le latin reste la langue qui véhicule le savoir, la langue de
l’Eglise catholique, les langues vernaculaires (bientôt nationales) sont codifiées, mises
par écrit pour participer ensuite à la formation des identités nationales. Les textes
religieux sont traduits dans ces langues. Les textes religieux vont être connus d’une
population plus importante, plus nombreuse à travers cette traduction. L’arrivée de
l’imprimerie de Gutenberg facilite cette diffusion. La réforme est notamment la
contestation de la médiation de l’Eglise. Le XVI est un siècle religieux : on s’entretue
pour cause de religion. La croyance est fondatrice, mais n’est plus autant codifiée,
encadrée. Ce pluralisme religieux n’est pas encore assumé par l’Europe (la liberté de
culte n’est pas encore admise). On parle en même temps de laïcisation des valeurs car la
religion se diffuse dans le commun. On entend laïc au sens grec de peuple. On ébranle la
chrétienté universelle. Au début du XVI, les grands intellectuels qui pensent le nouveau
monde parlent de renaissance. La modernité ne sera mentionnée que bien plus tard : on
parle d’abord de renaissance.
La Renaissance vient du latin renovatio rénovation, restauration et en même temps
réforme. Ce terme est emprunté au vocabulaire des sociétés traditionnelles. Lorsque
Charlemagne est sacré empereur, on parle de renovatio de l’Empire de Romain au sein
du Saint Empire Romain Germanique. Ce terme de rénovation incarne dans un premier
temps la tradition : ce qui est juste et bien, c’est ce qui vient du passé, de l’Histoire, de la
transmission, de la continuité. Renovatio signifie bien cette conception du politique qui
ne trouve sa légitimité que parce qu’il est fondé sur l’Histoire. Tout autre modèle serait
immédiatement décrédibilisé. Au XVI, les intellectuels, les Humanistes changent ce sens,
en le définissant comme renaissance, rénovation, qui certes inclut une référence à une
naissance, à un passé, tout en se tournant vers le présent et l’avenir.
La Renaissance, c’est une Europe chrétienne suffisamment ébranlée pour ne plus
pouvoir s’appuyer sur le passé immédiat du Moyen-Age et qui a donc besoin de se situer
dans un autre passé : l’Antiquité, avec ses textes traduits en langues vernaculaires. Au
fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’Histoire, ces textes sont de mieux en mieux
connus. Ce corpus est immenses parce qu’il a développé une pensée laïc, dans l’ordre
laïc, alors que le Moyen Age avait mis ses forces dans la théologie. Au XVI, on remet en
cause cette science de Dieu, et il est donc extrêmement important d’avoir cette source
laïque venant de l’Antiquité. Les Humanistes se définissent par rapport à l’humain, en
pensant la civilisation de l’homme avec Dieu, mais pas submergées par Dieu, ce que
définit la pensée grecque. On constitue ici une nouvelle étape de l’avènement de
l’homme et de l’humanité. La modernité et la renaissance sont aussi l’avènement d’une
autre pensée, celle du progrès, donner un sens à l’Histoire. Avec les découvertes, on
s’inscrit dans un développement des sociétés qui vont vers un mieux. Le christianisme
avait écrit une histoire linéaire vers la réconciliation avec Dieu. Voilà que le nouvel Age
d’Or à atteindre n’est plus immédiatement la rencontre avec Dieu mais plus près, un
progrès pour s’inscrire dans l’humanité.

5
La Renaissance signifie bien entendu une disqualification du passé dont on vient : le
Moyen-Âge et ses crises. La renaissance signifie aussi une société qui se stabilise, qui
retrouve un développement – entre autres, économique – qui se place en rupture avec la
fin du Moyen-Age. C’est une première étape dans la construction de la civilisation de la
modernité.
Dans l’Antiquité, la pensée politique se fonde autour de la citoyenneté, l’appartenance à
une communauté politique. La distinction gouvernants/gouvernées est objet de débat.
Dans la Modernité politique, on retrouve cette distinction qui devient pour un long
moment infranchissable. On pense le politique du côté des gouvernants, et les gouvernés
vont mettre un temps important pour être reconnus. La notion d’Etat précède la
modernité politique : c’est le Moyen-Age chrétien qui a construit ces concepts politiques.
Ceux-ci, en simplifiant, demeurent longtemps soit la propriété de l’Eglise, soit de
l’Empereur (construire politiquement son pouvoir). Au Moyen-Age, seuls existent deux
pouvoirs politiques, légitimes car reposant sur une construction théorique,
intellectuelle. Le pouvoir de commandement premier, imperium, appartenait à
l’Empereur, notamment à travers le droit de guerre, l’utilisation de la force. D’un autre
côté, la souveraineté au sens de magistère suprême était du côté du pape. Ainsi, les
autres forces politiques, celles des princes, rois, ducs, comtes qui faisait l’ordre politique
du Moyen-Age leur étaient subordonnées. Ainsi, les rois princes et autres étaient des
seigneurs mais point des souverains. L’avènement de l’Etat et des grandes monarchies
européennes est le changement de statut dans l’ordre politique, du seigneur au
souverain. La souveraineté change alors de nature, se laïcise et se généralise entre des
points multiples : la souveraineté n’a donc plus ce caractère d’universalité qu’elle avait à
travers l’Eglise : la multiplicité des souverainetés est ce qui caractérise l’Europe. La
souveraineté est plurielle, permet de s’affirmer mais limite la souveraineté de chacun.
Parmi ceux qui conceptualisent ce changement, le plus important est Nicolas Machiavel,
« célèbre inconnu ».
Grand auteur, son œuvre, quantitativement, est relativement limité. Le Prince est un
ouvrage qui n’a pas la dimension des grands traités qui l’ont précédé et qui viendront
après. Au-delà du Prince, l’œuvre de Machiavel est surtout une méditation historique sur
un monde de l’Antiquité dont il s’estime en tant que citoyen de Florence et patriote
italien l’un des héritiers. On ne peut comprendre Nicolas Machiavel est que si l’on
comprend que c’est sans doute l’un des auteurs les plus iconoclastes, notamment par la
radicalité de ses positions laïques, dans son origine antique. Il pense la politique et la
société des hommes dans une séparation radicale avec la volonté divine, les institutions
de l’Eglise qui avaient fondé depuis des siècles l’ordre politique. Pour Machiavel, « tout
pouvoir vient de Dieu » n’a plus de sens. Il évacue la dimension religieuse du politique :
en cela, il est un auteur laïc, dans la démarche grecque qui faisait que le monde fini dans
lequel nous sommes était le seul horizon de l’Homme.
Un de ses disciples cachés deux siècles plus tard expliquera sans doute mieux sa
démarche : Jean-Jacques Rousseau. A propos de l’esprit de l’Antiquité, il affirmera « le
monde est vide depuis les Romains » : il renvoie toute la pensée construite au Moyen-Age
à la barbarie, à la périphérie du summum de la civilisation, soit l’Antiquité.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
1
/
65
100%