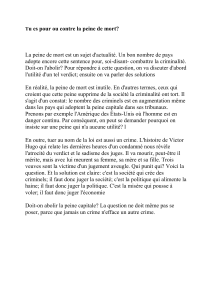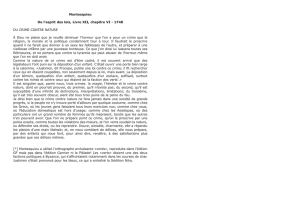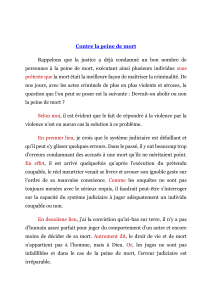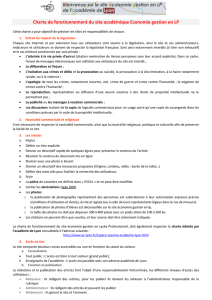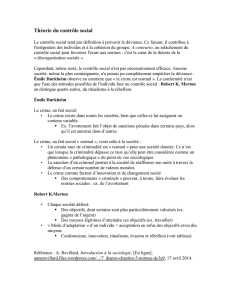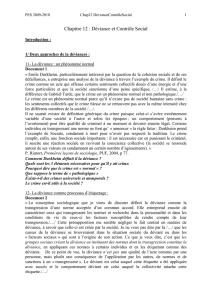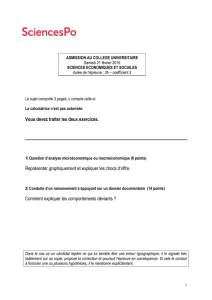ANALYSES SOCIOLOGIQUES DE LA DEVIANCE 1

ANALYSES SOCIOLOGIQUES DE LA DEVIANCE
1 - Becker, Gary (1993), "Voir la vie de façon économique", Journal des économistes et des études humaines, vol. 4, n° 2 &
3, juin/septembre
J'ai commencé à m'interroger sur le crime dans les années 1960 alors que je me rendais à l'Université de Columbia
pour la soutenance d'un étudiant en théorie économique. J'étais en retard et j'ai dû décider rapidement entre laisser
ma voiture dans un parking payant ou risquer une contravention pour l'avoir garée illégalement dans la rue. J'ai calcu-
lé la probabilité d'avoir une contravention, l'importance de l'amende et le coût d'une place de parking. J'ai décide de
prendre le risque et de me garer clans la rue. (Je n'ai pas eu de contravention). Comme je me dirigeais vers la salle
d'examen en marchant le long des bâtiments, il me vint à l'esprit que les autorités de la ville avaient probablement fait
la même analyse. La fréquence des inspections des véhicules en stationnement et l'importance de l'amende imposée
aux contrevenants devaient dépendre de leurs estimations des calculs effectués par les contrevenants potentiels
comme moi. Bien entendu, la première question que j'ai posée à ce malheureux étudiant fut d'élaborer le comporte-
ment optimal des délinquants et de la police, chose que je n'avais pas encore faite. Dans les années 1950 et 1960, les
discussions intellectuelles sur le crime étaient dominées par l'opinion qu'un comportement criminel était causé par
une maladie mentale ou une oppression sociale et que les criminels sont des « victimes » impuissantes. Un livre d'un
grand psychiatre était d'ailleurs intitulé « Le crime du châtiment ». De telles idées ont commence à exercer une in-
fluence considérable sur la politique sociale, en même temps que les lois ont été modifiées pour étendre les droits des
criminels. Ces changements ont réduit les craintes et les condamnations des criminels et ont procuré une protection
moindre à la population respectueuse de la loi. Je n'étais pas en sympathie avec l'hypothèse selon laquelle les crimi-
nels ont des motivations radicalement différentes du reste de la population. J'ai étudié plutôt les implications théo-
riques et empiriques de l'hypothèse que le comportement criminel est rationnel, mais une fois encore, « rationalisé »
ne signifiait pas matérialisme étroit. Elle reconnaissait que beaucoup de gens étaient contraints par des considérations
morales et éthiques et qu'ils ne commettaient pas de crimes, même si ceux-ci leur étaient profitables et ne pouvaient
être découverts. Toutefois, la police et les prisons seraient inutiles si de telles attitudes prévalaient toujours. La ratio-
nalité supposait que certains individus deviennent des criminels parce qu'ils comparent les récompenses financières
d'un crime et d'un travail légal, en tenant compte de la probabilité d'être appréhendés et condamnés, et de la sévérité
de la peine. La quantité de crimes est non seulement déterminée par la nationalité et les préférences des criminels
potentiels, mais également par l'environnement économique et social, créé par les politiques publiques, et qui com-
prennent les dépenses de police, les peines pour les différents crimes, les offres d'emploi, d'éducation et de formation.
En clair, le type d'emplois légaux disponibles, la loi, l'ordre et les peines représentent une partie intégrante de l'ap-
proche économique du crime. La dépense publique totale pour la lutte contre le crime peut être diminuée, tout en
conservant inchangée l'espérance mathématique de la peine, en compensant la réduction des dépenses pour la cap-
ture des criminels par une augmentation suffisante de la peine de ceux qui sont condamnés. […] Puisque peu de lois
sont respectées automatiquement, elles nécessitent des dépenses en condamnation et en peine pour dissuader les
violateurs. La commission américaine dénommée The United States Sentencing Commission a explicitement utilisé
l'analyse économique du crime pour développer les règles devant être appliquées par les juges afin de punir les viola-
teurs des lois fédérales. Les études de la criminalité utilisant l'approche économique sont devenues courantes durant
les vingt-cinq dernières années. On y trouve l'analyse ces peines marginales optimales pour prévenir des augmenta-
tions de la gravité des crimes – par exemple, pour dissuader un kidnappeur de tuer sa victime (la littérature moderne
débute avec Stigler) et l'analyse de la relation entre les sanctions privées et publiques des lois. Les amendes sont pré-
férables à l'emprisonnement et autres types de peine car elles sont plus efficaces. Avec l'amende, la peine des délin-
quants est aussi un revenu pour l'État. Les premières discussions sur des relations entre les amendes et les autres
peines ont été clarifiées et considérablement améliorées. Les évaluations empiriques des effets des conditions carcé-
rales, des taux de condamnation, du niveau de chômage, de l'inégalité des revenus et d'autres variables sur le taux de
criminalité sont devenues plus nombreuses et plus précises (le premier travail fut réalisé par Ehrlich et la littérature
ultérieure est abondante). Les plus grandes controverses tournent autour de la question de savoir si la peine capitale
dissuade les meurtres, une controverse qui est loin d'être résolue.
2 - Durkheim, Emile (1894), Les règles de la méthode sociologique, Paris, P.U.F., 14e édition, 1960, pp. 65-72
Le crime est normal, parce qu'une société qui en serait exempte est tout à fait impossible ; telle est la première évidence paradoxale que fait
surgir la réflexion sociologique.
S'il est un fait dont le caractère pathologique parait incontestable, c'est le crime. Tous les criminologistes s'entendent
sur ce point. S'ils expliquent cette morbidité de manières différentes, ils sont unanimes à la reconnaître. Le problème,
cependant, demandait à être traité avec moins de promptitude.
Appliquons, en effet, les règles précédentes. Le crime ne s'observe pas seulement dans la plupart des sociétés de telle
ou telle espèce, mais dans toutes les sociétés de tous les types. Il n'en est pas où il n'existe une criminalité. Elle
change de forme, les actes qui sont ainsi qualifiés ne sont pas partout les mêmes ; mais, partout et toujours, il y a eu

des hommes qui se conduisaient de manière à attirer sur eux la répression pénale. Si, du moins, à mesure que les
sociétés passent des types inférieurs aux plus élevés, le taux de la criminalité, c'est-à-dire le rapport entre le chiffre
annuel des crimes et celui de la population, tendait à baisser, on pourrait croire que, tout en restant un phénomène
normal, le crime, cependant, tend à perdre ce caractère. Mais nous n'avons aucune raison qui nous permette de croire
à la réalité de cette régression. Bien des faits sembleraient plutôt démontrer l'existence d'un mouvement en sens
inverse. Depuis le commencement du siècle, la statistique nous fournit le moyen de suivre la marche de la criminali-
té ; or, elle a partout augmenté. En France, l'augmentation est près de 300%. Il n'est donc pas de phénomène qui
présente de la manière la plus irrécusée tous les symptômes de la normalité, puisqu'il apparaît comme étroitement lié
aux conditions de toute vie collective. Faire du crime une maladie sociale, ce serait admettre que la maladie n'est pas
quelque chose d'accidentel, mais, au contraire, dérive, dans certains cas, de la constitution fondamentale de l'être
vivant ; ce serait effacer toute distinction entre le physiologique et le pathologique. Sans doute, il peut se faire que le
crime lui-même ait des formes anormales ; c'est ce qui arrive quand, par exemple, il atteint un taux exagéré. Il n'est
pas douteux, en effet, que cet excès ne soit de nature morbide. Ce qui est normal, c'est simplement qu'il y ait une
criminalité, pourvu que celle-ci atteigne et ne dépasse pas, pour chaque type social, un certain niveau qu'il n'est peut-
être pas impossible de fixer conformément aux règles précédentes.
Nous voilà en présence d'une conclusion, en apparence assez paradoxale. Car il ne faut pas s'y méprendre. Classer le
crime parmi les phénomènes de sociologie normale, ce n'est pas seulement dire qu'il est un phénomène inévitable
quoique regrettable, dû à l'incorrigible méchanceté des hommes ; c'est affirmer qu'il est un facteur de la santé pu-
blique, une partie intégrante de toute société saine. Ce résultat est, au premier abord, assez surprenant pour qu'il nous
ait nous-même déconcerté et pendant longtemps. Cependant, une fois que l'on a dominé cette première impression
de surprise, il n'est pas difficile de trouver les raisons qui expliquent cette normalité, et, du même coup, la confirment.
En premier lieu, le crime est normal parce qu'une société qui en serait exempte est tout à fait impossible.
Le crime, nous l'avons montré ailleurs, consiste dans un acte qui offense certains sentiments collectifs, doués d'une
énergie et d'une netteté particulières. Pour que, dans une société donnée, les actes réputés criminels pussent cesser
d'être commis, il faudrait donc que les sentiments qu'ils blessent se retrouvassent dans toutes les consciences indivi-
duelles sans exception et avec le degré de force nécessaire pour contenir les sentiments contraires. Or, à supposer
que cette condition pût être effectivement réalisée, le crime ne disparaîtrait pas pour cela, il changerait seulement de
forme ; car la cause même qui tarirait ainsi les sources de la criminalité en ouvrirait immédiatement de nouvelles.
En effet, pour que les sentiments collectifs que protège le droit pénal d'un peuple, à un moment déterminé de son
histoire, parviennent ainsi à pénétrer dans les consciences qui leur étaient jusqu'alors fermées ou à prendre plus
d'empire là où ils n'en avaient pas assez, il faut qu'ils acquièrent une intensité supérieure à celle qu'ils avaient jus-
qu'alors. Il faut que la communauté dans son ensemble les ressente avec plus de vivacité ; car ils ne peuvent pas
puiser à une autre source la force plus grande qui leur permet de s'imposer aux individus qui, naguère, leur étaient les
plus réfractaires. Pour que les meurtriers disparaissent, il faut que l'horreur du sang versé devienne plus grande dans
ces couches sociales où se recrutent les meurtriers ; mais, pour cela, il faut qu'elle devienne plus grande dans toute
l'étendue de la société. D'ailleurs, l'absence même du crime contribuerait directement à produire ce résultat ; car un
sentiment apparaît comme beaucoup plus respectable quand il est toujours et uniformément respecté.
Mais on ne fait pas attention que ces états forts de la conscience commune ne peuvent être ainsi renforcés sans que
les états plus faibles, dont la violation ne donnait précédemment naissance qu'à des fautes purement morales, ne
soient renforcées du même coup ; car les seconds ne sont que le prolongement, la forme atténuée des premiers. Ainsi,
le vol et la simple indélicatesse ne froissent qu'un seul et même sentiment altruiste, le respect de la propriété d'autrui.
Seulement ce même sentiment est offensé plus faiblement par l'un de ces actes que par l'autre ; et comme, d'autre
part, il n'a pas dans la moyenne des consciences une intensité suffisante pour ressentir vivement la plus légère de ces
deux offenses, celle-ci est l'objet d'une plus grande tolérance. Voilà pourquoi on blâme simplement l'indélicat tandis
que le voleur est puni. Mais si ce même sentiment devient plus fort, au point de faire taire dans toutes les consciences
le penchant qui incline l'homme au vol, il deviendra plus sensible aux lésions qui, jusqu'alors, ne le touchaient que
légèrement ; il réagira donc contre elles avec plus de vivacité ; elles seront l'objet d'une réprobation plus énergique
qui fera passer certaines d'entre elles, de simples fautes morales qu'elles étaient, à l'état de crimes. Par exemple, les
contrats indélicats ou indélicatement exécutés, qui n'entraînent qu'un blâme public ou des réparations civiles, devien-
dront des délits. Imaginez une société de saints, un cloître exemplaire et parfait. Les crimes proprement dits y seront
inconnus ; mais les fautes qui paraissent vénielles au vulgaire y soulèveront le même scandale que fait le délit ordi-
naire auprès des consciences ordinaires. Si donc cette société se trouve armée du pouvoir de juger et de punir, elle
qualifiera ces actes de criminels et les traitera comme tels. C'est pour la même raison que le parfait honnête homme
juge ses moindres défaillances morales avec une sévérité que la foule réserve aux actes vraiment délictueux. Autrefois,
les violences contre les personnes étaient plus fréquentes qu'aujourd'hui parce que le respect pour la dignité indivi-
duelle était plus faible. Comme il s'est accru, ces crimes sont devenus plus rares ; mais aussi, bien des actes qui lé-
saient ce sentiment sont entrés dans le droit pénal dont ils ne relevaient primitivement pas.
On se demandera peut-être, pour épuiser toutes les hypothèses logiquement possibles, pourquoi cette unanimité ne
s'étendrait pas à tous les sentiments collectifs sans exception ; pourquoi même les plus faibles ne prendraient pas
assez d'énergie pour prévenir toute dissidence. La conscience morale de la société se retrouverait tout entière chez
tous les individus et avec une vitalité suffisante pour empêcher tout acte qui l'offense, les fautes purement morales
aussi bien que les crimes. Mais une uniformité aussi universelle et aussi absolue est radicalement impossible ; car le

milieu physique immédiat dans lequel chacun de nous est placé, les antécédents héréditaires, les influences sociales
dont nous dépendons varient d'un individu à l'autre et, par suite, diversifient les consciences. Il n'est pas possible que
tout le monde se ressemble à ce point, par cela seul que chacun a son organisme propre et que ces organismes occu-
pent des portions différentes de l'espace. C'est pourquoi, même chez les peuples inférieurs, où l'originalité indivi-
duelle est très peu développée, elle n'est cependant pas nulle. Ainsi donc, puisqu'il ne peut pas y avoir de société où
les individus ne divergent plus ou moins du type collectif, il est inévitable aussi que, parmi ces divergences, il y en ait
qui présentent un caractère criminel. Car ce qui leur confère ce caractère, ce n'est pas leur importance intrinsèque,
mais celle que leur prête la conscience commune. Si donc celle-ci est plus forte, si elle a assez d'autorité pour rendre
ces divergences très faibles en valeur absolue, elle sera aussi plus sensible, plus exigeante, et, réagissant contre de
moindres écarts avec l'énergie qu'elle ne déploie ailleurs que contre des dissidences plus considérables, elle leur attri-
bue la même gravité, c'est-à-dire qu'elle les marquera comme criminels.
Le crime est donc nécessaire : il est lié aux conditions fondamentales de toute vie sociale, mais, par cela même, il est
utile ; car ces conditions dont il est solidaire sont elles-mêmes indispensables à l'évolution normale de la morale et du
droit.
En effet, il n'est plus possible aujourd'hui de contester que non seulement le droit et la morale varient d'un type
social à l'autre, mais encore qu'ils changent pour un même type si les conditions de l'existence collective se modifient.
Mais, pour que ces transformations soient possibles, il faut que les sentiments collectifs qui sont à la base de la mo-
rale ne soient pas réfractaires au changement, par conséquent, n'aient qu'une énergie modérée. S'ils étaient trop forts,
ils ne seraient plus plastiques. Tout arrangement, en effet, est un obstacle au réarrangement, et cela d'autant plus que
l'arrangement primitif est plus solide. Plus une structure est fortement accusée, plus elle oppose de résistance à toute
modification et il en est des arrangements fonctionnels comme des arrangements anatomiques. Or, s'il n'y avait pas
de crimes, cette condition ne serait pas remplie ; car une telle hypothèse suppose que les sentiments collectifs seraient
parvenus à un degré d'intensité sans exemple dans l'histoire. Rien n'est bon indéfiniment et sans mesure. Il faut que
l'autorité dont jouit la conscience morale ne soit pas excessive ; autrement, nul n'oserait y porter la main et elle se
figerait trop facilement sous une forme immuable. Pour qu'elle puisse évoluer, il faut que l'originalité puisse se faire
jour ; or pour que celle de l'idéaliste qui rêve de dépasser son siècle puisse se manifester, il faut que celle du criminel,
qui est au-dessous de son temps, soit possible. L'une ne va pas sans l'autre.
Ce n'est pas tout. Outre cette utilité indirecte, il arrive que le crime joue lui-même un rôle utile dans cette évolution.
Non seulement il implique que la voie reste ouverte aux changements nécessaires, mais encore, dans certains cas, il
prépare directement ces changements. Non seulement, là où il existe, les sentiments collectifs sont dans l'état de
malléabilité nécessaire pour prendre une forme nouvelle, mais encore il contribue parfois à prédéterminer la forme
qu'ils prendront. Que de fois, en effet, il n'est qu'une anticipation de la morale à venir, un acheminement vers ce qui
sera ! D'après le droit athénien, Socrate était un criminel et sa condamnation n'avait rien que de juste. Cependant son
crime, à savoir l'indépendance de sa pensée, était utile à préparer une morale et une foi nouvelles dont les Athéniens
avaient alors besoin parce que les traditions dont ils avaient vécu jusqu'alors n'étaient plus en harmonie avec leurs
conditions d'existence. Or le cas de Socrate n'est pas isolé ; il se reproduit périodiquement dans l'histoire. La liberté
de penser dont nous jouissons actuellement n'aurait jamais pu être proclamée si les règles qui la prohibaient n'avaient
été violées avant d'être solennellement abrogées. Cependant, à ce moment, cette violation était un crime, dans la
généralité des consciences. Et néanmoins ce crime était utile puisqu'il préludait à des transformations qui, de jour en
jour, devenaient plus nécessaires. La libre philosophie a eu pour précurseurs les hérétiques de toute sorte que le bras
séculier a justement frappés pendant tout le cours du Moyen Âge et jusqu'à la veille des temps contemporains.
De ce point de vue, les faits fondamentaux de la criminologie se présentent à nous sous un aspect entièrement nou-
veau. Contrairement aux idées courantes, le criminel n'apparaît plus comme un être radicalement insociable, comme
une sorte d'élément parasite, de corps étranger et inassimilable, introduit au sein de la société ; c'est un agent régulier
de la vie sociale. Le crime, de son côté, ne doit plus être conçu comme un mal qui ne saurait être contenu dans de
trop étroites limites ; mais, bien loin qu'il y ait lieu de se féliciter quand il lui arrive de descendre trop sensiblement
au-dessous du niveau ordinaire, on peut être certain que ce progrès apparent est à la fois contemporain et solidaire de
quelque perturbation sociale. C'est ainsi que jamais le chiffre des coups et blessures ne tombe aussi bas qu'en temps
de disette. En même temps et par contrecoup, la théorie de la peine se retrouve renouvelée ou, plutôt, à renouveler.
Si, en effet, le crime est une maladie, la peine en est le remède et ne peut être conçue autrement, aussi toutes les
discussions qu'elle soulève portent-elles sur le point de savoir ce qu'elle doit être pour remplir son rôle de remède.
Mais si le crime n'a rien de morbide, la peine ne saurait avoir pour objet de le guérir et sa vraie fonction doit être
cherchée ailleurs.
3 - Merton, Robert K. (1953), Éléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Plon, coll. ''Recherches en sciences
humaines", p. 177-181, extraits
La grande importance que la civilisation accorde au succès invite les individus à utiliser des moyens interdits mais
souvent efficaces pour arriver ne serait-ce qu'à un simulacre de réussite : richesse et pouvoir. Cette réaction a lieu
lorsque l'individu a accepté le but prescrit mis n'a pas fait siennes les normes sociales et les procédures coutumières.
L'individu tendu vers un but est prêt à prendre des risques, quelle que soit sa position dans la société ; mais on peut

se demander dans quels cas la structure sociale, par sa nature même, prédispose les individus à adopter un compor-
tement déviant. Chez les individus d'un niveau économique élevé, il n'est pas rare que la pression en faveur de l'inno-
vation rende imprécise la distinction entre les pratiques régulières et irrégulières. […]
L'histoire des grandes fortunes américaines est celle d'individus tendus vers des innovations d'une légitimité douteuse.
L'admiration que les gens éprouvent malgré eux pour ces hommes malins et habiles (smart), et qui réussissent, s'ex-
prime souvent en privé et même en public : c'est le produit d'une civilisation dans laquelle la fin sacro-sainte justifie
les moyens. […]
Les statistiques officielles sur la criminalité font régulièrement apparaître une plus grande proportion de crimes dans
les couches les plus basses ; elles sont loin d'être complètes et sûres. Cependant, d'après notre analyse, les plus fortes
pressions en faveur de la déviance s'exercent certainement sur les couches sociales inférieures. Plusieurs recherches
ont montré que certaines formes du vice et du crime constituent une réaction « normale » à une situation dans la-
quelle les individus se trouvent dans la quasi-impossibilité d'employer des moyens légitimes et traditionnels qui leur
permettraient de réaliser la réussite financière que la civilisation leur présente comme un but désirable. Les possibili-
tés professionnelles de ces individus sont en général limitées aux emplois les moins nobles. Etant donné le mépris
des Américains pour le travail manuel – mépris qui est uniformément partagé par toutes les classes sociales – et le
peu d'espoir qu'il y a à ce niveau de s'élever socialement, il est normal que l'on tende à adopter un comportement
déviant. Le revenu et les promesses de puissance que peuvent apporter à l'individu le vice organisé, les rackets et les
crimes sont sans commune mesure avec sa situation actuelle. Bien que notre idéologie de classes ouvertes et de la
mobilité sociale persiste à le nier, pour ceux qui sont situés au plus bas niveau de la structure sociale, la civilisation
impose des exigences contradictoires. D'une part on leur demande d'orienter leur conduite vers la richesse (« Tout
homme doit être roi ») et d'autre part on leur en refuse les moyens légaux. La conséquence de cette incohérence est
une proportion élevée de comportements déviants. Dans ce contexte, Al Capone représente le triomphe de l'intelli-
gence amorale sur les « échecs » dus à une conduite morale dans une société où les canaux qui assurent la mobilité
sociale sont trop fermés ou trop étroits, et où tous les individus sont invités à concourir pour obtenir le grand prix de
la réussite économique et sociale.
4 - Foucault, Michel (1975), Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, coll. ''Tel", p. 202-208, extraits
Toute une problématique se développe alors : celle d'une architecture qui n'est plus faite simplement pour être vue
(faste de palais), ou pour surveiller l'espace extérieur (géométrie des forteresses), mais pour permettre un contrôle
intérieur, articulé et détaillé – pour rendre visibles ceux qui s'y trouvent ; plus généralement, celle d'une architecture
qui serait un opérateur pour la transformation des individus : agir sur ceux qu'elle abrite, donner prise sur leur con-
duite, reconduire jusqu'à eux les effets du pouvoir, les offrir à une connaissance, les modifier. Les pierres peuvent
rendre docile et connaissable. Au vieux schéma simple de l'enfermement et de la clôture – du mur épais, de la porte
solide qui empêchent d'entrer ou de sortir – commence à se substituer le calcul des ouvertures, des pleins et des vides,
des passages et des transparences. C'est ainsi que l'hôpital-édifice s'organise peu à peu comme instrument d'action
médicale : il doit permettre de bien observer les malades, donc de mieux ajuster les soins ; la forme des bâtiments,
par la soigneuse séparation des malades, doit empêcher les contagions ; la ventilation et l'air qu'on fait circuler autour
de chaque lit doivent enfin éviter que les vapeurs délétères ne stagnent autour du patient, décomposant ses humeurs
et multipliant la maladie par ses effets immédiats. L'hôpital […] n'est plus simplement le toit où s'abritaient la misère
et la mort prochaine ; c'est, dans sa matérialité même, un opérateur thérapeutique. […] L'appareil disciplinaire parfait
permettrait à un seul regard de tout voir en permanence. Un point central serait à la fois source de lumière éclairant
toutes choses, et lieu de convergence pour tout ce qui doit être su : œil parfait auquel rien n'échappe et centre vers
lequel tous les regards sont tournés. C'est ce qu'avait imaginé Ledoux construisant Arc-et-Senans : au centre des
bâtiments disposés en cercle et ouvrant tous vers l'intérieur, une haute construction devait cumuler les fonctions
administratives de direction, policières de surveillance, économiques de contrôle et de vérification, religieuses d'en-
couragement à l'obéissance et au travail ; de là viendraient tous les ordres, là seraient enregistrées toutes les activités,

perçues et jugées toutes les fautes ; et cela sans presque aucun autre support qu'une géométrie exacte. Parmi toutes
les raisons du prestige qui fut accordé, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, aux architectures circulaires, il
faut sans doute compter celle-ci : elles exprimaient une certaine utopie politique. […] La surveillance hiérarchisée,
continue et fonctionnelle n'est pas, sans doute une des grandes « inventions » techniques du XVIIIème siècle, mais
son insidieuse extension doit son importance aux nouvelles mécaniques de pouvoir qu'elle porte avec soi. Le pouvoir
disciplinaire, grâce à elle, devient un système « intégré », lié de l'intérieur à l'économie et aux fins du dispositif où il
s'exerce. Il s'organise aussi comme un pouvoir multiple, automatique et anonyme ; car s'il est vrai que la surveillance
repose sur des individus, son fonctionnement est celui d'un réseau de relations de haut en bas, mais aussi jusqu'à un
certain point de bas en haut et latéralement ; ce réseau fait « tenir » l'ensemble, et le traverse intégralement d'effets de
pouvoir qui prennent appui les uns sur les autres : surveillants perpétuellement surveillés. Le pouvoir dans la surveil-
lance hiérarchisée des disciplines ne se détient pas comme une chose, ne se transfère pas comme une propriété ; il
fonctionne comme une machinerie. […] Grâce aux techniques de surveillance, la « physique » du pouvoir, la prise sur
le corps s'effectue selon les lois de l'optique et de la mécanique, selon tout un jeu d'espaces, de lignes, d'écrans, de
faisceaux, de degrés, et sans recours, en principe au moins, à l'excès, à la force, à la violence. Pouvoir qui est en appa-
rence d'autant moins « corporel » qu'il est plus savamment « physique ».
5 - Becker, Howard S. (1963), Outsiders. Études de sociologie de la déviance, (1985), Paris, Métailié, p. 43-45, extraits
Il n'est pas ici dans mon intention de soutenir que les seuls actes « réellement » déviants sont ceux que les autres
considèrent comme tels. Toutefois on doit reconnaître que cet aspect est important et qu'il faut en tenir compte dans
toute analyse du comportement déviant. En combinant cette dimension avec le critère de la conformité (ou non-
conformité) d'un acte à une norme particulière, on peut construire le tableau ci-dessous qui permet de distinguer
différents types de déviance.
Deux de ces types ne demandent guère d'explication. Le comportement conforme est simplement celui qui respecte
la norme et que les autres perçoivent ainsi ; à l'opposé, le comportement pleinement déviant est celui qui enfreint la
norme et qui est perçu comme tel.
Les deux autres possibilités sont plus intéressantes. Dans la situation de celui qui est accusé à tort, les autres croient
que la personne a commis une action irrégulière alors qu'en fait il n'en est rien. Il se produit sans aucun doute de
fausses accusations même dans les tribunaux, où les individus sont protégés par les règles des voies de droit et du
témoignage. Il s'en produit probablement encore plus souvent dans les situations extra-judiciaires, là où les individus
ne disposent pas des garanties de la procédure.
Le cas opposé de la déviance secrète est encore plus intéressant. Ici, un acte irrégulier est bel et bien commis, mais il
n'est perçu par personne comme une transgression des normes et n'entraîne aucune réaction. Comme pour la fausse
accusation, nul ne connaît vraiment l'extension du phénomène, mais je suis convaincu qu'elle est très importante,
beaucoup plus importante que nous ne pouvons l'imaginer. […] Ceux qui étudient l'homosexualité ont observé […]
que nombre d'homosexuels sont capables de dissimuler leur déviance aux non-déviants qu'ils fréquentent. De nom-
breuses personnes qui prennent des stupéfiants sont aussi capables, on le verra, de cacher leur toxicomanie aux
membres de leur entourage qui ne se droguent pas.
Les quatre types de déviance, constitués en croisant la nature du comportement avec les réactions qu'il suscite, dis-
tinguent des phénomènes qui diffèrent par des aspects importants. Mais ces différences sont en général négligées et
les explications des phénomènes qui sont proposés s'avèrent en conséquence inadéquates. Un garçon qui, en toute
innocence, tourne autour d'un groupe délinquant peut être arrêté un soir avec celui-ci sur des présomptions. Il figu-
rera dans les statistiques officielles comme délinquant aussi sûrement que ceux qui ont effectivement participé à une
action répréhensible et les chercheurs en sciences sociales qui tentent d'élaborer des théories explicatives de la délin-
quance essaieront de rendre compte de sa présence dans les fichiers officiels selon des raisonnements identiques à
ceux par lesquels ils rendent compte de la présence des autres. Les deux cas sont pourtant différents et la même
explication ne peut leur convenir.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%