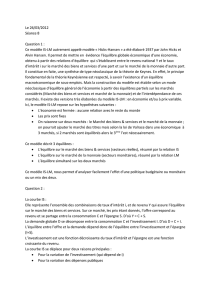IV-3. « Substitution » en termes de fonctions monétaires

Chapitre 1
23
Chapitre 1
Le « curriculum vitae » d’une monnaie
– synthèse de son évolution nationale et internationale
Au chapitre 1, nous commencerons, dans les deux premières sections, par dresser un
bilan de l’évolution historique de la monnaie, objet clé de nos analyses dans cette thèse.
Nous apporterons un éclairage, dans un premier temps, sur la raison d’être de l’invention de la
monnaie comme solution au problème d’inefficacité du système de troc, et dans un deuxième
temps sur le pourquoi et le comment de l’évolution de la monnaie, de sa forme métallique
jusqu’à sa forme fiduciaire et nationale, cette dernière constituant le standard monétaire de
nos jours. Ce bilan historique nous permettra de mettre en évidence ensuite, dans la troisième
section, les éléments cruciaux servant à établir une synthèse du concept de « monnaie
nationale ». Trois approches y seront proposées afin de mieux définir et comprendre la
nature d’une monnaie nationale. Elles viseront à rendre plus faciles et plus pertinentes nos
analyses dans la quatrième section, où, prenant comme base notre définition synthétique
d’une monnaie nationale, nous présenterons, par le biais de nouvelles interprétations de la
notion de « substitution monétaire », les formes possibles de dynamiques de change sur la
scène internationale. Tous ces éléments analytiques nous aideront, à la fin du chapitre, à
établir le « curriculum vitae » complet d’une monnaie nationale, lequel constituera le
fondement de notre analyse tout au long de la présente thèse.
I. L’évolution monétaire : du troc à la monnaie métallique
Au fil de l’histoire monétaire, nous observons trois phases représentatives qui se sont
succédées. Il s’agit tout d’abord du troc, ensuite de l’utilisation des monnaies marchandises
et métalliques, et enfin de l’expansion des monnaies fiduciaires qui deviennent le standard
monétaire dans la société moderne. Nous cherchons, dans cette section ainsi que dans la

Chapitre 1
24
section suivante, à comprendre pourquoi la monnaie a évolué d’une telle façon. Dans cette
première section nous commençons par étudier la transition entre le troc et l’émergence de la
monnaie marchandise d’abord, de la monnaie métallique ensuite.
I-1. Le troc : inefficacité du système
Parmi toutes les activités économiques créées par les êtres humains, l’échange, ou la
transaction dans un langage moins spécialisé, constitue le moteur crucial qui fait avancer ces
agents économiques et leurs économies
1
. Un échange peut se décrire selon deux dimensions.
Pour la première, il s’agit de la dimension spatiale (une transaction entre deux agents). Quant
à la seconde, c’est la dimension temporelle (un échange instantané ou un échange entre le
présent et le futur) qui se manifeste. Dans une économie idéale où existe une certitude totale
au regard de l’échange (c’est-à-dire que les informations concernant l’échange sont complètes
pour les agents concernés), les agents économiques peuvent échanger leurs marchandises
directement entre eux, car le système d’information sert lui-même d’intermédiaire suffisant et
efficace pour assurer le fonctionnement de la transaction. En d’autres termes, l’information
sert de moyen d’échange implicite dans une telle économie. Ce système d’échange direct est
en fait le troc.
Cette forme d’échange, l’une des plus primitives de l’histoire humaine, est pourtant
souvent porteuse d’inconvénients et d’obstacles significatifs qui condamnent le processus
d’échanges entre agents économiques, parce que l’incertitude existe dans notre économie de
manière permanente. D’une part, ces agents ne sont jamais certains de trouver leurs
homologues potentiels
2
dans un troc traditionnel. Cette incertitude se traduit ainsi par
l’existence des coûts de recherches, directement liés au procédé d’échange. D’autre part,
même si un homologue potentiel est trouvé, comme le souligne Alchian (1977), l’agent
économique n’est pas toujours un expert de la qualité des marchandises qu’il souhaite
acquérir par un échange. Son incertitude sur la qualité des contreparties en question nécessite
de sa part un recours à l’expertise, laquelle entraîne des coûts d’identification
3
.
1
Sauf dans une économie « à la Robinson Crusoé ».
2
Le terme « potentiel » signifie que l’échange peut, pour un certain agent économique, se réaliser au regard
de la « quantité » et de la « catégorie » (nous ne parlons donc pas encore de qualité) du bien concerné.
3
Ici nous parlons de l’échange instantané dans l’économie du troc, c’est-à-dire du paiement immédiat sous
forme d’échange direct. En cas de paiements par crédit, la crédibilité des agents concernés devient un élément
supplémentaire dans le calcul des coûts d’identification.

Chapitre 1
25
Les coûts engendrés dans un tel processus d’échange correspondent, en fait, aux « coûts
informationnels de transaction » issus de l’absence d’informations complètes (d’où
l’incertitude) relatives à l’échange. Il existe certes d’autres catégories de coûts de transactions
n’ayant aucun lien avec l’existence de l’incertitude, entre autres, les coûts de transports liés à
la contrainte géographique. Mais ce sont essentiellement ces coûts informationnels de
transaction que les agents économiques sont obligés de supporter dans le troc, pour que les
obstacles à l’échange s’éliminent et que l’échange ait lieu. En cas de présence prohibitive de
coûts informationnels de transactions, le processus de l’échange est interrompu, ce qui
représente en conséquence le problème central relatif à l’efficacité du système de troc.
Inversement, la conclusion d’un échange dans le troc peut être considérée comme une sorte de
« double coïncidence des besoins » des deux agents concernés, ce qui implique que
l’aboutissement d’un échange direct entre deux marchandises se fasse presque toujours par un
processus long et incertain de tâtonnements, qui, en pratique, se traduisent par la présence de
coûts informationnels de transaction non négligeables. En résumé, le fonctionnement du troc
est loin d’être efficace.
I-2. La monnaie : un système alternatif
Des solutions existent pourtant pour résoudre le problème d’inefficacité du troc, ou au
moins pour en diminuer l’ampleur. En ce qui concerne les coûts non informationnels comme
le coûts de transport, c’est le progrès technologique qui a pour effet de les réduire. Les coûts
informationnels de transaction, quant à eux, exigent un système alternatif d’échanges pour
qu’une transaction réussie ne soit plus une simple « double coïncidence des besoins » entre
deux agents économiques ; c’est l’introduction d’une certaine marchandise jouant le rôle d’un
intermédiaire commun dans l’échange. Ce système permet d’améliorer directement le
problème issu de l’inefficacité du troc par une diminution significative des coûts de
recherches et des coûts d’identification. Cette marchandise intermédiaire est la monnaie,
dont l’utilisation améliore l’efficacité du processus d’échange.
D’un côté, les coûts de recherches sont diminués, grâce à la simplification et à la
standardisation du processus d’échange. En effet, avec cette « marchandise intermédiaire »,
l’échange de marchandises prend désormais la forme de deux transactions standardisées :
entre cette marchandise intermédiaire et une marchandise « normale » quelconque. Le
problème de « coïncidence des besoins » n’est plus, par conséquent, double ; il ne s’agit plus
que d’une simple « coïncidence » entre un vendeur (l’offre) et un acheteur (la demande) face

Chapitre 1
26
à la même marchandise. Ce changement en matière de processus d’échange a pour effet de
rendre les marchés de marchandises davantage « individualisés » et « spécialisés », lesquelles
évolueront de manière plus dynamique et plus efficace que ceux dans le troc.
De l’autre, il s’agit de la réduction des coûts d’identification, réduction faisant suite à
l’adoption du système alternatif au troc. Cette réduction est néanmoins moins évidente. En ce
qui concerne les marchandises « normales », la nature du problème relatif à l’identification de
leur qualité demeure inchangée. Quant à l’identification de la qualité de la monnaie, c’est le
choix de cette marchandise intermédiaire qui s’avère crucial dans la diminution des coûts
d’identification. Parmi les « candidats » possibles, les métaux précieux, par rapport à d’autres
marchandises utilisées comme monnaies, sont sans doute les plus « prometteurs » grâce à leur
durabilité, leur divisibilité, ainsi que leur portabilité. Cependant, comme le suggère Goodhart
(1997), les coûts d’identification pour une monnaie métallique peuvent parfois être beaucoup
plus élevés que pour des marchandises « normales » comme la farine, le sucre, le sel, etc.
Cette ambiguïté n’est résolue que grâce à l’introduction de la technologie de monnayage : la
standardisation de la « qualité » de la monnaie métallique qui a considérablement contribué à
la minimisation des coûts d’identification propres à la monnaie métallique en tant que
marchandise intermédiaire.
En résumé, nous avons montré que l’usage de la monnaie marchandise, puis l’adoption
de la monnaie métallique standardisée, ont résolu en partie le problème d’inefficacité du troc
dans les activités d’échanges économiques. Cela représente une évolution importante et
reflète la recherche perpétuelle que font des êtres humains d’une meilleure efficacité dans le
fonctionnement de la société. Cependant, le résultat de cette dynamique monétaire est loin
d’être définitif, car l’évolution de la monnaie s’accompagne, au fil de notre histoire, de
mutations géopolitiques. Dans la section suivante nous allons démontrer pourquoi émerge la
monnaie fiduciaire émise par l’Etat, choix final qui prédomine dans le monde monétaire
contemporain.
II. L’émergence de la monnaie fiduciaire nationale
Dans les sociétés modernes, l’évolution monétaire se termine par le remplacement de la
monnaie métallique qui prédominait encore dans le monde il y a peu de temps, par la
monnaie fiduciaire. Pour mieux expliquer ce tournant, il faut examiner le côté « offre » de la
monnaie en tant que « marchandise intermédiaire » qui sert à faciliter les échanges entre
agents économiques.

Chapitre 1
27
II-1. L’offre monétaire : une division centralisée du travail
Dans la sous-section I-2, nous avons constaté que les coûts de recherches engendrés
dans un processus d’échange pouvaient être réduits par la simple introduction du système
monétaire à la place du troc, tandis que le problème relatif aux coûts d’identification pouvait
se résoudre grâce à la standardisation de la monnaie en tant que marchandise intermédiaire.
Cette « standardisation » révèle, en fait, une tendance inéluctable de la centralisation au
regard de la « production monétaire », à savoir une offre centralisée de la monnaie, afin
d’atteindre une efficacité encore meilleure dans l’organisation des activités économiques.
Dans ce contexte, le « marché de la monnaie » peut, en pratique, se diriger vers deux modes
de production : soit l’émergence d’un monopole émettant la monnaie standardisée, soit la
mise en place d’un cartel entre plusieurs producteurs qui s’allient pour fournir des monnaies à
caractère identique.
Le travail du producteur monétaire, sous forme de monopole ou de cartel, peut en
théorie être entrepris par tous les agents économiques capables de maintenir, en termes de
qualité, cette « standardisation », décisive dans l’évolution monétaire. Comme il s’agit d’un
maintien perpétuel de la crédibilité de l’émetteur monétaire, seul l’Etat, dont le pouvoir se
renforce davantage au fil des derniers siècles, se situe dans la meilleure position, par
opposition à tous les agents privés susceptibles de proposer le service de l’offre monétaire.
Bénéficiant de cet avantage en termes de crédibilité, l’Etat, en tant qu’émetteur de la monnaie
standardisée, peut choisir en toute liberté la meilleure forme de monnaie en termes de profits.
La monnaie fiduciaire sous forme de billets étant beaucoup moins coûteuse que la monnaie
métallique, elle devient sans surprise le choix final de l’autorité officielle. Les coûts
d’identification sont réduits au minimum, pourvu que la standardisation de la monnaie
étatique soit crédible comme dans le cas de la monnaie métallique.
Mais le secteur privé, précisément le secteur bancaire qui s’est développé
progressivement, participe également à la « production » monétaire avec l’Etat. Il s’agit, en
fait, du domaine de l’offre de monnaie scripturale sous forme de crédits. On parvient ainsi à
une division du travail, pourtant centralisée sous le contrôle de l’Etat, dans l’offre de la
monnaie. D’un côté, le gouvernement en tant que « monopole naturel » émet la monnaie
fiduciaire avec les politiques nécessaires pour minimiser le risque de crises monétaires (c’est-
à-dire établir sa crédibilité), de l’autre, les banques créent des crédits (monnaies scripturales)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%