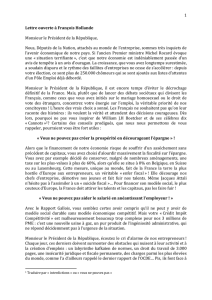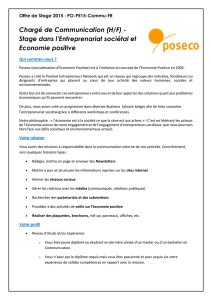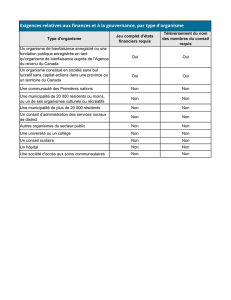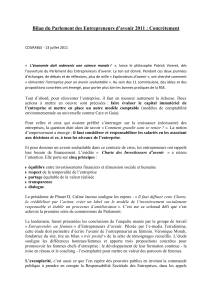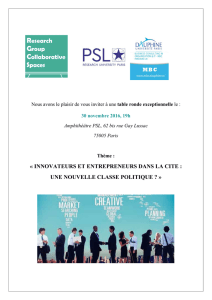Over the last 200 years, there has been great debate between those

- 1 -
Pour diffusion immédiate
Le 8 novembre 2007
Notes d’allocution pour le très honorable
Paul Martin, C.P., député,
Laisser libre cours au pouvoir de l’entreprise sociale
Toronto (Ontario)
L’allocution peut différer
C’est un grand plaisir pour moi d’être ici avec vous cet après-midi et un grand
honneur d’avoir été invité par la merveilleuse et formidable Janice Stein à donner une
conférence au Munk Centre.
Avant de commencer, un mot à ma défense! Je suis devenu un partisan de
l’entreprise sociale et j’expliquerai comment j’en suis arrivé là au cours de mon
allocution. Mais comme celle-ci sera suivie d’une période de questions et de
commentaires, j’aimerais signaler la présence parmi nous d’un certain nombre de tenants
de l’entreprise sociale qui s’efforcent de briser les chaînes de la pensée conventionnelle
depuis longtemps, certainement depuis bien plus longtemps que moi. Étant donné leur
expérience et leurs connaissances, ce sont eux qui devraient parler et moi écouter.
J’espère vraiment qu’ils prendront la parole d’ici la fin de l’après-midi.

- 2 -
Un débat interminable oppose depuis 150 ans les tenants du marché libre et les
adeptes du socialisme. Il est maintenant clair que le marché libre a remporté la partie, et
ce, parce qu’à la base, il favorise l’épanouissement de l’ambition individuelle et de
l’entrepreneuriat. En cela, il ressort vainqueur.
Cela étant dit, mettons les choses au clair. Ce n’est pas le marché libre dans son
essence même qui ressort vainqueur. Nous ne sommes pas dans une économie
darwinienne et quiconque a un grain de bon sens ne saurait recommander cette voie.
Le fait est que les pays développés dépendent tous largement du gouvernement,
d’une manière ou d’une autre, pour la prestation de biens publics, comme l’éducation
universelle aux niveaux primaire et secondaire et l’infrastructure publique, pour ne
nommer que ceux-là.
Peu de gens nieraient donc aujourd’hui l’importance de l’État pour la prestation
des intrants sociaux qui permettent la croissance de l’économie moderne. Ce qu’on
reconnaît moins bien toutefois, c’est la contribution d’un autre intervenant clé dans la
structure socioéconomique, à savoir le secteur de la bienfaisance, qui joue un rôle
essentiel en cherchant à aplanir les inégalités inacceptables qui découlent d’un
désavantage intrinsèque ou souvent des retombées du marché libre.
En fait, le rôle important des organismes de bienfaisance, bénévoles et sans but
lucratif semble un secret au Canada, une vérité cachée. Or, mis ensemble, ces organismes
représentent, en tant que pourcentage de la population, le deuxième secteur en importance
dans le monde. Ils constituent également un gigantesque employeur qui compte plus de
deux millions de travailleurs rémunérés. C’est presque autant de Canadiens que tout le
secteur manufacturier et deux fois et demie le nombre de travailleurs du secteur de la

- 3 -
construction. Ils représentent près de huit pour cent du PIB du Canada – c’est plus que le
secteur du commerce de détail, plus que les industries minière, gazière et pétrolière
réunies.
Ils représentent également, à tant d’égards, la conscience sociale du pays. Pour
toutes ces raisons, il est évident que notre société serait beaucoup plus pauvre tant sur le
plan moral que sur le plan économique si elle ne pouvait compter sur les organismes de
bienfaisance et sans but lucratif. Le besoin que comblent ces organismes ne cessera de
grandir, et nous devons adapter en conséquence le soutien que nous leur accordons.
Par ailleurs, je crois que nous avons à peine effleuré les contours du plein
potentiel du secteur de la bienfaisance dans toutes ses permutations et combinaisons et de
ce qu’il pourrait représenter pour la société canadienne en évolution. Voilà ce dont
j’aimerais vous entretenir aujourd’hui. Plus précisément, je veux vous parler des
entreprises sociales, c’est-à-dire des organismes qui puisent, d’une part, dans les objectifs
des organismes de bienfaisance bien établis et, d’autre part, dans les principes de gestion
du secteur privé, incluant dans certains cas la nécessité d’assurer la croissance en
affichant des profits et la possibilité d’offrir un rendement financier de l’investissement.
À l’instar des autres entreprises, les « entreprises sociales » font le commerce de
biens et services, et font ainsi de l’argent. Par contre, faire de l’argent n’est pas leur
objectif principal. C’est le moyen qui justifie une fin supérieure. Le principal rendement
de l’investissement se traduit par leur rendement social ou environnemental, fondé sur
des résultats financiers doubles, voir triples dans le meilleur des cas. C’est l’importance
accordée au rendement plus profond qui les distingue des nombreuses sociétés dont les

- 4 -
activités peuvent donner un rendement social ou environnemental, mais dont l’objectif
principal est le profit.
Où est donc le problème, demanderez-vous? Il réside dans les règlements qui
régissent le secteur de la bienfaisance. Prenons par exemple, pour simplifier quelque peu
les choses, la Loi de l’impôt sur le revenu, qui fixe des règles pour trois catégories
d’organismes : d’abord, les particuliers et les sociétés qui paient de l’impôt; ensuite, les
organismes sans but lucratif qui ne paient pas d’impôt; finalement, les œuvres de
bienfaisance conventionnelles qui ne paient pas d’impôt et qui jouissent d’un avantage
supplémentaire, celui de pouvoir remettre aux donateurs des reçus d’impôt pour activités
de bienfaisance. Ces catégories d’organismes ont joué un rôle important dans la
croissance des dons de charité au Canada. Cela étant dit, les limites historiques qu’elles
fixent pose aujourd’hui problème, car elles n’ont pas suivi l’évolution du domaine social
qu’elles cherchent à servir.
En termes généraux, alors que nous cherchons de nouvelles façons de répondre
aux besoins de la population, tout simplement, les limites traditionnelles entravent
l’innovation. Dans le cas précis des entreprises sociales, elles ne tiennent pas compte des
possibilités d’attirer de nouvelles formes de capital qui ne pourraient autrement se
présenter.
En voici deux exemples.
Il y a peu de temps, je me suis rendu chez Eva’s Phoenix Print Shop, ici à
Toronto. Ce n’est pas une grosse entreprise et, honnêtement, rien ne permet de la
distinguer des autres petits ateliers d’imprimerie, si ce n’est une chose. Pour vous y
rendre, vous devez traverser à pied Eva’s Phoenix, un centre que des jeunes âgés d’à

- 5 -
peine seize ans appellent leur chez soi. Bon nombre d’entre eux ont souffert de
l’éclatement familial ou ont été victimes d’abus sexuels ou physiques. Beaucoup sont aux
prises avec des problèmes de toxicomanie et certains sont de jeunes contrevenants.
Quand ils aboutissent à Eva’s Phoenix, ils sont désespérés.
Mais là, on leur offre espoir, refuge et soutien. Et l’atelier d’imprimerie leur offre
bien plus : une formation intensive en cours d’emploi dans un domaine qui a besoin de
travailleurs. Au terme du programme de formation, certains jeunes sont embauchés sur
place; d’autres trouvent un emploi ailleurs dans des ateliers d’imprimerie. D’autres
encore vont au collège ou à l’université, la plupart munis d’une bourse d’Eva’s Phoenix.
Comme dans bien des cas, le problème est que l’atelier d’imprimerie pourrait
maintenant élargir sa capacité de venir en aide à davantage de jeunes, mais il a besoin de
capital additionnel pour le faire. Dans le système actuel, il n’a pour toute solution que
d’intensifier ses efforts de collecte de fonds. Mais un modèle différent, un modèle qui a
permis à l’atelier d’imprimerie d’Eva d’élargir sa base en empruntant de l’argent à des
investisseurs ou même en achetant des actions, aiderait considérablement à recueillir de
façon plus durable les fonds nécessaires à l’expansion et permettrait même d’affecter les
fonds recueillis à des fonctions qui ne s’inscrivent pas dans le modèle d’affaires de
l’entreprise. En bref, si l’entreprise adoptait un tel modèle, elle pourrait rapidement être
en mesure de venir en aide à beaucoup plus de jeunes et pourrait reproduire son modèle
dans d’autres villes du pays comme elle ambitionne de le faire.
Le second exemple est un projet d’une toute autre envergure, réalisé dans une
autre province et ayant un champ de mire totalement différent de celui de l’exemple
précédent. La forêt pluviale Great Bear en Colombie-Britannique est la plus grande forêt
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%