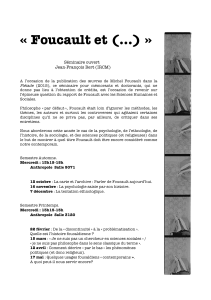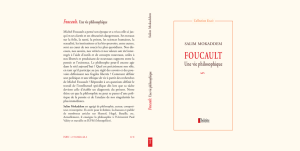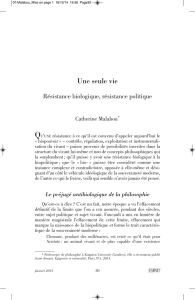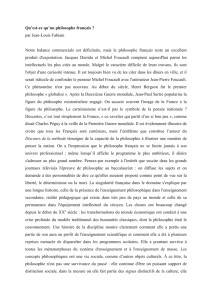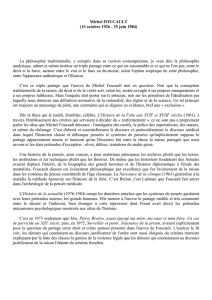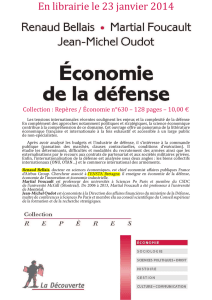Puissances de la variation mardi 8 février 2005, par Maurizio

Puissances de la variation
mardi 8 février 2005, par Maurizio Lazzarato
url:http://seminaire.samizdat.net/article.php3?id_article=58
Pour saluer la publication de son dernier livre, Les Révolutions du capitalisme (Les
empêcheurs de penser en rond, 2004), Multitudes a réalisé une interview originale de
Maurizio Lazzarato, lui donnant l’occasion de faire le point sur son intérêt pour la
pensée de Gabriel Tarde (qui faisait l’objet de son livre précédent, Puissances de
l’invention. La psychologie économique de Gabriel Tarde contre l’économie politique,
paru également chez Les empêcheurs de penser en rond en 2002), de contribuer aux
débats actuels sur la place du “ commun ” dans la théorie de la Multitude, et
d’esquisser quelques-unes des pistes qui feront l’objet de ses réflexions à venir.
Multitudes : Dans tes derniers deux livres, il est beaucoup question de Tarde.
Pourquoi revenir à cet auteur vieux d’un siècle, dont les positions politiques
n’étaient pas particulièrement progressistes ?
Maurizio Lazzarato : Il s’est agi plutôt pour moi de travailler sur une série de théories
et d’auteurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe : Tarde, mais aussi Bergson
(dans Vidéophilosophie), Nietzsche, le pragmatisme américain, Péguy. En réalité,
entre la Commune de Paris et la première guerre mondiale, il y a un renouvellement
de la pensée qui correspond à la clôture du cycle de luttes du XIXe siècle, dont la
théorie marxienne est le moment théorique le plus significatif. La naissance de la
philosophie de la différence, et celle, avec Tarde, d’une théorie sociale de la
multiplicité, sont plantées dans un énorme essor d’intégration de l’économie monde
(grande mobilité des capitaux et grands mouvements migratoires trans-océaniques
avec, à l’intérieur de l’Europe, le développement des moyens de transport et de
communication), essor qui sera interrompu par la première guerre mondiale. Pour
atteindre le même niveau de mondialisation de l’économie, il faudra attendre les
années 1980. En effet, le XXe siècle a été le siècle des guerres (première, deuxième,
guerre froide) et les nouveaux rapports sociaux que la théorie de la différence avait
saisis se sont trouvés surdéterminés par la logique de guerre, d’abord par le rapport
ami/ennemi et par la suite, pendant la guerre froide, par la relation dialectique
capital-travail. C’est seulement autour des mouvements de 68, qui annoncent la fin de
la guerre froide, que la philosophie de la différence contemporaine retournera à tous
ces auteurs et à cette époque, ensevelis par la logique de guerre. A l’intérieur de cette
période historique, pourquoi Tarde ? Parce qu’il problématise le processus de
constitution des quantités sociales (les valeurs), à partir non pas de la logique de
l’accumulation du capital, mais de la puissance d’invention, selon la dynamique de
l’événement. Il y a là une nouveauté remarquable par rapport au marxisme et à
l’économie politique : la production de la valeur économique n’est pas le foyer, d’où
s’engendrait par émanation, toutes les autres valeurs. Le point de vue
méthodologique de Tarde (défaire les oppositions dialectiques, pour faire émerger la
puissance d’invention et de répétition de la multiplicité) est très proche de celui
Foucault. La grande dualité capital-travail n’est pas l’origine de la multiplicité des
relations de pouvoir et de résistance des sociétés capitalistes, mais en est un résultat.
Elle est le produit d’un phénomène de coagulation, d’intégration, de connexion, de
mise en cohérence des réseaux de relations et des processus hétérogènes. La totalité,
le principe explicatif unitaire, que la relation capital-travail semble produire, n’est
qu’un effet, un effet massif ou global (Foucault), un effet total ou abstrait (Deleuze).
Pour reconquérir le point de vue de l’action des multiplicités, pour défaire et expliquer
le global et la totalité, il est nécessaire d’élaborer une théorie de la singularité, pour
regarder les rapports sociaux du point de l’infinitésimal, pour saisir l’action dans les
détails : une micro-sociologie (Tarde) ou une théorie des micro-pouvoirs (Foucault).
Les dernières élections américaines nous donnent l’occasion de voir à l’œuvre toutes

ces questions et de nous poser à nouveau le problème qui était au centre des
préoccupations de la philosophie de la différence, celui de la valeur de la valeur. Du
vivant même de Marx, aussi bien Nietzsche que Tarde posent le problème de la valeur
à partir du gouvernement des affects, des passions. Tous les commentateurs ont été
surpris par le déplacement de la campagne électorale opéré par l’équipe de Bush, du
terrain de la souveraineté (de son transfert vers l’Empire ou l’Europe) et du travail
(l’accumulation du capital) vers celui des valeurs. L’étonnement est dû au fait que
nous n’avons pas encore suffisamment intégré la leçon de la philosophie de la
différence. Pourquoi les néo-conservateurs ont-ils mis les valeurs au centre de leur
campagne électorale, sous l’égide de la peur de la guerre des civilisations ? Pour
pouvoir répondre à cette question, il faut bien souligner qu’ici les valeurs, “ l’histoire
des sentiments moraux ” ou de la “ moralité de mœurs ”, ne renvoient pas à de “
l’idéologie ” - à la superstructure comme chez Marx, aux appareils idéologiques d’État
comme chez Althusser, ou à l’histoire de mentalités - mais toujours à des dispositifs
de pouvoir. Foucault nous a longtemps expliqué qui ni le pouvoir disciplinaire, ni
l’accumulation du capital, ne pourraient marcher sans une multiplicité des relations de
pouvoir qui leur sont hétérogènes. La société disciplinaire, par exemple, ne peut pas
fonctionner sans l’intervention d’une institution comme la famille, fer de lance de la
campagne électorale de Bush. La famille, l’intérieur de laquelle le pouvoir ne s’exerce
pas selon les modalités disciplinaires, mais, au contraire, selon les modalités du
pouvoir souverain, agit d’abord comme une charnière absolument indispensable au
fonctionnement de tous les systèmes disciplinaires. La famille est l’instance de
contrainte qui va fixer en permanence les individus dans les appareils disciplinaires.
Pour être obligé d’aller à l’école, au travail, à l’armée, il faut que les individus soient
pris d’abord à l’intérieur de ce système de souveraineté. Deuxièmement, la famille
constitue un relais, un point de reconversion, de passage d’un enfermât à un autre
(de l’école à l’armée, de l’armée à l’usine ; elle est aussi responsable de l’internement
à l’Hôpital). La sexualité, autre bête noire des néo-conservateurs, se trouve au
croisement de deux dispositifs de pouvoir : en tant que conduite corporelle, elle relève
des disciplines, puisqu’elle est individualisation, assignation à un rôle. De l’autre côté,
la sexualité, par ses effets procréateurs, s’inscrit dans des processus biologiques
larges qui concernent non plus le corps de l’individu mais cette unité multiple que
constitue la population. Elle relève donc des techniques biopolitiques de régulation de
la population (et notamment de la natalité). La peur à travers laquelle les néo-
conservateurs ont géré la campagne électorale n’est pas d’abord la peur de la guerre.
Cette dernière est un effet massif ou global qu’il faut à son tour expliquer. La peur que
nous avons vue se cristalliser sur la guerre monte de l’intérieur du monde occidental,
et elle concerne l’effondrement du modèle majoritaire (famille, sexualité, éthique de la
valeur-travail) que les valeurs (c’est-à-dire les dispositifs de pouvoir) fabriquent. Il est
clair que Buttiglione, néo-conservateur européen, a toutes les raisons de ce monde de
s’inquiéter des femmes qui ne veulent plus rester à la maison et des “ homosexuels ”
qui s’affichent librement. L’Italie est aujourd’hui le pays dont les habitants sont les
plus âgés du monde. La “ race ” italienne est destinée à disparaître d’ici 60 à 70 ans, à
cause du taux de natalité qui n’assure même pas la reproduction de la population telle
qu’elle est aujourd’hui. Selon les démographes allemands, il est déjà trop tard pour
sauver une “ race ” qui, il y a seulement 50 ans, voulait conquérir le monde. Il n’y a
plus de parents allemands suffisamment nombreux pour la reproduire et les immigrés
ne constituent pas une alternative puisqu’ils assument les comportements
démographiques de pays qui les accueillent après une génération. Pendant qu’on
essaie de boucler l’Europe par le haut, elle se défait par le bas. Avec quels Européens
se fera l’Europe dans les 50 prochaines années, étant donné ce refus endémique,
moléculaire, massif des relations de domination qui régissent la famille et la
sexualité ? Est-ce que nous pouvons dire, comme Nietzsche à la fin du XIXe siècle, “
nous les Européens ” ? Probablement pas et tant mieux ! Ce refus est le résultat d’un

changement dans la capacité de sentir qui touche directement les dispositifs
biopolitiques (la régulation de la natalité, de la famille, de la race). Et, comme disait
Nietzsche, si vous tenez un changement de goût, vous tenez sûrement un
changement social irréversible.
Multitudes : Les comportements que tu décris sont-ils des comportements
politiques ?
Maurizio Lazzarato : Nous sommes ici confrontés à des comportements de refus et de
constitution des nouvelles formes de vie, à la naissance de nouvelles manières de
sentir que Deleuze et Guattari appellent minoritaires et que Foucault définit comme “
insurrection des contre-conduites ”. Ces comportements dérivent de relations de
pouvoir spécifiques (le pouvoir pastoral, le gouvernement des âmes) qui ne se
confondent pas avec les comportements qui donnent lieu aux révolutions politiques
contre le pouvoir en tant qu’il exerce une souveraineté ou aux révoltes économiques
contre le pouvoir en tant qu’il assure une exploitation. Une fois que le pouvoir juridico-
politique, à partir du XVIIe siècle, a intégré ces technologies de gouvernement
religieux (le passage de la pastorale des âmes au gouvernement politique des
hommes), nous retrouvons “ l’insurrection des conduites ” à l’intérieur des révolutions
“ politiques ” et “ économiques ”. Pour Foucault, ces mouvements qui cherchent à
échapper à la conduite des autres et qui cherchent à définir pour chacun la manière
de se conduire font partie intégrante de toutes les révolutions de la modernité (même
de l’expérience des soviets de la révolution russe). Mais si on s’imagine pouvoir saisir
ces comportements avec le concept de sujet de droit ou de “ classe ”, on est sur la
mauvaise piste. Les luttes des minorités, les révoltes des conduites agissent selon des
modalités de conflit et d’action que ni le marxisme, ni la tradition de la philosophie
politique ne sont à même de décrire, puisque les deux sont construits sur la base d’un
principe unificateur, totalisant (le droit, le travail). Le pouvoir pastoral qui se
métamorphosera en gouvernement des hommes est un pouvoir absolument “ original
et unique dans toute l’histoire des civilisations ”, inconnu à la tradition grecque et
juive, qui est fondée sur l’obéissance permanente, “ continue et indéfinie d’un homme
à un autre homme ”. Qu’aujourd’hui des mouvements politiques se nomment “ les
désobéissants ” est symptomatique de cette nouvelle sensibilité, qui s’est exprimée
dès que la surdétermination de la logique de guerre a faibli. Le mouvement de 68 a
été une étrange révolution justement parce qu’il a été d’abord une insurrection des
conduites, une fuite des minorités qui, en s’exprimant même à l’intérieur du salariat et
de la critique du politique, a complètement déstabilisé les cadres d’interprétation
théorique et politique de la tradition du mouvement ouvrier. Il ne s’agit pas d’avoir un
point de vue romantique sur les minorités, pour lesquelles la marginalisation est
synonyme de souffrance, mais de saisir, en dehors de tout ressentiment et de toute
posture de victime, la force et la logique de ces modalités d’action qui traversent les
pays, au-delà des différences culturelles, religieuses et politiques. De ce point de vue,
parmi l’impressionnante quantité d’articles sur la Turquie dont nous avons été
submergés, un homme que Le Monde décrivait comme un “ vieillard magnifique ”
mérite d’être cité, en ce qu’il parle avec plus de subtilité de l’Europe (des deux
Europes, celle du modèle majoritaire et celle de minorités, celle des contre-conduites),
que les tenants ou les adversaires de la constitution européenne. Si avec l’Europe des
institutions, du marché, des droits, “ nos intérêts sont commun ”, avec l’Europe de
contre-conduites, il y a plus de problèmes : “ Depuis la seconde guerre mondiale, la
plus grande tragédie de l’Europe est d’avoir perdu l’esprit de famille. La famille s’est
atomisée. Voilà ce qui est le plus grave. La famille est cassée, comme partout en
Turquie, et le grand responsable ce sont les femmes. Le village, c’est fait pour le
travail. Avant la question ne se posait pas. Maintenant elles veulent vivre leur vie,
faire des achats, voir leurs amis, passer leurs journées à Izmir, la ville lumineuse. Mes
fils et mes neveux subissent l’influence des femmes. Et c’est normal : quand vous

avez connu l’Europe, par la télévision et le voyage, il faut être fou pour habiter avec
ses parents et sa grand-mère, sous le même toit. Voilà où nous en sommes : quelque
chose est fini. ” Plutôt qu’une guerre de civilisations à l’apogée de leur puissance,
nous sommes en train de vivre la réaction violente des deux modèles majoritaires,
rongés de l’intérieur et en profondeur, par ces luttes minoritaires qui les déstabilisent
dans leurs fondements. Aussi bien les conservateurs que les islamistes sentent très
bien que, malgré l’usage guerrier de leur pouvoir patriarcal, économique et politique,
quelque chose est fini, à jamais. Il ne s’agit pas d’opposer la logique de minorités, de
contre-conduites aux révoltes politiques et économiques, mais de les agencer. Mais il
faut aller encore plus loin, puisqu’il me semble que ce sont les pratiques de minorités,
les pratiques de contre-conduites qui ont “ colonisés ” les luttes contemporaines.
Comme j’ai essayé de le montrer dans mon livre, les luttes des chômeurs, des
précaires, des intermittents, expriment cette logique à l’intérieur des luttes salariales
ou politiques “ classiques ”. Leur nouveauté dérive de cet héritage de 68 qu’ils ont
réactualisé. Je suis prêt à parier que les luttes qui se développeront en Chine seront
de cette même qualité (l’occupation de Tien an Men l’était déjà). Une dernière
remarque. Les comportements minoritaires, la microsociologie ou les micro-pouvoirs,
ne sont pas une question d’échelle, de secteurs, mais de point de vue, de méthode.
Les pratiques minoritaires, les pratiques de contre-conduite ne sont pas le propre des
femmes, des fous, des malades, des pauvres, des précaires, des “ marginaux ”. Le but
de mon livre était de faire fonctionner cette méthodologie de la multiplicité, de
l’hétérogénéité aussi dans les domaines jusqu’à maintenant réservé à la grande
dualité capital-travail ou à la politique.
Multitudes : Tu poursuis la distinction entre les dispositifs du biopouvoir et
les formes de vie biopolitique, que tu as établie dans le premier numéro de
Multitudes ?
Maurizio Lazzarato : Il faut faire attention, puisque même la distinction que nous
avons essayé d’introduire entre biopouvoir et biopolitique risque d’être ambiguë et
surtout très, très limitée. Nous avons assisté au cours des dix dernières années à une
reprise (surtout par des philosophes italiens : Agamben, Esposito, Negri) du concept
de biopolitique qui me laisse plus que perplexe. Chez Agamben, la multiplicité des
dispositifs de pouvoir que nous avons vus à l’œuvre (disciplines, biopolitique,
souveraineté) et qui correspondent à une multiplicité de champs d’expression de
forces, est réduite à la relation la plus simple entre “ le ” pouvoir et “ la ” vie nue. A la
généalogie historique des relations de pouvoir, se substitue la définition d’“un ”
principe d’intelligibilité a-historique qui concerne toute forme de pouvoir. Pour
Foucault, il vaut mieux le répéter, la biopolitique dérive du pouvoir pastoral qui est
complètement étranger à la tradition romaine (“ homo sacer ”). Pour Negri, le concept
de biopolitique signifie qu’il n’y a plus de distinction entre économie et politique, mais
ce qui manque alors, c’est la spécificité du rapport entre micro-pouvoirs,
gouvernement et contre-conduites. Le concept de biopolitique est un des instruments
forgés par Foucault pour passer à l’extérieur d’une conception qui fonde l’origine du
pouvoir dans le politique ou dans l’économique. En se limitant à affirmer qu’il n’y a
plus de différence entre les deux concepts, il me semble qu’on enferme le travail de
Foucault dans un cadre qu’il voulait dépasser. Ces relectures de la biopolitique ne vont
pas dans la direction que Foucault avait imprimée à ces travaux. Les magnifiques
indications que nous trouvons dans ses cours ne sont pas très développées, mais
suffisamment claires pour nous permettre d’affirmer que les relations de pouvoir,
après la deuxième guerre mondiale, n’évoluent pas dans le sens d’un
approfondissement de la biopolitique (régulation “ biologique ” de l’espèce). Ce qui
passe au premier plan ce sont des nouvelles technologies de pouvoir que Foucault
définit comme “ environnementales ”, et qui ont comme objectifs, d’une part, la
modulation des différences à l’intérieur d’un champ de possibles, préalablement et

faiblement déterminé, et, d’autre part, la régulation des minorités (définies par
rapport à une majorité). La perspective qui se profile pour Foucault n’est pas celle
d’une intensification des disciplines, ni non plus d’une généralisation de la régulation “
biologique ” de la race, mais le “ contrôle ” des individus tel que Deleuze en parle
dans son célèbre article sur les “ sociétés de contrôle ”. Ce n’est pas la vie comme
biologie, mais la vie comme virtualité qui est au centre des nouveaux dispositifs de
pouvoir. “ On a, au contraire, à l’horizon de cela, l’image de l’idée ou le thème-
programme d’une société où il y aura optimisation des systèmes de différence, dans
laquelle le champ serait laissé libre aux processus oscillatoires, dans laquelle il y aura
une tolérance accordée aux individus et aux pratiques minoritaires, dans laquelle il y
aura une action non pas sur les joueurs, mais sur les règles du jeu et enfin dans
laquelle il y aura une intervention qui ne serait pas de type de l’assujettissement
internes des individus, mais une intervention de type environnementale. ” Ces
nouveaux dispositifs de pouvoir définiront un cadre assez “ lâche ” (les conditions
matérielles, technologiques, sociales, juridiques, de communication, d’organisation de
la vie) à l’intérieur duquel, d’une part, l’individu pourra exercer ses “ libres ” choix sur
des possibles déterminés par d’autres et au sein duquel, d’autre part, il sera
suffisamment maniable, gouvernable, pour répondre aux aléas des modifications de
son milieu, comme le requiert la situation d’innovation permanente de nos sociétés.
Dans mon livre, en continuité avec les nouveautés énoncées par la philosophie de la
différence, j’ai essayé d’introduire la notion de “ publics ” dans cette histoire des
dispositifs de pouvoir et des modalités de résistance. Pour Foucault, dans l’État de
police (Polizeiwissenschaft), terrain de naissance et d’expérimentation de la
biopolitique, les deux grands éléments de réalité que le gouvernement doit manipuler
sont l’“économie” et l’“opinion”. Et en effet, “ la naissance des économistes et la
naissance des publicistes sont contemporaines ”. Mais Foucault fait du public un
dispositif de conduite des consciences qui est destiné à être résorbé par la
population : “ Lorsqu’on parle du public, de ce public sur l’opinion duquel il faut agir
de manière à modifier ses comportements, on est déjà tout près de la population. ”
Pour Tarde, au contraire, les publics deviennent des dispositifs de pouvoir spécifiques,
distincts des dispositifs de régulation de la population. Comme j’ai essayé de le dire
dans mon livre, les sociétés de contrôle exercent leur pouvoir par la création de
mondes (“ d’environnements ”, dit Foucault) en laissant flotter l’individualisation,
plutôt qu’en l’imposant, comme dans les disciplines. A l’intérieur de ces mondes, les “
différences ” et les “ pratiques minoritaires ” pourront varier selon un minimum et un
maximum définis par des cadres “ lâches ” ouverts aux aléas de la vie comprise
comme virtualité. De façon que le pouvoir devient “ actions sur des actions possibles ”
sur la base de la dynamique de l’événement. La constitution et le contrôle des publics
sont, à mon avis, l’une des modalités de fonctionnement de ces dispositifs de pouvoir
environnemental qui interviennent sur le cadre, sur les règles du jeu, plutôt que sur
les joueurs : à l’individu et à la population des sociétés disciplinaires se superposent
les publics des sociétés de contrôle. Les caractéristiques de la population (corps
multiple, corps à nombre de têtes, sinon infini, du moins pas nécessairement
dénombrable, l’aléatoire de ses comportement, la possibilité de les saisir seulement
statistiquement, la dimension temporelle) sont intensifiées et reconfigurées par les
publics. Les publics, groupes sociaux de l’avenir, comme les définissait Tarde à la fin
du XIXe siècle, n’ont cessé de grandir et de s’étendre. Dans le rapport de l’expert
nommé par le gouvernement chargé d’une expertise sur les intermittents, il n’y a
qu’une information vraiment intéressante : sur une année, les Français passent 63
milliards d’heures en tant que faisant partie d’un public (de télé surtout, mais aussi de
cinéma, de théâtre etc.) et seulement 34 milliards d’heures au travail. Qu’est-ce qui
se passe dans ces 63 milliards d’heures, une fois que nous avons récusé les
explications idéologiques ou superstructurelle ? Il y a d’abord de la production de la
valeur économique (la construction d’une oeuvre est pour la moitié le fait des publics,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%