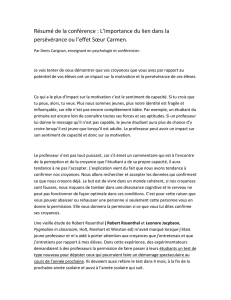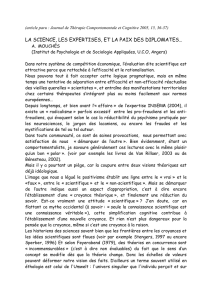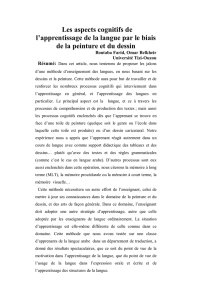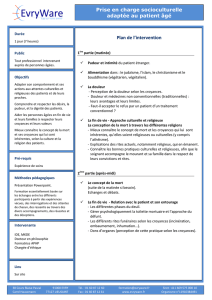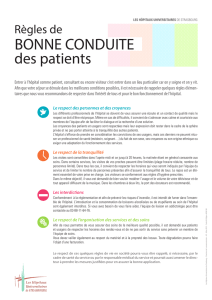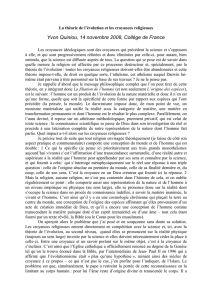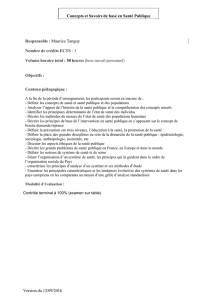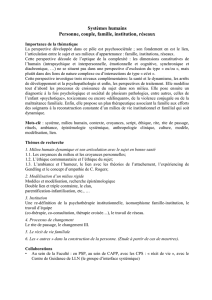La Contagion des idées et notre sujet de

Retour à l’accueil des travaux en anthropologie cognitive
Travaux en sciences de l’éducation (Thèse de doctorat)
Travaux en sciences cognitives (Dea Ehess, Ens Ulm, X)
Page d’accueil littérature générale Chr. Chomant
Catalogue général Christophe Chomant Éditeur (dans lequel est référencé le texte ci-dessous)
Retour à l’accueil général du site de Chr. Chomant
CHRISTOPHE CHOMANT
Résumé, analyse et discussion de l’ouvrage de Dan Sperber
La Contagion des idées
Théorie naturaliste de la culture
(Paris, Odile Jacob, 1996)
DEA de sciences sociales et philosophie de la connaissance
Université de Paris IV – Sorbonne
Séminaire de M. Pascal Engel
Théorie de la connaissance et logique épistémique


Sommaire général
Avant-propos 7
Présentation générale de l’ouvrage 9
Résumé du livre 11
Résumé du livre en une page 41
Discussion de points particuliers du livre 43
Discussion générale de la théorie de Dan Sperber 75
La Contagion des idées et notre sujet de recherche 81
Sommaire détaillé
Avant-propos 7
Présentation générale de l’ouvrage 9
Résumé du livre 11
Préface 11
Chapitre I. Anthropologues, encore un effort pour être vraiment matérialistes ! 13
Anthropologie et ontologie 13
L’ontologie de la psychologie : un exemple à suivre ? 13
Un vocabulaire interprétatif 14
Le mariage 14
Implications 15
De quoi sont faites les choses culturelles ? 15
Une épidémiologie des représentations 16
Les « mythes » 16
Le « mariage » à nouveau 17
Chapitre II. Interpréter et expliquer les représentations culturelles 17
Comment représenter les représentations culturelles ? 18
Comment expliquer les représentations culturelles ? 19
Chapitre III. Anthropologie et psychologie : pour une épidémiologie des
représentations 21
L’épidémiologie 21
Les représentations 22
Présupposés 22
Dispositions primaires et réceptivités secondaires 23
Les concepts de base 23
Les représentations culturelles 24
La mémoire et la littérature orale 24
Dernières remarques 25
Chapitre IV. L’épidémiologie des croyances 25

4
Spéculations anthropologiques 25
Différents types de croyances, différents mécanismes de distribution 28
Chapitre V. Sélection et attraction dans l’évolution naturelle 29
Le modèle de la sélection 30
Le modèle de l’attraction 30
Facteurs écologiques et facteurs psychologiques 32
Chapitre VI. Modularité mentale et diversité culturelle 33
Deux arguments de bon sens contre la modularité de la pensée 33
Modularité et évolution 33
Modularité et intégration conceptuelle 34
Les domaines culturels et l’épidémiologie des représentations 36
Capacités méta-représentationnelles et explosion culturelle 38
Conclusion. Risques et enjeux 39
Résumé du livre en une page 41
Discussion de points particuliers du livre 43
Chapitre I. Anthropologues, encore un effort pour être vraiment matérialistes ! 43
Les « institutions culturelles » se limitent-elles à des représentations ? 43
Chapitre II. Interpréter et expliquer les représentations culturelles 44
Quels sont les résultats concrets d’une approche épidémiologique de la couvade,
supposée meilleure que les autres approches ? 44
La transmission d’une idée se fait-elle malgré l’ironie, ou bien l’idée transmise est-elle
justement dans cette ironie ? 44
Tous les comportements et caractères observables chez une espèce sont-ils
nécessairement l’expression d’un facteur de survie au cours de son évolution ? 45
Chapitre III. Anthropologie et psychologie 46
Quel est le substrat neurobiologique de « l’attente zoologique » de l’enfant ? 46
Comment la diversité génétique s’exprime-t-elle sur le plan des modules conceptuels
spécialisés ? 46
Lequel, du module central conceptuel ou du système modulaire automatique
périphérique, a précédé l’autre ? 47
La malléabilité culturelle évolutionniste est-elle soluble dans la stabilité génomique ? 49
La capacité de doute est-elle propre à l’homme ? 49
Les croyances religieuses se construisent-elles sur des « réceptivités » plus que sur des
« dispositions » ? 50
Une « institution culturelle » est-elle un ensemble de représentations ? 50
Les « Malinovsky Memorial Lecture », notamment, constituent-elles un ensemble de
représentations ? 51
Chapitre IV. L’épidémiologie des croyances 52
Quel avantage une méthode purement théorique présente-t-elle sur ses concurrentes ? 52
Un masque est-il une « représentation » ? 52
Si un masque est une « représentation », alors tout n’est-il pas une « représentation » ? 53
Un texte constitue-t-il une « représentation » ? 53
La psychologie cognitive constitue-t-elle le meilleur exemple d’empirisme à opposer aux
théories abstraites ? 53
Croyances religieuses et scientifiques sont-elles analogues ou différentes ? 54

5
La confiance en l’autorité distingue-t-elle entre croyances religieuse et scientifique ? 54
Chapitre V. Sélection et attraction dans l’évolution culturelle 55
Les objets culturels se différencient-ils des objets naturels dans leur communication
transformée ? 55
Le sujet « s’émancipe-t-il » de déterminants naturels ou culturels ? 55
Chapitre VI. Modularité mentale et diversité culturelle 56
Les pathologies neurocognitives en faveur de la globalité fodorienne 56
Comment la représentation du bouledogue Goliath se construit-elle ? 57
Isolement du module méta-représentationnel et « sensation d’être » 58
Réplication de micro-modules initialisables et fonction bureautique « enregistrer sous » 59
Modules évolutionnistes et capacités cognitives automatiques actuelles 59
Le surdéveloppement du domaine effectif par rapport au domaine propre est-il une
spécificité humaine ? 60
Le module sonore a-t-il pour fonction de produire du plaisir ? 60
La souplesse des capacités des modules spécialisés innés ne rend-elle pas tautologique
l’hypothèse évolutionniste ? 61
La souplesse culturelle : avec ou sans l’ultra-modularité évolutionniste ? 62
Un objet ou un animal imaginaire est-il nécessairement traité par un module culturel
spécialisé issu de l’évolution ? 62
L’hypothèse modulariste face à la réalité neurobiologique 63
Entre la théorie philosophique et la réalité 65
Des relations entre réflexion philosophique et connaissance 65
Pourquoi la classification raciale procéderait-elle différemment, a priori, de la
classification des espèces ? 65
La classification raciale est-elle un processus culturel dépassant les différences
apparentes ? Comment les jeunes enfants d’école maternelle construisent-ils la notion
de « race » ? 66
Les notions de « race », humaine ou non-humaine : des notions nécessairement récentes,
mais pas pour autant forcément « culturelles » 67
Une origine naturelle de la classification raciale pourrait-elle « justifier » la xénophobie ? 68
La connaissance d’un comportement justifie-t-elle ce comportement ? 69
L’intuition est-elle perceptuelle et périphérique ? 70
Quelle est la matérialisation du module « méta-représentationnel » ? 71
Conclusion. Risques et enjeux 72
Discussion générale de la théorie de Dan Sperber 75
Une profession de foi méthodologique 75
De l’aspect éthéré du matérialisme de Dan Sperber (comme de la philosophie de l’esprit
en général) 76
Comment appliquer la méthode proposée par Dan Sperber ? 76
Quelle anthropologie pourrait-elle échapper à l’interprétation ? 77
Un matérialisme intégral 77
Un exemple d’application utile de la méthode de Dan Sperber en sciences de l’éducation 78
Application de cette application à notre propre sujet de recherche 80
La Contagion des idées et notre sujet de recherche 81
Points communs et distinctions 81
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
1
/
101
100%