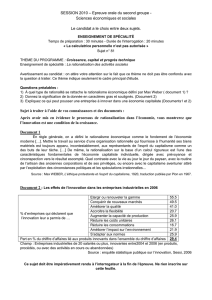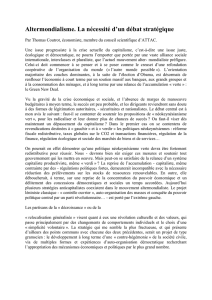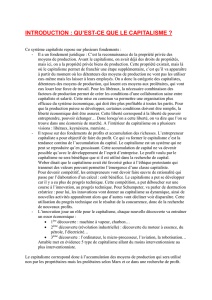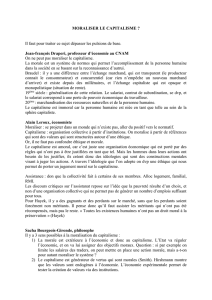En cinquième, nous avons découvert que les pays recherchent la

Introduction
En cinquième, nous avons découvert que les pays recherche la croissance économique. Celle-
ci permet l’accroissement de la richesse et donc une meilleure satisfaction des besoins de la
popullation tant du point de vue matériel que du point de vue social.
Nous avons aussi mis en évidence les limites de cette croissance : répartition inégalitaire de la
croissance, destruction de l’environnement, ….
Dans le cadre de ce titre 3, nous allons découvrir selon quelle forme d’organisation
économique cette croissance sera atteinte.
Chapitre 1 : analyse de textes
Ce chapitre permettra au travers de plusieurs documents de découvrir :
- les notions de système, régime et doctrine
- les caractéristiques du système capitaliste
- les caractéristiques du système socialiste
- les principaux courants de pensée de la sciences économiques.
La dernière section du document est consacrée à l’établissement de 2 tableaux de
comparaison : l’un consacré aux systèmes «économiques et l’autre aux 3 grandes écoles de
pensée en sciences économiques.
Document 1 : Le Nouvel Economiste, N° 526, 31.01.86, pages 88, 89, 93.
L’ancien patron d’une petite affaire familiale de 200 salariés n 1965, est aujourd’hui à la tête
du troisième groupe biscuitier mondial derrière l’américain Nabisco Brands et le britannique
United Biscuit. Générale Biscuit, c’est 6,5 milliards de chiffre d’affaire, 120 millions de
résultat, 12.000 salariés, trente usines : vingt-sept en Europe, trois aux USA, un pied déjà au
Japon, à Osaka, un autre peut-être prochainement à Shangaï, en Chine populaire.
A l’origine de cette réussite, une idée simple : la fabrication d’une gamme devenue
internationale sous le logo LU, dont les produits sont adaptés aux goûts spécifiques des
consommateurs de chaque pays : biscuit aux flocons d’avoine et aux raisins pour les Etats-
Unis, gaufrettes fourrées à la vanille en Belgique, biscuits au beurre avec tablette de chocolat
en France. Des secondes marques – l’Alsacienne, Heudebert, De Beukelaer – confortent la
position de LU ; Tout cela dans une fourchette de prix de 3 FRF à 10 FRF le paquet de 150
grammes.
Une multinationale ? Pas encore : le groupe n’a que 6% du marché américain du biscuit et
n’a, pour l’instant, pas encore réussi son débarquement au Japon. Mais il prépare activement
des « coups » pour réussir, cette année, sa mondialisation. Car, dans la partie aujourd’hui
engagée entre quelques géants pour la maîtrise du marché mondial, le groupe Générale
Biscuit n’a pas le choix : ou il saura accroître sa pénétration du marché européen, s’implanter
en Asie et dans le Pacifique par rachats et accords d’association ; ou il sera, à son tour, mangé
par un concurrent ;
Ce risque n’inquiète pas Monsieur Martin. Cependant, il en plaisante : « le bruit avait couru,
un matin qu’Unilever venait de racheter 10% de de Générale Biscuit. Or, je déjeunais, ce jour-
là, au CNPF avec Monsieur François Périgot, patron des sociétés françaises d’Unilever.
Evidemment, je lui pose la question. Il me répond : je serais étonné que nos deux directions la

britannique et la néerlandaise aient fait cela s’en m’en parler, mais je vais téléphoner. Au café,
nous étions rassurés. »
Alors qu’un de ses principaux concurrents, Belin, a concentré ses lignes de fabrication dans
une usine ultramoderne à Evry, Monsieur Martin se retrouve, sur le seul territoire français, à
la tête d'une vingtaine d'usines dont beaucoup « doublonnent » ou sont indéniablement
obsolètes. Un plan de modernisation sur deux ans – 1985 et 1986 – est bâti, pour un
investissement de 650 millions de FRF. A Nantes, la biscuiterie LU, au cœur de la ville, sera
transformée en musée, une autre étant construite à la périphérie à la Haye-Fouassière. A
Vervins (Aisne), la filiale Heudebert sera dotée d’une nouvelle usine de biscottes. On
procédera à la fermeture de quatre usines : - Augy (Yonne), Quesnoy (Nord), Reims (Marne),
et Pessac (Gironde) – dont les activités seront transférées.
Un plan social a déployé l’éventail des mesures traditionnelles : préretraites, aides au retour
pour les immigrés, recherches d’industriels pouvant reprendre les sites délaissés. « Certains
nous ont accusés de les laisser tomber. C’est faux : nous avons proposé à tous une mutation
dans une autre usine du groupe » précise Monsieur Arnaud Havard, directeur du personnel de
Générale Biscuit France.
A l’aube de 1986, Générale Biscuit s’apprête à livrer de nouvelles batailles. D’abord, en
essayant de réitérer dans la biscotte et les produits céréaliers diététiques ce qui a si bien réussi
dans le biscuit. La division spécialisée du groupe a été transformée en filiale à part entière
sous le nom d’Heudebert SA, que dirigera à Lyon, Monsieur Yves Thèves. Avec un chiffre
d’affaires de 800 millions de FRF l’an dernier et 45% du marché français des biscottes et
croustillants, elle se lance à la chasse de ses confrères italiens, allemands ou suédois.
Surtout, Générale Biscuit va tenter de relever un nouveau défi : dans les années 1960, le
marché c’était l’Europe, aujourd’hui, c’est le monde
Document 2 Adam Smith : recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations,
1776.
Nous n’attendons pas notre dîner de la bienveillance de notre boucher ou de celle du
marchand de vin et du boulanger, mais bien de la considération qu’ils ont de leur propre
intérêt. Nous nous adressons, non pas à leur humanité mais à leur égoïsme, nous ne leur
parlons pas de nos besoins, mais de leurs intérêts.
Document 3 F. Duboeuf : introduction aux théories économiques ; éd ; La Découverte.
C’est la recherche individuelle du gain, fondée sur un ordre social inégalitaire, qui garantit au
mieux l’enrichissement national : chacun est alors conduit par une main invisible, sans en
avoir l’intention et sans le savoir, à faire avancer l’intérêt de la société.
Cependant, Smith n’est pas un défenseur inconditionnel de la liberté économique et assigne à
l’Etat des fonctions économiques : il doit limiter les excès liés à la liberté individuelle et créer
le cadre social et économique nécessaire à l’épanouissement efficace des intérêts particuliers.
Document 4 G. Jacoud et E. Tournier : les grands auteurs de l’économie, chez Hatier.
Marx va monter que la dynamique de l’économie conduit à l’autodestruction du capitalisme
puis à son remplacement par un autre système économique.

L’accumulation du capital est le processus qui permet d’augmenter le stock du capital initial
par l’investissement, c’est-à-dire par l’utilisation productive d’une partie de la plus value
1
réalisée. Plus le capitaliste transforme en capital une partie importante de sa plus-value, plus
l’accumulation sera forte, plus il s’enrichira. Mais pourquoi le capitaliste a-t-il toujours
tendance à accumuler du capital ? Pour Marx, c’est la concurrence qui le contraint à
rechercher en permanence à améliorer la productivité du travail. S’il ne modernise pas sans
cesse ses installations, s’il n’investit pas, il sera vite dépassé par d’autres entreprises plus
compétitives. L’accumulation est donc une loi du capitalisme.
Le capitalisme connaît une tendance à la baisse du profit. Nous savons que, du fait de la
concurrence, le capitaliste doit recourir aux innovations techniques et les incorporer à son
organisation, qu’il est conduit à accroître la part de son capital constant (capital économique).
Proportionnellement, il augmente ainsi plus vite que le capital variable c’est à dire la partie du
capital qui sert à payer les salaires. Or seul le capital variable est créateur de valeur.
Les capitalistes, du fait de la concurrence, ont tendance à investir et à substituer du capital au
travail. L’accumulation du capital est donc destructrice d’emplois et créatrice d’une
surpopulation relative. A court terme, cette armée de réserve industrielle est favorable aux
capitalistes car elle pèse sur le marché du travail, empêche les salaires de monter dans les
phases de prospérité et les fait baisser dans les situations de crise. Mais à long terme, cette
paupérisation, cette accumulation de la misère, parallèle à l’accumulation du capital, entre en
contradiction avec le fait que le capitalisme crée de plus en plus de richesses.
Document 5 Capul et Garnier : dictionnaire d’économie et de sciences sociales chez Hatier,
Paris 1994.
La liberté de propriété individuelle est le grand principe du capitalisme. Ainsi, les terres ou les
machines – soit la plus grande partie des biens de production – sont détenues par des
personnes privées (seules ou réunies en sociétés). La liberté de propriété s’accompagne des
droits suivants : droit de gérer ces biens, droit de les vendre, droit de recevoir des revenus (les
profits) liés à cette propriété.
Ce qui fait l’originalité absolue du système capitaliste, c’est l’accumulation du capital grâce
aux profits. De quoi s’agit-il ?
A la différence d’une organisation de la vie économique dominée par l’artisanat, le
capitalisme conduit à ce que la plus grande part des profits ne soit pas consommée (c.-à-d.
dépensées par les propriétaires de moyens de production, sous forme d’achats de biens de
consommation destinés à leur usage personnel), mais épargnée et réinvestie dans l’entreprise
afin de permettre l’accroissement des moyens de production.
Ainsi, les entreprises utilisent d’abord leurs bénéfices pour se développer en augmentant la
quantité des moyens de production.
La recherche du profit est donc placée sous le signe de l’accumulation du capital, c’est-à-dire
un processus de constitution du capital technique réalisé sous les deux formes que sont
l’investissement net et l’amortissement.
Le capitalisme correspond ainsi à la recherche permanente de profits afin d’accumuler
indéfiniment des capitaux. En cela, il est inséparable des moyen modernes d’organisation de
la production.
Le capitalisme est contemporain du développement des formes de rationalisation du travail et
de la production.
1
Dans le marxisme, différence entre la valeur tirée d'une quantité de travail et ce qui est payé
au travailleur pour entretenir sa force de travail. (La plus-value est, selon Marx, le ressort de
l'exploitation capitaliste.)

La recherche de la productivité maximale est ainsi à l’origine d’une véritable organisation du
travail (de la division du travail à l’organisation scientifique du travail) ainsi que d’une
évolution des structures productives (de la fabrique au développement de la concentration des
entreprises).
Document 6 Capul et Garnier : dictionnaire d’économie et de sciences sociales chez Hatier,
Paris 1994.
La propriété collective des moyens de production signifie que tous les secteurs de l’économie
appartiennent à l’Etat, qu’il s’agisse de l’industrie, des banques, des transports ou du
commerce. L’agriculture est, elle aussi, collectivisée. Le pouvoir est exercé par des
fonctionnaires nommés en réalité par le parti communiste ; On a ainsi appelé nomenklatura
l’ensemble des personnes occupant des postes de responsabilité dans l’Etat et bénéficiant de
privilèges particuliers.
Depuis les années 30, il existe des plans quinquennaux (cinq ans) qui organisent toute la vie
économique. Le Plan concerne tous les secteurs de l’économie ; les entreprises sont
consultées, mais le Gosplan (comité d’Etat de la planification) décide seul des objectifs
détaillés que les entreprises, qui dépendent des ministères spécialisés, doivent atteindre.
La plupart de ces objectifs sont des objectifs quantitatifs, fixés en unités physiques (tonnes,
nombre d’unités produites, litres, etc…). La planification est obligatoire pour toutes les
entreprises.
L’activité économique des entreprises est entièrement sous le contrôle de l’Etat ; l’entreprise
se voit ainsi imposée ses clients et ses fournisseurs. Ses approvisionnements font l’objet d’un
rationnement particulier puisque seul le ministère décide des quantités achetées aux
fournisseurs.
Le contrôle de l’économie réside aussi dans la fixation autoritaire des prix.
Document 7 Le Monde des Affaires, 31.10.87, pages 4 et 5.
Situé au centre de Moscou, près du théâtre de la Taganka, le restaurant Skazka (le conte de
fées) ne désemplit pas. Il est pourtant quatre heures de l’après-midi. Le cadre y est agréable, la
nourriture – des crêpes – plutôt raffinée, le service est affable. Un conte de fées au pays des
Soviets ? Pas vraiment. C’est l’un des premiers – et rares – résultats tangibles des vastes
réformes économiques engagées par Mikhaïl Gorbatchev : le restaurant est exploité par une
coopérative, une nouvelle forme de société introduite en Union soviétique par une loi de
novembre dernier.
Attablé dans la salle du premier étage de son restaurant, sans jamais perdre de vue le
déroulement du service, il émaille son histoire de quelques principes que ne renierait aucun
capitaliste : « tout patron sait qu’il doit tirer de chaque pièces de cinq kopecks un profit, chez
nous, 99% des restaurants d’Etat sont subventionnés parce qu’ils sont mal gérés. Ce n’est pas
l’Etat qui doit verser de l’argent aux entreprises mais l’inverse. »
Dans la foulée, il cite Lénine pour dénoncer « les capitalistes qui mettent dans leur poche la
plus grande partie des bénéfices ». Il rappelle que le grand Vladimir Ilitch Oulianov disait
aussi « qu’il faut savoir prendre au capitalisme ce qu’il a de meilleur ».
La concurrence, justement, les coopératives savent d’ores et déjà, la faire jouer en leur faveur.
« Pour mes approvisionnements, j’ai l’embarras du choix », explique Sergueï Koutouzov. Il
est libre, en effet, d’acheter où il veut ses poulets, ses œufs, ses fruits et ses légumes, tout
comme son petit matériel de cuisine : dans les magasins de détail de l’Etat, sur le marché
kolkhozien, auprès des sovkhozes dont la production est planifiée, qui ont désormais le droit

de vendre 30% de leur production directement chez les particuliers, mais aussi maintenant
auprès des coopératives qui assurent le commerce de gros . « Après les avoir mis en
concurrence, j’ai signé deux contrats d’approvisionnement avec des sovkhozes qui me
garantissent qualité et respect des délais de livraison », raconte ainsi Andreï Fedorov.
Bien sûr je gagne trois fois plus que dans l’entreprise d’Etat où j’étais avant », reconnaît le
charcutier coopérateur Boris Molotov, « mais je travaille aussi beaucoup plus ».
Entrepreneur dynamique, plein d’idées et travailleur, Andreï Fedorov a droit aujourd’hui aux
honneurs des médias soviétiques et occidentaux. A chacun son modèle. Joseph Staline avait
Stakhanov, Mikhaïl Gorbatchev a Koutouzov.
Document 8 Alternatives économiques, septembre 2000
Pour la majorité des économistes, la Pologne constitue l’exemple même d’une transition
réussie.
Le plan Balcerowicz, du nom du premier ministre des Fiances du premier gouvernement post-
communiste, mis en œuvre en 1989. Il mêle des mesures structurelles, dont le but est de sortir
le pays de l’économie administrée (libéralisation des prix et du commerce extérieur,
convertibilité monétaire), et des mesures conjoncturelles, destinées à casser la dynamique
d’hyper-inflation héritée de la gestion communiste (vérité des prix par la suppression des
subventions à la consommation, contraction des dépenses publiques).
Document 9 P. Jacquet, directeur adjoint de l’Institut français des relations internationales, in
Enjeux, les Echos, décembre 2000.
La Chine se développe à l’abri des modèles. Depuis vingt ans, elle s’est engagée dans une
transition économique sans transition politique. Alors que les pays d’Europe centrale et
orientale se sont fixés pour modèle l’économie de marché, la Chine erre sans horizon défini.
Or la performance est éloquente : croissance vigoureuse, prix stables, excédent des paiements
courants… L’expérience chinoise témoigne de la diversité des chemins du développement
économique. L’un des principaux obstacles aux réformes concerne les entreprises d’Etat, mal
gérées, inefficaces et sources de gaspillages. Leur restructuration, à fortiori leur privatisation,
patine depuis plusieurs années. Le pays ne va , certes pas, éliminer du jour au lendemain
toutes les barrières aux échanges et à l’investissement. Mais le choix de l’ouverture est clair.
Aujourd’hui, septième puissance économique par son PIB, la Chine est appelée à devenir une
grande puissance commerciale. Pour les entreprises étrangères, l’ouverture de ce vaste marché
est plein de promesses et de risques à la fois.
Document 10 Le Soir, 26.04.1991, page 6.
La récession officielle : tous les indicateurs, désormais communiqués, virent au rouge, et le
chômage risque de flamber. Quant aux entreprises, elles n’en peuvent plus d’accumuler des
pertes qui sont toujours épongées par l’Etat.
Malgré un production céréalière record l’an dernier, l’Union soviétique a tout de même dû,
une nouvelle fois, faire appel au blé américain. Et pourtant, sa production brute a atteint 240
millions de tonnes alors qu’elle n’en avait besoin que de 190 millions (150 pour la population,
40 pour le bétail). L’explication ? Un énorme, un incommensurable gaspillage : 90 millions
de tonnes perdues sur les champs, lors du transport, du stockage, de la transformation, de la
distribution… Manque d’équipements frigorifiques, manque de moyens, de volonté, tout
simplement. Le pire, c’est que, si l’agro-alimentaire soviétique était rondement mené, l’URSS
serait largement exportatrice de viande, de céréales, de lait, de beurre, etc. Tous les problèmes
se poseraient autrement : les rayons des magasins seraient enfin garnis.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%