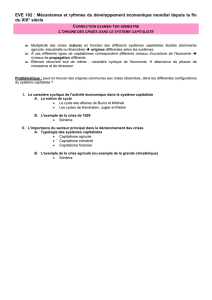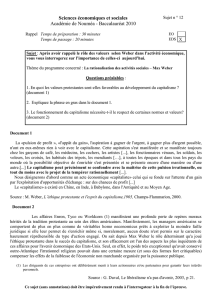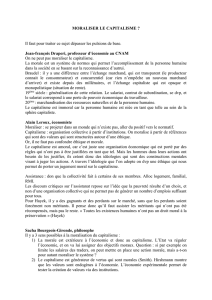Croissance, développement et changement social sur très

Croissance, développement et changement social sur très longue période
Face aux graves problèmes économiques, sociaux et écologiques qui se posent
aujourd’hui à l’humanité, il y a plusieurs écoles de pensée.
Certains scientifiques prétendent que l’humanité ne se pose que les problèmes qu’elle
peut résoudre. Ils pensent que la science nous apportera les solutions le moment venu, et que
le marché nous incitera à les mettre en œuvre : par exemple, quand les réserves de pétrole
s’épuiseront, le pétrole deviendra cher, parce que rare, et c’est la hausse de son prix relatif qui
incitera à l’économiser et à lui substituer de nouvelles sources d’énergie ; quand la pénurie
d’eau douce provoquera des catastrophes à grande échelle, il deviendra rentable de dessaler
l’eau.
D’autres scientifiques craignent que les solutions soient découvertes trop tard, ou
qu’elles ne soient pas à la hauteur des problèmes, parce que certaines destructions sont
irréversibles : il en va ainsi pour de nombreuses espèces végétales et animales, à jamais
disparues. Il en va également ainsi du changement climatique : une fois que les premières
grandes catastrophes liées au changement climatique auront eu lieu, il faudra des centaines
d’années pour que la tendance s’inverse. Ces scientifiques pensent qu’il est urgent de rompre
dès maintenant avec la logique du système économique et social actuel, qui n’est pas viable à
long terme. (cette idée de rupture peut prendre plusieurs formes, d’ailleurs : certains parlent
de réformer l’économie mondiale pour la rendre plus écologique (faire payer les entreprises
pollueuses par exemple, pour les obliger à investir dans le développement durable), d’autres,
les révolutionnaires, pensent que le système ne peut pas se réformer, et qu’il faut en finir avec
la société de consommation)
Que vous soyez plutôt sensible à l’une ou l’autre théorie, il faut admettre que c’est
l’avenir de notre mode de développement (notre façon de travailler, de produire, de
consommer, de vivre ensemble) qui se trouve en jeu. Pour comprendre cet enjeu, il faut
d’abord essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là.
La réponse n’est pas simple, et elle va faire l’objet de ce cours de sciences
économiques et sociales tout au long de l’année.
Pour cette introduction, je me contenterai de vous montrer le fil conducteur que l’on
va suivre durant cette année de Terminale.
Le capitalisme est un système économique relativement récent dans l’histoire de
l’occident. Pendant des millénaires, l’idée de croissance économique était totalement absente
des représentations de l’humanité. Si les surplus de production existaient, ils n’étaient pas
utilisés à accumuler du capital pour produire plus. Alors pourquoi la civilisation européenne
est-elle passée, autour de XVIe siècle à un nouveau mode de production ?
Si l’on retient l’hypothèse que la religion gouvernait totalement les représentations du
monde, imprégnait toutes les valeurs, alors on peut penser que c’est un changement religieux
qui a conduit à la mise en place du capitalisme.

Selon Max Weber (1864-1920), c’est l’avènement du protestantisme, et son rapport
particulier à la réussite individuelle, qui a permis de mettre en place l’« esprit du
capitalisme ». En effet, le protestantisme croyant en la prédestination de l’individu, il est
devenu légitime pour les croyants de s’enrichir : être riche signifiait alors être élu de Dieu.
Le XVIIIème siècle est la période pendant laquelle le capitalisme s’affirme
idéologiquement, sous la plume notamment d’Adam Smith (1723-1790). Selon lui, il n’y a
rien de moralement répréhensible dans le désir qu’a chaque être humain d’améliorer ses
conditions matérielles d’existence. Bien plus, en laissant chacun poursuivre librement son
intérêt individuel, il en résultera, par le jeu d’une « main invisible », ce que le philosophe
utilitariste Bentham appellera ensuite « le plus grand bonheur du plus grand nombre ». Enfin,
à la différence des aristocrates qui dilapident les revenus de leur propriété foncière en
dépenses de luxe, la bourgeoisie capitaliste présente l’avantage d’investir leur épargne. Et
l’accumulation du capital qui en résulte est le principal facteur d’une croissance économique
dont toute la population finit par bénéficier, bien qu’inégalement. La suite de l’histoire a
d’ailleurs donné raison à Smith : entre 1400 et la fin du Xxème siècle, le PNB par habitant des
pays les plus développés (Europe de l’Ouest, Amérique du Nord, Australie) a été multiplié par
33.
À cette perception laudatrice du capitalisme répond au XIXème siècle une analyse
beaucoup plus critique. Marx (1818-1883), par exemple, constate que sous l’ancien régime, la
classe inférieure est seulement exploitée, alors que sous le régime capitaliste, elle est à la fois
exploitée et aliénée. Le travail est divisé en tâches spécialisées, qui sont effectuées par
l’ouvrier (OS), qui perd le contrôle de sa production. Dans l’économie capitaliste, le
travailleur n’a pas la maîtrise de son travail. Les gestes et les rythmes sont commandés du
dehors par la place qui est assignée au travailleur dans l’engrenage de la production. Selon
Marx, « l’homme devient un appendice de chair dans une machinerie d’acier ».
Nous avons vu que Weber avait mis en évidence l’affinité entre l’éthique protestante
et l’esprit du capitalisme. Cependant, la religion n’explique peut-être pas tout. De nombreux
autres facteurs ont favorisé la bifurcation intervenue en Europe occidentale entre la
renaissance et le XIXè. Parmi ces facteurs, il faudrait étudier l’urbanisation, la formation des
Etats-nations, la découverte de l’Amérique, puis la colonisation, le progrès des sciences et
techniques, les révolutions politiques, etc… L’importance particulière d’un de ses facteur doit
toutefois être soulignée, parce qu’il apparaît comme le plus important et le plus controversé :
il s’agit de l’intervention de l’État.
Notre système économique ne peut prospérer que dans une société stable : en effet,
l’investissement, la prise de risque économique et l’innovation sont paralysés si les
capitalistes redoutent de ne pouvoir s’approprier les gains qui en résultent. L’existence d’un
État suffisamment fort et stable pour assurer un minimum de sécurité des personnes et des
biens est donc indispensable. L’existence de droits de propriété protégés par la puissance
publique est donc une autre condition du développement économique capitaliste.
C’est en Europe que la conjoncture des facteurs favorables à l’expansion économique
a eu lieu, facteurs, on la vu, idéologique, religieux, et institutionnels. Et c’est aussi ce qui lui
donna les moyens de dominer le monde : avant la première guerre mondiale, que ce soit le
résultat de la colonisation (à laquelle il faut associer la traite des esclaves et le pillage des
ressources naturelles), de la conquête des marchés, de l’exportation de capitaux (firmes
multinationales), l’Europe occidentale est en effet parvenue à étendre son hégémonie sur les

4/5ème de la planète. Il faudra les deux guerres mondiales et la grande crise pour briser cette
domination. le centre de l’économie s’est alors déplacé vers les Etats-Unis. Ce déplacement a
évidemment eu de nombreuses incidences, mais il n’a pas modifié la logique du capitalisme.
Quelle est cette logique ?
Comme son nom l’indique, le capitalisme est fondé sur l’accumulation du capital.
Dans un tel système, des individus, seuls ou associés, engagent du capital, qui est au départ
une quantité d'argent, dans des entreprises qui l’utilisent pour acheter des matières premières,
des produits intermédiaires, des machines, et pour embaucher des salariés, afin de produire
des biens et des services destinés à être vendus sur des marchés dans l’espoir de réaliser ainsi
le taux de profit le plus élevé possible. Si cet objectif est atteint, ces mêmes individus
disposent donc d’une quantité d’argent plus importante qu’ils s’empressent de réinvestir afin
d’augmenter leur profit et d’en réinvestir une partie, de telle sorte que l’on assiste bien à une
accumulation du capital, comparable à un effet « boule de neige », a priori sans fin, tant que le
taux de profit reste suffisant.
Le capitalisme est par conséquent un système dynamique, inconcevable « au repos »,
dont la « nature » est de s’étendre sans cesse, dans chaque société et au-delà des frontières,
jusqu’à conquérir le monde entier… Cette dynamique implique l’expansion elle aussi infinie
du marché, qu’il s’agisse de la création de marchés nationaux ou internationaux, ou qu’il
s’agisse de la transformation de toute activité humaine en marchandise que l’on vend et que
l’on achète : le capitalisme a pour horizon la « marchandisation » du monde. Ce que l’on
appelle aujourd’hui la « mondialisation » n’a rien d’étonnant puisqu’il s’agit de la logique
même du capitalisme depuis ses origines. Qu’est-ce que la mondialisation ? C’est le passage
d’une économie internationale à une économie mondiale : dans ce système, la concurrence se
généralise, les nations sont intégrés dans un espace économique mondial qui échappe aux
régulations étatiques nationales, les grandes entreprises deviennent transnationales,
délocalisant leurs filières dans les pays à moindre coût de main d’œuvre.
Pour conquérir des parts de marchés ou créer de nouveaux marchés, les capitalistes
sont incités à innover, à mettre en œuvre de nouvelles techniques de production, à lancer de
nouveaux produits ; il en résulte des gains de productivité qui sont la principale source de
croissance économique : par exemple, la production par heure de travail a été multipliée par
25 en France entre 1830 et 1990. Ces innovations techniques ont des conséquences sur la vie
des sociétés capitalistes : le capitalisme déstabilise, bouleverse sans répit les sociétés, les
cultures qu’il investit ; il détruit les formes traditionnelles de solidarité, il déracine les
hommes, change leur mode de vie, il rend obsolètes les anciennes techniques (Schumpeter
(1883-1950) insistera tout particulièrement sur ce processus de « destruction créatrice »
1
).
Le capitalisme est à la fois producteur et produit du processus de rationalisation propre
à l’occident. Selon Max Weber, il n’est que l’une des manifestations d’un processus de
rationalisation propre à l’occident. Rationaliser une activité, cela implique de rechercher le
moyen optimal d’atteindre la fin qui lui correspond, sans jamais se contenter du résultat
acquis : rationaliser le travail cela revient à se l’organiser de telle sorte qu’il soit le plus
efficace possible (exemple taylorisme
2
). Cette logique rationalisatrice implique que l’on
1
Les entreprises à la pointe de l’innovation éliminent les entreprises en retard, des emplois sont détruits et
d’autres sont créés. Pb : le nombre d’emploi créé est souvent inférieur à celui détruit, précisément parce qu’il y a
augmentation de la productivité du travail.
2
L’OST repose sur la séparation totale des tâches d’exécution et de conception (division verticale du travail), sur
la décomposition des tâches en gestes parcellaires susceptibles d’être contrôlés, sur la définition du mode

calcule tout et tout le temps (« time is money »), avec l’obsession d’éliminer ce qui paraît
inefficace ou inutile. De ce point de vue, le capitalisme est bien une forme de rationalisation
puisqu’il repose sur un calcul incessant des coûts et des bénéfices. Mais le processus ne
s’applique pas seulement à la sphère économique : toutes les sphères de la société sont soumis
à cette impératif de rationalisation [religion, administration, loisir,…] Le paradoxe de cette
course en avant de l’homme pour maîtriser et dominer tout ce qui lui résistait , c’est qu’elle
donne en même temps le sentiment à l’individu d’être emporté par une évolution irrésistible,
qui le dépasse totalement, et dont il ignore où elle le conduit. La rationalisation, si elle semble
faciliter l’existence humaine, ne lui donne cependant pas de sens.
Partout où le capitalisme existe, il bouleverse donc les modes de vie. Il en est ainsi
dans les pays du tiers monde. Dans la longue période de transition entre le moment de la
déstabilisation de l’ordre ancien et celui de la construction d’un nouvel équilibre, elles sont
soumises à de violentes perturbations et souvent profondément déstabilisées par le conflit
entre la nostalgie d’une identité traditionnelle perdue, rétrospectivement idéalisée, et
l’aspiration fantasmée à une modernité occidentale perçue d’abord sous l’angle de la
consommation. Ce choc est d’autant plus violent que la mondialisation des industries
culturelles télescope le temps et l'espace, créant immédiatement un décalage insupportable
entre un modèle occidental diffusé par les médias (cinéma, séries télé, publicité) et des
économies incapables de subvenir aussi rapidement à tous ces besoins « modernes » qu’il
suscite, notamment dans la jeunesse. Il en résulte une ambivalence des réactions à cette
occidentalisation du monde, faite à la fois d’adhésion mimétique au modèle et d’un
ressentiment nourri par l’envie frustrée. Cependant, l’acculturation ne prend pas partout et en
tout temps la même forme. Il dépend de la façon dont l’élément culturel exogène s’est
implantée dans la culture locale, et de la culture préexistante. L’élément culturel exogène est
soit sélectionné, soit réinterprété par la société qui l’accueille. (en Haïti, par exemple, le
célèbre culte vaudou identifie des divinités africaines à des saints catholiques) Ainsi,
l’uniformisation culturelle planétaire dont on parle très souvent est relative : ce n’est pas parce
que tout le monde boit du coca-cola, que le monde entier à les mêmes pratiques culturelles,
religieuses, et les mêmes valeurs. En réalité, les formes culturelles sont mouvantes, elles sont
en perpétuelle reconstruction.
L’occidentalisation du monde dont on parle est donc surtout institutionnelle et
économique : imposition de l’État et du capitalisme. La logique capitaliste ne s’est pas
développée sans douleurs dans les pays développés. Pourquoi ? Parce que la croissance
capitaliste est fluctuante, cyclique, de fait scandée par des crises d’amplitude et de durée
variables [quels sont ces cycles ?] Ces périodes de crises sont des périodes au cours
desquelles des entreprises, des capacités de production, des emplois sont détruits, précipitant
des population entières dans la détresse et le désarroi. Si le capitalisme a survécu à ces crises,
c’est qu’il s’est profondément transformé. Paradoxalement, le capitalisme a été sauvé par
l’institution qui combattait ses excès : par l’État, qui est intervenu pour prendre en charge une
partie de l’investissement, réguler la conjoncture, redistribuer une partie du revenu national,
finalement pallier l’initiative privée quand elle est défaillante et assurer la paix sociale (par la
redistribution et par la force). Même l’économie américaine, souvent citée comme l’une des
plus proches du modèle libéral, est une économie mixte, qui ne pourrait fonctionner sans un
minimum d’intervention de l’État et de réglementation.
opératoire le plus efficace en recourant au chronométrage des exécutants, sur la lutte contre les temps morts dans
la journée ouvrière.

De façon plus générale, il faut que l’économie soit soutenue, canalisée, contrôlée par
des institutions pour que les crises soient évitées ou atténuées, sur des périodes plus ou moins
longues, comme l’a montré l’exemple toujours cité des « trente glorieuses » (1945-1975).
Parmi ces institutions, il y a tout ce qui normalise les relations entre les patrons et les salariés
(négociation des salaires, conditions du travail, droit du travail…), les modalités de
l’intervention de l’État, la régulation du système monétaire, les formes de concurrence…
Mais l’intervention des Etats n’empêche pas l’accroissement des inégalités sociales.
Au Nord, cet accroissement pose un problème d’intégration et de justice sociale. Au Sud, il
pose d’abord le problème de la pauvreté.
En France, des inégalités sociales fortes subsiste, même si le niveau de vie des classes
populaires a beaucoup augmenté (pendant les 30 glorieuses surtout). De nombreuses
mutations ont eu lieu au XXe siècle :
- l’essor des catégories intermédiaires (techniciens, enseignants, cadres moyens et
supérieurs… : 33% de la population active aujourd’hui contre 16% dans les années
60), même si les catégories les plus nombreuses restent les salariés et les ouvriers
(57%, contre 60% dans les années 60). [quelles sont les CSP les moins
nombreuses ?] agriculteur : 2.4%, et artisans, commerçants et chefs d’entreprises :
6.1%. ces deux CSP sont en constante baisse depuis les années 60.
- L’extension des assurances sociales
- L’intervention de l’État
- L’action des mouvements sociaux (droits de femmes, des homosexuels,
mouvements contre le racisme et l’antisémitisme, mouvements écologistes,
régionalistes, actions pour le droit au logement, etc…)
La France appartient au club des pays les plus riches, mais ce privilège ne suffit pas à
garantir la cohésion d’une société confrontée à une perte de légitimité des institutions et à une
crise d’intégration d’une fraction de la jeunesse (quartiers pauvres). L’ampleur des inégalités,
et la remise en cause de la société salariale (10% de chômeurs, 1 million de RMIstes, 3
millions de salariés précaires) conduisent à s’interroger sur la capacité de notre système
économique à assurer le lien social.
Dans le monde, les inégalités sont également criantes : le patrimoine des 15 individus
les plus riches du monde dépasse le PIB totale de l’Afrique subsaharienne. Les 3 personnes
les plus riches du monde ont une fortune supérieure au PIB total des 48 pays en
développement les plus pauvres. Une des questions que l’on se posera au cours de cette année
est celle-ci : est-il bon pour les sociétés dites « sous-développés » d’adopter notre mode de
fonctionnement économique ? Question subsidiaire : les équilibres écologiques de la planète
pourront-ils résister à la généralisation de notre mode de vie, sachant qu’en prime la
population mondiale va s’accroître de 50 % dans les 50 prochaines années ? Dernière question
que vous devez vous poser en tant qu’étudiant et en tant qu’être humain : comment sauver
l’humanité et la planète Terre ? J’espère que ce cours de Terminale de sciences économiques
et sociales vous donnera des débuts de réponses.
1
/
5
100%