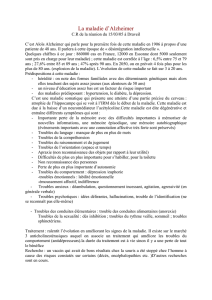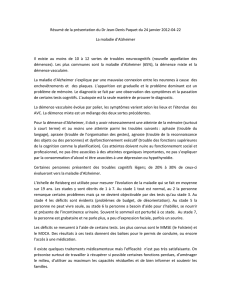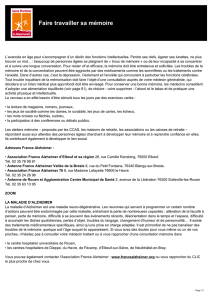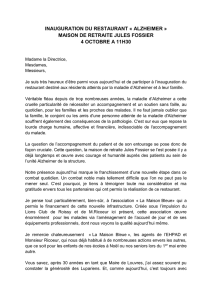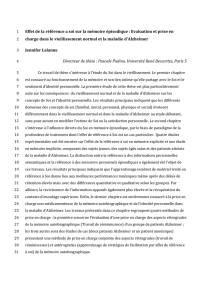Faut-il faire un diagnostic précoce de la maladie d

Faut-il faire un diagnostic précoce de la maladie
d’Alzheimer ?
Un débat anime les médecins sur le moment opportun pour annoncer la
maladie et concerne aussi la recherche qui vise à identifier la maladie chez les
personnes n’ayant pas encore de symptômes.
A quel stade faut-il diagnostiquer une maladie d’Alzheimer ? Cette question est au cœur d’un
débat éthique qui, sans doute, ne s’est jamais posé avec une telle intensité dans cette affection
neurodégénérative. Les médecins et les associations de patients sont tiraillés par des
interrogations portant à la fois sur le présent et le futur.
Ce débat n’est pas que théorique : il concerne d’ores et déjà des centaines de personnes qui,
chaque année, consultent leur généraliste ou un centre mémoire d’un hôpital. Avec une question
concrète : est-il utile d’annoncer à des patients, à un stade encore peu évolué de la maladie, un
diagnostic potentiellement anxiogène alors qu’il n’existe pas de traitements vraiment efficaces ?
L’autre débat se nourrit des perspectives ouvertes par les avancées de la recherche. L’enjeu est
d’identifier les tout premiers signes de la maladie à un stade où la personne ne ressent pas de
symptôme. Avec l’espoir de mettre au point des médicaments qui, délivrés très tôt, pourraient un
jour prévenir l’évolution de la maladie. Cette question du diagnostic précoce a été au cœur de
l’université d’été de l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie d’Alzheimer, à Aix-en-
Provence et à Paris.
Aujourd’hui, le diagnostic d’une maladie d’Alzheimer est établi à l’issue de toute une batterie
d’examens : tests neuropsychologiques, imagerie, prise de sang… Le plus souvent, ce diagnostic
est réalisé chez des patients ayant atteint le stade de la démence. « C’est un terme qui a une
connotation très négative dans le grand public », souligne le professeur Mathieu Ceccaldi,
responsable de la consultation mémoire Paca-Ouest à l’hôpital de la Timone à Marseille. « Être
dément ne signifie pas qu’on est fou. Cela désigne une personne qui, en raison de troubles
cognitifs, est devenue dépendante », ajoute-il.
Aujourd’hui, il existe un consensus sur la nécessité de faire le diagnostic à ce stade de la
démence. Le débat concerne le stade précédent, celui où la personne est atteinte de troubles
cognitifs légers ou modérés. « Le diagnostic au stade prédémentiel soulève des problèmes à la
fois éthiques et pratiques », affirmait, en juin, le Collège National des Généralistes Enseignants,
en contestant les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Pour ces généralistes, il n’y a pas lieu de se précipiter pour faire le diagnostic. « Il n’y a pas
aujourd’hui de preuves scientifiques convaincantes sur ce point », souligne le professeur Vincent
Renard, président du CNGE. « À ce stade, les personnes présentent en général des troubles de
la mémoire mais qui ne les empêchent pas de vivre normalement », ajoute le docteur Laurent
Letrilliart, maître de conférence en médecine générale à l’université de Lyon.
En pratique, beaucoup de généralistes jugent inutile de délivrer trop tôt un diagnostic,
potentiellement angoissant, à des patients à qui ils n’ont pas à proposer de traitements efficaces

pour empêcher l’évolution de la maladie. À demi-mot, certains s’agacent d’une sorte de « course
au diagnostic précoce » encouragée par des neurologues désireux d’augmenter la file de leurs
patients pour monter des protocoles de recherche. « La recherche est légitime, mais il faut aussi
se poser la question du bénéfice individuel du patient », objecte le docteur Letrilliart.
De leur côté, les neurologues affirment voir arriver encore trop de patients à un stade
tardif. « L’annonce de la maladie peut certes être anxiogène. Mais il faut aussi tenir compte de
l’anxiété encore plus forte des patients et des familles qui, sans diagnostic, vivent dans
l’incertitude la plus complète face à des troubles cognitifs réels et qu’il n’est pas bon, selon moi,
de banaliser » , estime le professeur Didier Hannequin, du CHU de Rouen. « L’annonce est
toujours un coup de massue. Mais dans bien des cas, il y a aussi une sorte de soulagement de
pouvoir enfin mettre un nom sur ce qui se passe. Très souvent, les familles disent que le
diagnostic a été trop lent à venir alors que, pour eux, la maladie était devenue évidente »,
souligne Catherine Ollivet, membre de l’Erema.
Pour certains, ce diagnostic précoce permet aussi de se préparer à l’évolution de la
maladie. « Tout diagnostic doit entraîner un accompagnement et une prise en charge médico-
sociale. Intervenir tôt permet d’assurer une meilleure qualité de vie aux patients » , estime le
professeur Jean-Luc Harrousseau, président de la HAS. « On ne peut pas retarder un diagnostic
sous prétexte qu’il n’existe pas de médicament efficace. La prise en charge d’un Alzheimer ne se
résume pas aux médicaments. Et c’est bien le diagnostic qui permet à la personne d’entrer dans
un système de prise en charge globale, avec de la stimulation cognitive, un accueil de jour, des
mesures d’aide ou de formation pour les aidants familiaux… », ajoute le docteur Jean-Marie
Vetel, gériatre à l’hôpital du Mans.
Mais ce débat concerne aussi la médecine de demain, celle qui, peut-être, sera capable de
soigner la maladie d’Alzheimer. « Aujourd’hui, les nouveaux médicaments sont testés au stade
de la démence, à un moment où les capacités de récupération du cerveau sont sans doute déjà
épuisées » , explique le professeur Philippe Amouyel (CHRU de Lille, Inserm), directeur général
de la Fondation plan Alzheimer.
L’hypothèse des chercheurs est que les traitements pourraient être plus efficaces s’ils étaient
utilisés bien plus tôt. « On sait désormais qu’une maladie d’Alzheimer débute probablement dix à
quinze ans avant l’apparition des premiers symptômes », précise le professeur Amouyel.
L’attention des scientifiques se focalise donc sur cette période« asymptomatique » durant
laquelle de petites plaques séniles (plaques amyloïdes) se forment dans le cerveau de la
personne sans que celle-ci ne ressente le moindre trouble. Et tout l’enjeu est d’essayer de mieux
comprendre comment la maladie va ensuite évoluer dans le temps.
Pour y parvenir, les chercheurs essayent de mettre au point des « biomarqueurs », des examens
biologiques ou de neuro-imagerie assez sophistiqués. Certains « biomarqueurs » existent déjà.
Avec une prise de sang ou une analyse du liquide céphalorachidien (après une ponction
lombaire), les médecins peuvent repérer des protéines caractéristiques de l’Alzheimer.

Grâce à un examen de médecine nucléaire, le TEP (PET-scan), il est aussi possible de détecter
des lésions très précoces dans le cerveau. Ces instruments sont aujourd’hui surtout utilisés dans
un cadre de recherche et doivent être affinés.
Mais l’objectif est posé : identifier très tôt des personnes aujourd’hui en bonne santé mais qui
auront, à l’avenir, une très grande probabilité de développer un Alzheimer. Avec la perspective
de les faire entrer dans des essais pour développer les nouvelles générations de médicaments.
« Les enjeux éthiques sont énormes, en particulier sur la manière dont on va identifier ces
personnes et l’information qu’on va leur délivrer », reconnaît le professeur Jean-François
Dartigues, responsable du centre mémoire du CHU de Bordeaux. « La recherche est nécessaire.
Mais cela ouvre des perspectives vertigineuses, car cela revient à faire une sorte de
prédiagnostic d’Alzheimer chez des personnes qui ne sont pas encore malades », constate
Catherine Ollivet. « Nous vivons dans une société où la demande d’information et de
“transparence” est très forte.
Cette demande pose un défi à la médecine. Au nom de quoi, peut-elle retenir une partie de
l’information ? Mais en même temps, doit-elle tout dire et tout le temps ? », s’interroge pour sa
part le docteur Perrine Malzac, coordinatrice de l’ Espace éthique méditerranéen aux hôpitaux de
Marseille.
----------------------------------------
LES FORMES FAMILIALES DE LA MALADIE
Il existe une forme familiale de la maladie d’Alzheimer, d’origine génétique. Elle reste très
rare (moins de 1% des cas) et se caractérise par une apparition très précoce des symptômes.
Dans les familles concernées, environ 50% des membres, par génération, sont porteurs de
la mutation qui peut entraîner la maladie. Les personnes, désireuses de savoir si elles en
sont ou non porteuses, peuvent accéder à une consultation de conseil génétique (Centre de
référence, CHU de Rouen).
PIERRE BIENVAULT
1
/
3
100%