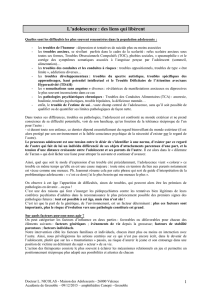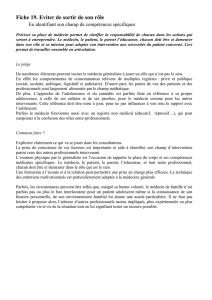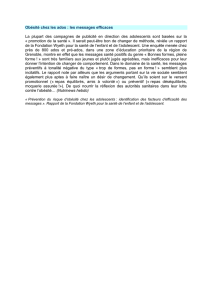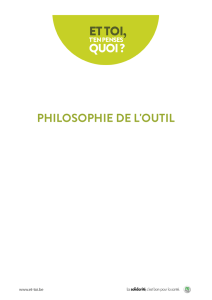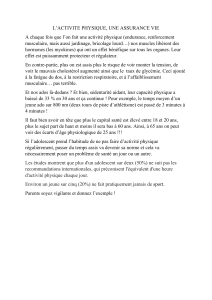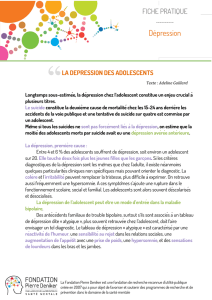Pôle 2 : Un nouveau rapport aux acteurs éducatifs

1
Pôle 2 : Un nouveau rapport aux acteurs éducatifs
Compte rendu journée du 20 janvier 2005
Ruptures de l’adolescence et stratégies de prise en charge
Intervenants:
Philippe Tedo, psychiatre, psychanalyste au centre Abadie de Bordeaux
Jean Jacques Lacombe, Proviseur Lycée Elie Faure à Lormont
Introduction de J.J Lacombe sur la formation et les pôles, notamment le GRD.
Présentation de la journée :
Matin : Intervention du Dr Tédo sur la psychopathologie de l’adolescence
Après midi : Questions/ réponses (par rapport à la conférence du matin)
Travail de groupe (3 ou 4 groupes) avec deux objectifs :
- évocation d’une problématique individuelle de ruptures. Quelle gestion a-t-on pu faire de la
situation ?
- Evocation, en termes de prévention, des stratégies de l’établissement, des façons dont on y
associe les parents, les personnels, les élèves, du projet éducatif de l’ EPLE.
Echanges rapides sur les premiers GRD vécus
Evaluation des deux journées du pôle 2
Intervention du Dr Tedo
Présentation :
- Co-fondateur, avec les docteurs Delorme et Pommereau, du pôle Aquitaine Adolescence
au Centre Abadie en novembre 1992, visant la prise en charge des adolescents suicidants et les
troubles des conduites alimentaires. Les familles sont associées à la prise en charge.
- Président de l’Ecole des Parents et des Educateurs : travail sur la parentalité et la
prévention. Cette association est agréée pour travailler avec les EPLE. Un projet pilote est en cours
pour proposer des lieux de parole pour les enseignants confrontés à des moments de crise.
Psychopathologie de l’adolescence
L’adolescence est un processus marqué par deux enjeux : la traversée pubertaire et
l’investissement des objets culturels, sociaux.
L’état des lieux
15 à 20% d’ados en France souffrent de pathologies graves qui demandent à être suivies en
structure (hôpital de jour, enseignement à la carte, CMPP)
8à 10% d’ados se sentent mal, présentent des pathologies moins graves, mais continuent
d’aller à l’école. C’est assez préoccupant.
Les pathologies évoluent selon les périodes .
Vers 1985, dans les urgences à l’hôpital, un quart des suicidants étaient des adolescents qui
rentraient rapidement chez eux, avec le conseil de consulter un psy. Aujourd’hui, le nombre d’ados
suicidants diminue
En revanche, aujourd‘hui, les consultations psychiatriques sont «submergées » par les
troubles de la conduite alimentaire et par ceux de la schizophrénie (trouble grave de la personnalité,
avec dissociation, hallucinations sur des thèmes persécutifs, revendicatifs ou mystiques)
Les pathologies de l’adolescence se rencontrent en grand nombre dans les sociétés
occidentales, économiquement avancées. Les facteurs sociaux, culturels, les modèles des relations
adultes- enfants et les valeurs jouent un rôle non négligeable.

2
Le primat du corps
Analogie entre le fonctionnement du bébé et celui de l’ado : c’est le primat du corps. Le bébé
attend d’être apaisé par les interactions sensorielles. Quant à l’adolescent, c’est avec son corps
(pulsionnel) qu’il se met en scène. Le corps et ses transformations pubertaires vont influencer le
psychisme de l’adolescent, tourné vers des préoccupations psychologiques un peu « obscures. ».
Les ados qui vont mal, au moment de la puberté et de l’émergence de la sexualité, sont dans
des conduites d’agir :
- actes externalisés : fugues, délinquance, agressions physiques et verbales, errance
- actes internalisés (contre soi) : conduites alimentaires, tentatives de suicide, scarification,
productions délirantes, moments hallucinatoires, dissociation.
Quand un adolescent se met à délirer, ce n’est pas pour autant qu’il est psychotique : c’est un
épisode délirant qui ne s’inscrit pas automatiquement dans la durée.
L’adolescent produit des symptômes qui peuvent renvoyer à la problématique des parents et de
leur propre sexualité. L’adolescent met à jour des problématiques familiales, des non dits
familiaux, des secrets.
Présentation du travail thérapeutique avec l’adolescent suicidant
1° temps : le temps du réveil après la tentative de suicide. Un psy est là .
L’adolescent est effondré sur le plan des défenses. Il met des mots sur l’événement, sur la
famille, et parfois sur son histoire singulière et tragique. Une proposition d’hospitalisation est
faite avec l’objectif d’en parler davantage ( 98% acceptent ). De même, on propose aux
parents d’être suivis par l’équipe du centre Abadie .
2° temps : le temps du regroupement dans le Centre (15 places) pendant 8 à 10 jours.
Ils présentent des traits identificatoires communs : dépressivité, morosité, rêverie, flottement
qui ne débouche sur rien, idées de suicide.
Dans cette unité, on permet à l’adolescent (e) de se poser, de cesser d’attaquer son
corps, d’utiliser des mots pour mieux situer la problématique : entretiens avec psy, en groupe
ou en individuel, ateliers, groupes de paroles.
Il existe 80 % de filles dans l’unité. Elles ont subi des violences sexuelles. Corrélation
entre abus sexuels et suicides (1/3 l’ont été physiquement, la ½ le sont psychiquement )
L’adolescent(e) suicidant(e) souffre de deux angoisses : angoisse de perte et
angoisse d’intrusion.
Les parents sont accueillis par l’assistante sociale, formée à la thérapie familiale.
L’objectif est qu’ils cautionnent le soin de leur enfant.
3° temps : la sortie de l’hospitalisation.
L’équipe donne son engagement à revoir l’adolescent(e) quelque temps après sa
sortie : consultation de suivi.
L’équipe orientera l’adolescent (e) vers une psychothérapie, ainsi que les parents.
Plus de 85% des adolescents suicidants vivent dans des familles qui ne sont pas
précaires mais qui dysfonctionnent. Aujourd’hui, l’adolescent est au centre des projets
imaginaires parentaux : on «fait tout pour lui ». Certains parents n’arrivent pas à penser qu’ils
puissent frustrer leur adolescent.
Les parents, à l’adolescence de leur (s) enfant(s) sont réveillés par leur propre
adolescence qu’ils évoquent parfois.
Il existe des parents mortifères : « cela irait mieux si on en était débarrassé ». L’ado
peut en arriver à penser que s’il disparaissait, ce serait mieux pour tout le monde.
L’adolescent suicidant est en panne d’identification, il est narcissiquement «cassé » et
attaque son propre corps (percing, scarification, brûlures..)
Les pathologies de l’adolescence

3
La métaphore «funambulique » : les expériences limites
Le fil renvoie à une dépendance, aux éprouvés corporels. L’adolescent commence à
relever des défis de plus en plus difficiles. Il finit déprimé ou a un accident et décide d’arrêter.
Lorsqu’on est sur un fil, on est dans des enjeux de mort, sous tension car obligé de tout
contrôler. Cela active les endorphines. Interaction forte entre le biologique et le psychique,
état de tension entre le plaisir et la douleur. L’adolescent est dans le déni de la chute, le déni
de la mort : il pense qu’il va réussir. Etre «funambule » c’est être addictif. Il n’y a que sur le fil
qu’il est bien. A terre, il déprime, se sent en manque, ne se sent pas exister.
La problématique de l’adolescence, c’est être sur le fil. L’adolescent va rechercher les
expériences limites, mettre sa vie en jeu avec son corps ou avec des produits. Le danger c’est
de devenir dépendant à des états limites. Alors il n’y a plus de recul par rapport à ces
expériences physiques et psychiques, il n’y a plus de sublimation possible.
La clinique des attaques du corps (maltraitance de son propre corps), c’est une
clinique du chaos associé à des états anxieux, de panique qui mettent le corps en tension et
en souffrance. L’ado peut perdre la perception et la sensation des limites corporelles.
L’intégrité corporelle n’est plus contenue.
Dans ces moments de perte des limites corporelles, l’ado attaque son corps
(scarifications, brûlures..) Cela apporte un soulagement, un apaisement des tensions
corporelles et psychiques et permet de retrouver les limites corporelles.
Les troubles des conduites alimentaires :
L’ado organise son psychisme autour de l’oralité. L’anorexique (99% des filles)
«obsessionnalise» ses conduites. A partir du regard qu’elle porte sur son corps, sur ses
perceptions corporelles, elle s’épuise à trouver les quantités d’aliments qu’il faut peser,
ingérer, rejeter pour garder la limite entre la vie et la mort. Elle pense en permanence qu’elle
peut se doser, jouer avec le plein et le vide, le moins et le plus. Ce sont des conduites
ritualisées. Elle se restaure dans un éprouvé corporel qui lui permet de penser qu’elle est
encore vivante Elle s’épuise à travailler sur les limites. Parfois, il existe des comas, voire des
décès. Il existe une transmission transgénérationnelle d’un problème de la mère. C’est
l’adolescence de la fille qui est le symptôme de la problématique de la mère.
Le travail sur le génogramme avec les adolescents permet de poser des questions sur
les secrets de famille, sur soi, de construire le roman familial.
les états dépressifs à l’adolescence :
La dépression à l’adolescence est différente de celle de l’adulte. Perte d’élan vital
chez l’adulte, accompagné d’angoisses, et somatisations. Il existe des personnes maniaco-
dépressives mais la plupart sont des dépressives ralenties.
Mais l’adolescent déprimé va, lui, poser des actes pour en sortir. Accepter d’être
déprimé, c’est accepter de se confronter à sa propre image, de parler à sa souffrance. Or,
c’est difficile pour l’ado. Il faut faire un travail préliminaire avant d’engager une démarche
thérapeutique. Il est donc indispensable de prescrire des antidépresseurs aux adolescents.
Le ministre de la Santé préconise de ne plus donner d’antidépresseurs en-dessous de
18 ans. Les généralistes n’en prescriront plus et cela évitera bon nombre de tentatives de
suicide. En revanche les psychiatres demandent que les anxiolytiques, antidépresseurs ne
soient distribués qu’à hauteur des besoins de la personne.
Pour la prévention des «rechutes », l’ado peut avoir 6 mois de traitement par
antidépresseurs, traitement accompagné d’une psychothérapie.
Les adolescents suicidants présentent des signes dépressifs : insomnies, impulsivité,
agressivité, somatisations, marginalisation (paralangage, pseudo rationalisation de leur mal-
être), conduites addictives (cannabis, médicaments, alcool), isolement parfois.
Questions/ Réponses par rapport à la conférence du matin
Q : Qu’en est-il des phobies scolaires ?

4
R : C’est un concept un peu flou, à défaut de diagnostic. Phénomène de rupture, de refus
d’entrer à l’école. Cela renvoie toujours à quelque chose de grave. La phobie est un acte violent en
négatif. Il peut y avoir une problématique suicidaire, anxieuse, psychotique. La phobie est un acte à
décrypter.
Face à un élève phobique, il faut passer le relais :
- abandonner la question pédagogique
- faire un bilan psychologique complet.
- accueillir les parents et les écouter sur l’acte de refus et sur leurs difficultés.
On peut aménager la scolarité d’un enfant phobique partiellement ou totalement. On peut
demander une déscolarisation de l’adolescent pour l’intégrer dans un Centre d’Aide Thérapeutique à
Temps Partiel ( C.A.T.T.P.) ou dans un Centre Médico Psycho Pédagogique
( C.M.P.P.) Pour les ados souffrant de pathologies lourdes avec délire, il existe les hôpitaux de jour :
soins psychiques avec un enseignement proposé.
On ne peut pas donner le choix de la scolarisation à un tel adolescent car la seule chose qu’il
redoute, c’est de lui laisser le choix. En effet, les étayages sombrent et cela peut conduire à
l’absence de limites voire au suicide.
Les pactes pervers
Certains adolescents s’associent sur des problématiques suicidaires. L’un d’entre eux peut
contaminer les autres sur le passage à l’acte. Mais parfois l’un d’entre eux, parle et dévoile le projet
morbide. Sur Internet, et par la web cam, il existe des pathologies qui débouchent sur des suicides
collectifs.
C’est à l’adolescence que se pense la mort pour les ados qui vont bien. Les autres, les ados
suicidaires, ne peuvent pas la penser, mais ils peuvent l’agir dans le fantasme d’immortalité. L’ado se
sent exister dans les conduites à risque. Si on est plusieurs à penser la même chose, on va triompher
de la mort et on recommencera.
Le phénomène «gothique » «Marylin Manson », égérie du mouvement,, peut drainer des
adolescents en mal-être. Ils s’identifient à cette culture particulièrement mortifère.
Q : Quel message adresser aux parents lors d’un suicide dans un EPLE ?
R : Si le suicide a eu lieu dans l’établissement, le chef d’établissement doit communiquer,
montrer que l’on tient la route :
- réunir le personnel de l’EPLE, en parler.
- réunir le groupe le plus concerné par le suicide, en parler, écouter. Il faut prendre soin des plus
«choqués » dans l’EPLE (arrêt de travail de quelques jours )
- faire intervenir un expert ( Centre Abadie ou autres) dans un temps très proche.
Q : Que faire par rapport aux difficultés psychologiques des enseignants ?
R : le GRICA peut venir parler des difficultés à être dans une classe, instaurer un groupe de
paroles sur les difficultés professionnelles. En tant que DRH, il est nécessaire de se préoccuper
de la difficulté d’un ATOSS, d’un CPE, d’un enseignant...
Situation exposée (les deux autres groupes n’ont pas exposé leurs travaux par manque de
temps)
Un élève interne en collège est convoqué par le Principal adjoint en présence de deux autres élèves
qui l’embêtent. Cet élève avoue qu’il est responsable de ce qui s’est passé. L’adjoint reçoit l’élève,
tremblant, qui refuse de s’asseoir, les larmes au bord des yeux. Il déclare qu’il va mal, qu’il y a des choses
qu’il ne peut pas dire.
L’adjoint envoie l’élève chez l’assistante sociale mais ce dernier refuse. L’assistante sociale convoque
l’élève, qui agresse verbalement le principal adjoint.

5
La semaine suivante, l’élève menace de mort un surveillant d’internat. On téléphone aux parents. La
mère annonce que son fils a été victime d’attouchements sexuels il y a quelques années de la part d’un
membre de la famille. Un suivi avec un pédopsychiatre a été mis en place. Le médecin scolaire prend
contact avec le pédopsychiatre. L’élève, convoqué, s’effondre en larmes devant le bureau. Il craint que ses
parents (son père est gendarme) ne provoquent un incident dans l’établissement.
Faut-il faire un signalement ?
Commentaires :
C ‘est la mère qui a dit que son fils a été victime d’attouchements. L’EPLE n’est pas
dépositaire des propos de l’enfant .
Si l’adolescent est mineur et s’il se plaint au sein de l’EPLE, on fait un signalement .
Quelquefois, cela débouche sur un non-lieu (pas de preuve) et l’adolescent est au plus mal
(pas de réparation et beaucoup de culpabilité car la famille « éclate »).
Dans le cas exposé, il faut s’occuper de l’application du règlement intérieur car il y a eu
transgression (menace de mort ). Par rapport à la transgression, il faut que quelque chose
soit signifié à l’adolescent au sujet de ce passage à l’acte. Quelle que soit la pathologie de
l’adolescent, il faut sanctionner. Cela redonne le cadre .
La prévention doit s’organiser au sein des commissions de veille éducative dans
l’établissement (penser ensemble des stratégies de l’établissement ).
Un stagiaire évoque un dispositif de prévention au sein de son collège : il s’agit d’un
groupe de 6 élèves en difficulté ayant accepté de participer à un groupe de paroles, avec des
intervenants extérieurs issus de la Mission Locale. 60 élèves au total bénéficient de ce
dispositif ( niveau 4°)
M.Tedo souligne que l’action de prévention menée ici est faite par des gens extérieurs à
l’ EPLE. On propose de faire circuler la parole mais on ne sait pas si cela est du préventif, de
l’éducatif ou du thérapeutique. Pas de lisibilité sur ce qui s’y fait .Ici, on s’engage, avec la
régularité des rencontres, dans du transfert, du psychothérapeutique à l’intérieur même de
l’EPLE. Est-ce la fonction de l’établissement scolaire? Quelle image par rapport à la COPsy ?
Si on multiplie les objets de transfert, cela devient compliqué pour l’adolescent. Il faut éviter
d’introduire des psys à l’intérieur de l’ EPLE .
Q : Que penser de l’introduction d’éducateurs de quartiers dans l’EPLE pour régler
les problèmes de certains élèves ?
R de JJ Lacombe : Sur Lormont , cela se fait à l’extérieur de l’EPLE. Le problème de
l’anonymat des élèves traités a posé question. Actuellement, on travaille au sein de la Cellule
de Veille Territoriale, dans un climat éducatif avec le C.M.S, La Maison de la Justice et du
Droit, les médiateurs de rue, autour de jeunes identifiés, nommés. Il s’agit d’avoir des
réponses concertées dans le temps scolaire et hors temps scolaire. Il faut prendre en compte
les problèmes des jeunes en temps réel .
M. Tédo présente le projet avec le Rectorat :
1. Créer des groupes de parole avec les enseignants sur des cas cliniques au sein de l’EPLE.
Une ou deux séances par an pour réguler les pratiques de groupe .Ce n’est pas un
psychodrame, ce serait un échange d’avis, de connaissances sur la situation exposée .
2.Fédérer les parents d’élèves et organiser avec eux des conférences (hors établissements
scolaires) sur des questions qui les préoccupent. Soirée à thèmes. Ces dispositifs existent
avec l’ Ecole des Parents, en d’autres lieux .
M.JJ Lacombe conclut en rappelant l’importance des Groupes de Réflexion
Déconcentrés ( G.R.D.) non seulement dans la culture et la formation professionnelles mais
aussi en termes de besoins institutionnels :
 6
6
1
/
6
100%