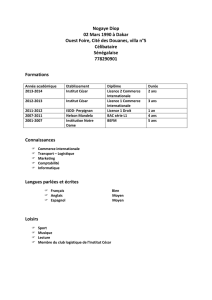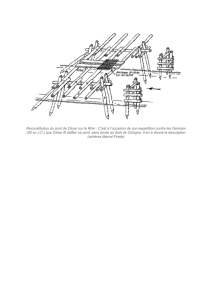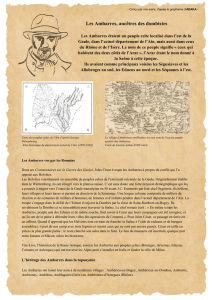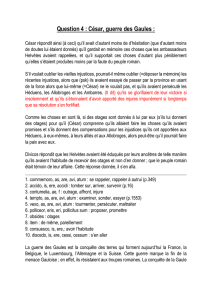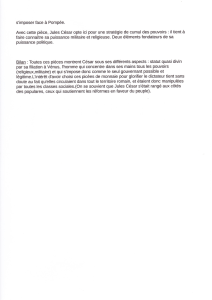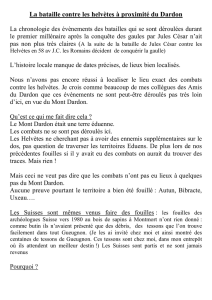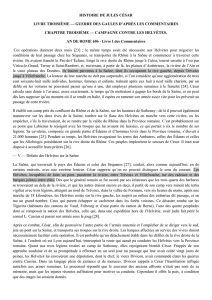Notes-GuerreDesGaules

Référence sur la migration des helvetes.?
je suis à la recherche de références, romans, ou éssais sur la migration des helvetes
décrite par jc dans la guerre des gaulles, qui sous orgétorix voulurent traverser la gaulle
pour ensemble (400 000) rejoindre la saintonge.
Il y a 4 mois
Détails supplémentaires
OK santons.... puis saintonge... c'est un peu la meme région non ? Les santons étaient
établi à pons, qui est très proche de saintes et avaient prévu d'installer les helvetes sur
l'embouchure de la gironde.
Drole d'histoire que cette migration... a part césar, je ne trouve aucune source... et
personne ne semble avoir écrit sur ce theme....
Que vient faire la Saintonge là dedans , au sens français elle est globalement en Charentes
...
Le pays des Santons , je suis d'accord
Jules César, La guerre des gaules, I, 2: "Orgétorix était chez les Helvètes l'homme de
beaucoup le plus noble et le plus riche. Sous le consulat de Marcus Messala et de Marcus
Pison, séduit par le désir d'être roi, il forma une conspiration de la noblesse et persuada
ses concitoyens de sortir de leur pays avec toutes leurs ressources : « Rien n'était plus
facile, puisque leur valeur les mettait au-dessus de tous, que de devenir les maîtres de la
Gaule entière ». Il eut d'autant moins de peine à les convaincre que les Helvètes, en raison
des conditions géographiques, sont de toutes parts enfermés : d'un côté par le Rhin, dont
le cours très large et très profond sépare l'Helvétie de la Germanie, d'un autre par le Jura,
chaîne très haute qui se dresse entre les Helvètes et les Séquanes, et du troisième par le
lac Léman et le Rhône, qui sépare notre province de leur territoire. Cela restreignait le
champ de leurs courses vagabondes et les gênait pour porter la guerre chez leurs voisins :
situation fort pénible pour des hommes qui avaient la passion de la guerre. Ils estimaient
d'ailleurs que l'étendue de leur territoire, qui avait deux cent quarante milles de long et
cent quatre-vingts de large, n'était pas en rapport avec leur nombre, ni avec leur gloire
militaire et leur réputation de bravoure."
Apparemment, Orgétorix a aussi des ambitions politiques. Il s'allie en secret avec le
Séquane Casticos, et l'Eduén Dumnorix auquel il offre sa fille en mariage (Jules César,
La guerre des gaules, I, 3). Les Helvètes ont vent du complot, et demandent à Orgétorix
de venir plaider sa cause devant eux. Orgétorix s'y présente accompagné des siens, de ses
clients et de ses débiteurs, leur nombre lui permet de ne pas avoir à plaider sa cause. Mais
les Helvètes ne sont pas dupes, il décident de l'attaquer, Orgétorix se suicide dans des
circonstances obscures (Jules César, La guerre des gaules, I, 4).
http://www.arbre-celtique.com/encycloped...

http://www.arbre-celtique.com/encycloped...
http://www.latinistes.ch/Textes-scripta/...
et un bouquin consultable sue le net ( vers les pages 143 )
http://books.google.fr/books?id=mgIjGO6d...
Les santones : ceux qui cheminent et la vilel de corent
http://www.arbre-celtique.com/encyclopedie/santons-736.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Charles_Gleyre_Les_Romans_p.jp
g
Divico est né vers 130 av. J.-C. et mort après 58 av. J.-C. Il fut le chef des Tigurins, une
des tribus composant la nation celte des Helvètes. À la tête de celle-ci, il pénétra à la fin
du IIe siècle av. J.-C. dans la province de Gaule narbonnaise, suivant les Cimbres, les
Ambrons et les Teutons. Lors de la bataille d'Agen (-107), les Tigurins battirent l'armée
romaine dirigée par le consul Lucius Cassius.
Aux alentours de 60 av. J.-C., Jules César, dans son ouvrage la Guerre des Gaules, admet
que Divico a participé à la bataille d'Agen aussi bien qu'à la migration de 58 av. J.-C. où
il fut ambassadeur des Helvètes auprès de César. Les Helvètes furent battus lors de cette
bataille. Qu'il se soit agi du même Divico ne faisait aucun doute pour César ; néanmoins
cette identification est sujette à caution aujourd'hui.
http://pagesperso-orange.fr/g.chp/mv_hist_cesar.htm
il y a un peu de tout….
http://forumdespeuplesenlutte.over-blog.com/article-13581896.html
la politique de la terre brulee
http://helvetie.net/DHS%20-%20helvete/2.htm

Du début de la guerre des Gaules à la défaite de Bibracte (58 av. J.-C.)
Après deux à trois ans de préparatifs, persuadés par Orgétorix d'émigrer vers la
Saintonge, "263'000 Helvètes, 36'000 Tulinges, 14'000 Latobices, 23'000
Rauraques, 32'000 Boïens" (B.G. 1, 29), soit 368'000 âmes (données discutables
et discutées), se mettent en marche en mars 58 av. J.-C. Pratiquant la politique
de la terre brûlée pour s'ôter tout espoir de retour, dit César, ils auraient ainsi mis
le feu à leurs ville, une douzaine, à leurs villages, environ quatre cents, et aux
maisons isolées (B.G. 1, 5). César ne nomme aucun de ces oppida et peu
d'entre eux ont fait l'objet de fouille au-delà de sondages, en particulier dans
leurs fortifications. L'oppidum principal semble être celui de Berne-Enge. Le
Jensberg, plus à l'est, le Üetliberg près de Zurich, et Altenburg sur le Rhin (dans
le Bade-Wurtemberg) peuvent certainement entrer dans cette catégorie, tout
comme le Mont Vully et Yverdon-les-Bains. Les villages (vici) ou les fermes
(privata aedificia) sont encore très mal connus.
A la fin mars 58, les émigrants se rassemblent dans les environs de Genève,
oppidum à l'extrémité nord de la province romaine de la Gaule narbonnaise.
César s'y précipite, coupe le pont sur le Rhône et leur interdit de passer par la
Narbonnaise. Les Helvètes, contraints de traverser le territoire des Séquanes par
le Jura, gagnent la Saône où les Tigurins sont massacrés par les légions
romaines. le vieux Divico, qui a participé à la bataille d'Agen,ent envoyé en
ambassadeur auprès de César. Les pourparlers échouent, César voulant forcer
les Helvètes à s'établir à l'endroit de son choix. L'épopée, marquée par de
nombreuses péripéties, se termine dans le sang, à la bataille de Bibracte. César
renvoie les Helvètes, dans leur ancien territoire pour les empêcher, dit-il,
l'installation de Germains d'outre-Rhin sur le plateau suisse, ce qui aurait
constitué une menace pour Rome et sa province.
Les conséquences du désastre de Bibracte ont dû se faire sentir durant des
générations. D'après César, les émigrants qui retournèrent chez eux n'étaient
que 110'000. C'est très probablement à cette occasion que les Helvètes furent
mis au bénéfice d'un traité (foedus) rompu en principe par l'envoi d'un contigent
de 8'000 hommes en 52 av. J.-C. pour prêter main forte à Vercingétorix et
l'armée gauloise devant Alésia.
Le retour
Les raisons précises de la migration des Helvètes restent obscures: incursions
répétées de Germains selon César, motifs d'ordre économique ou politique qui
nous échappent. De retour sur le Plateau suisse, les Helvètes reconstruisent:
Berne et Yverdon sont à nouveau occupés; un petit oppidum est installé à
Sermuz, tout près d'Yverdon. Sont également habités le bois de Châtel près
d'Avenches, le Jensberg et Altenburg, avec une nouvelle occupation sur l'autre
rive du Rhin, à Rheinau et Zurich, au pied du Lindenhof. Windisch voit

l'installation d'un petit oppidum, comme sans doute la colline de la Cité à
Lausanne.
On trouve la mention d'Elveti sur une inscription (10/9 av. J.-C.) du
Magdalensberg (Carinthie), et celle du pagus Tigurinus à l'époque impériale dans
la région d'avanches. Divico, Orgétorix, Namméios et Vérucloétios les deux
interlocuteurs de César à Genève, Vatico qui figure sur les deux monnaies de la
région d'Avenches et du bois de Châtel et Ninno, à Sermuz notamment, sont les
seuls Helvètes sortis de l'anonymat. César avait pourtant trouvé dans le camp
des vaincus des tablettes identifiant les émigrants, écrites en caractères grecs.
1
/
4
100%