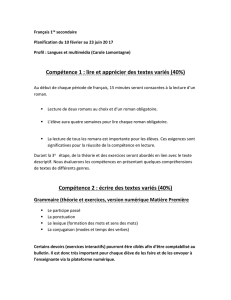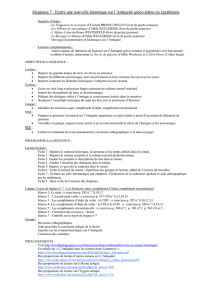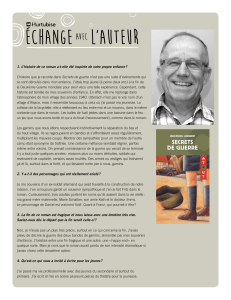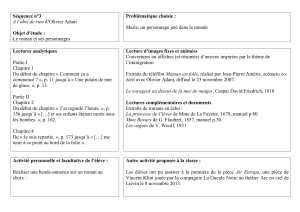Word - Université de Provence

Verbatim de l’intervention de Pierre Kaser (Université de Provence, JE LCT) à la première journée du stage organisé
à Aix-en-Provence par la Jeune Équipe Littérature Chinoise et Traduction (Université de Provence).
Vendredi 3 février 2006.
Traduire le roman chinois ancien en langue vulgaire : le cas du roman érotique.
La littérature dont il va être question est une littérature de fiction qui souffre depuis sa naissance du mépris et de la
méfiance de l’orthodoxie lettrée chinoise et qui, d’une certaine manière, est toujours considérée comme inférieure, de
moindre qualité et d’intérêt secondaire dans l’élucidation et l’exploration de la culture et de la civilisation chinoises
anciennes. Le xiaoshuo ancien en langue vulgaire, est au même titre que l’expression dramatique chinoise, avec
laquelle elle partage tant, un genre qui fut considéré comme mineur incapable de rivaliser avec la poésie et la prose
classiques.
Ce qui lui valut de se retrouver en bute à un jugement aussi négatif et tenace -- jugement qui a été pris en charge par
les différentes écoles sinologiques jusqu’à nos jours - , c’est avant tout parce que cette littérature recourt, non pas à la
langue noble, le wenyan, la langue classique par excellence, celle qui prend ses modèles dans les textes fondateurs de
l’Antiquité, mais à la langue parlée, appelée baihua - blanc signifiant ici limpide - , ou, pour être moins catégorique,
une langue relâchée qui échappe aux règles de l’allusif et de la concision, une langue littéraire néanmoins, plus
proche de la manière dont on devait s’exprimer dans les allées et les venelles des temps anciens, que du sabir des
mandarins de la Chine impériale. Bien évidemment, cette langue qui devient porteuse d’une littérature écrite à partir
grosso modo du XIVe s. a évolué dans le temps et connut des variantes dans l’espace, puisqu’elle resta toujours très
perméable aux influences des dialectes. Cette perméabilité et cette capacité à évoluer en compliquent naturellement
l’approche.
Une part du mépris dont elle est victime, vient aussi de son origine. Elle est née sous les influences successives et
conjuguées du prêche bouddhique attesté à la fin des Tang (618-907), de la tradition de la narration des conteurs
publics très développée sous les Song (960-[1127]-1279), du perfectionnement de l’imprimerie et de l’attachement
du public lettré et semi-lettré à un genre de divertissement principalement urbain notamment à la fin des Ming (1368-
1644) et au début des Qing (1644-1911).
Ce type de narration s’est développé dans différents formats, allant du conte - narration d’un seul tenant, ou en courts
chapitres, d’une longueur de 5000 à 30 000 caractères chacun, proposé en recueil de 4 à 40 récits -, au roman-fleuve
de cent de chapitres et plus, en passant par toutes sortes de formats intermédiaires : 12, 20, 24, 36, … 60 chapitres.
Quel que soit le format retenu, l’expression romanesque en langue vulgaire conserve des constantes. Outre
l’utilisation de la langue vernaculaire, ces fictions intègrent, dans une proportion très réduite, des passages poétiques,
ou non poétiques, en langue classique et usent, avec plus ou moins d’insistance, des tournures des anciens conteurs
pour entretenir auprès du lecteur l’illusion de la narration orale.
L’inventaire le plus complet du genre recense quelque 1200 titres dont seule une infime proportion a définitivement
disparu. Fournir une rapide description de cet ensemble est naturellement impossible, du reste ce n’est pas l’objet de
notre rencontre. Mais sachez que le jugement qui souvent répété veut que tous ces romans se ressemblent et qu’en
lire un suffit à forger son jugement (en général, négatif) est erroné. Certes, la grande majorité de ces textes partage la
même tournure narrative, le même ton qui conjugue moral et divertissement, pédagogie et extravagances, avec ses
passages obligés et ses clichés, son ‘tour de main conteur’, mais cet air de famille est le ferment d’une diversité
thématique très grande. Soit, pour faire court, le roman chinois en langue vulgaire d’avant l’intervention des diables
étrangers, fournit de quoi occuper plusieurs vies et à chacun une masse considérable d’œuvres à découvrir, et à
révéler ... et comment mieux les révéler que par la traduction.
L’approche d’un tel mastodonte est vous l’aurez deviné délicate. Il faut, sinon une méthode, du moins choisir un
angle d’attaque, mettre au point une stratégie, définir des priorités, circonscrire un périmètre d’intervention. On le
fera selon ses orientations personnelles, pour en tirer des enseignements sur la Chine des dix derniers siècles de son
passé impérial, ausculter la psyché sa population, étudier l’évolution de sa langue, combler des vides dans l’histoire
des lettres chinoises et les liens que se nouent entre toutes ses expressions littéraires, mettre en vedette des écrivains

de génie, s’attacher à élucider les prémices de la critique littéraire, juger de l’imaginaire chinois ou faire revivre un
monde évanoui avec la fin de l’empire, que sais-je encore ? Dès lors qu’on s’est doté des armes nécessaires, on
pourra partir à l’assaut de ce monde dont on ne connaît qu’une infime parcelle.
C’est bien là la première difficulté, car pour y parvenir dans de bonnes conditions, il faut allier les compétences
indispensables à l’étude de la culture classique, la Grande !, donc être capable de lire la langue classique – ou plutôt
toutes les langues classiques -, celle des penseurs, celle des chroniques historiques, des monographies locales, des
poètes, des prosateurs de toutes les époques et aussi acquérir une maîtrise des différents stades de la langue parlée :
double tache , qui n’est accomplie qu’après de longues années de travail (disons cinq ans, dix ans ...) : il faut donc un
brin de folie pour dépenser autant d’énergie pour se pencher sur un genre réputé vil -- encore plus pour envisager
d’en explorer les marges et les recoins les moins glorieux.
Fort heureusement, la tache n’a pas rebuté, ni les Occidentaux, ni les Asiatiques qui ont pris en charge, souvent dans
l’incompréhension générale, l’étude de ce domaine. Certains, sans doute encore plus fous que les autres, se sont
attachés à mettre une part infime de ce corpus à la disposition des lecteurs. Si les publications savantes sur le roman
chinois, ne sont pas légion, voire même en net recul ces dix dernières années, le domaine de la traduction a connu
chez nous un essor tout à fait notable. Dressons un rapide bilan à partir d’un relevé des traductions disponibles en
français [cf. document téléchargeable fourni aux stagiaires, sur lequel figure également l’ensemble des références
bibliographiques non reproduites ici.] :
Résumé : On y retrouve 1. les grands chefs-d’œuvre du romans fleuve, soit les Sida qishu (Quatre romans
Extraordinaires) des Ming [Shuihuzhuan, Sanguo yanyi, Xiyouji, Jin Ping Mei] et Hongloumeng, le chef-
d’œuvre des Qing, 2. un choix assez vaste de contes tirés de quelque 16 collections plus ou moins fameuses,
rendues soit dans leur totalité soit par bribes, et 3. une petite poignée de romans de taille intermédiaire, dont le
Rulin waishi est le plus long avec plus de 50 chapitres, soit en ajoutant des titres aujourd’hui sortis des
rayonnages des librairies à peine une cinquantaine de titres, sur le millier disponible ....
C’est peu par rapport à ce qui reste à faire, mais aussi beaucoup par rapport à ce qu’on peut lire en d’autres langues
européennes. [Je ne parle pas du Japon qui en propose bien plus depuis bien plus longtemps : il est vrai que
l’engouement du public nippon pour cette littérature ne date pas d’hier, mais de la période Edo : voir OKI Yasushi,
Ôtsuka Hidetaka, “Chinese Colloquial Novels in Japan: Mainly During The Edo Period (1603-1867)”, in
Claudine Salmon (ed.), Literary Migrations. Beijing (1987).].
L’intérêt pour le roman chinois en France, n’est pas récent. Il connut au XIXe s. un engouement qui sera jugé
sévèrement par Paul Demiéville qui ne comprenait pas pourquoi un grand sinologue comme Stanislas Julien (1797-
1873) avait pu consacrer un peu de son temps à la traduction de ce qui n’était pour lui que des romances sans saveur
ni profondeur :
“Un des aspects les plus piquants de l'œuvre de Stanislas Julien (1797-1873) est l'intérêt qu'il porta à des
textes de littérature vulgaire qui de son temps étaient mésestimés en Chine dans les milieux lettrés... Il
s'attacha (...) à toute une série de petits romans à l'eau de rose dont le choix ne s'explique guère ... d'autres
encore extraits de divers recueils. Je ne sache pas que ces petits récits sentimentaux aient été particulièrement
populaires en Chine ... . Sans doute Julien les choisit-il parce qu'il les trouva parmi les livres envoyés en
France par les missionnaires, parce qu'il tenait à étudier des textes en langue vulgaire, et parce qu'ils
révélaient au public français des mœurs que les Européens ne pouvaient alors observer de visu. [...] Mais
peut-être l'intérêt porté par Julien (et par d'autres sinologues de son époque) au roman et au théâtre chinois
était-il dû avant tout au fait que ces genres étaient mieux adaptés au goût européen que les Classiques ou que
la poésie.” Paul Demieville, « Aperçu historique des études sinologiques en France », Acta Asiatica (Bulletin
of the Institute of Eastern Culture), 11, Tokyo, 1966, p. 56-110.
On a ici le condensé de toutes les critiques et de la méfiance vis-à-vis du roman ancien en langue vulgaire dont a fait
preuve à son égard la sinologie française. Il est vrai que les premiers à se pencher sur le genre et à en offrir des
traductions le firent avec peu de délicatesse. Voyez comment Georges Soulié de Morant (1878 -1955) en parlait :
«[Les romans] ont les mêmes qualités et les mêmes défauts que les pièces de théâtre : l’action est lente,
l’intrigue est à peine fouillée et toujours retardée par des conversations interminables qui représentent

fidèlement d’ailleurs celles de la vie réelle. » Essai sur la littérature chinoise, Paris : Mercure de France,
1912.
Et Soulié en traduisit - ou plutôt en adapta -, une bonne douzaine ! Il faudra attendre les années 70 du XXe s. pour
voir grâce à André Lévy et Jacques Dars, et aussi grâce au soutien d’Etiemble, cette littérature de fiction finalement
prise en considération et équitablement défendue.
En regardant d’un peu plus prés ce relevé des états de services de nos traducteurs et éditeurs, vous constaterez qu’un
domaine est particulièrement représenté : il s’agit du domaine érotique pour lequel nous disposons de pas moins de
13 traductions de romans, chiffre qui peut monter jusqu’à 15 et des poussières, si on prend la peine d’ajouter les
collections de contes qui trouvèrent là leur thématique de prédilection et qui ont été rendues entièrement ou
partiellement. Comment expliquer cette particularité française qui n’est pas prête de nous être ravie, même si
plusieurs publications ‘Made in USA’ récentes nous font craindre d’être rejoint d’ici peu !
Un élément d’explication est le goût du public français pour ce registre de la littérature de fiction : notre littérature a
toujours été très prolixe dans ce domaine. Il n’est que de consulter la monumentale Anthologie des lectures érotiques
qu’établit Jean-Jacques Pauvert en quatre gros volumes (1979-1995) pour s’en assurer, ou de se rendre dans une
bonne bibliothèque ou le cas échéant dans une excellente librairie. Plus besoin de tenter une incursion dans l’enfer de
la BNF dont les trésors ont été édités .... et sont accessibles sur le net (gallica.bnf.fr).
Le goût supposé, ou bien réel, pour les narrations coquines extrême-orientales a été pleinement pris en compte par
un éditeur qui totalise presque 100 % des publications dans ce registre. Il s’agit des Editions Philippe Picquier, Arles.
Même si c’est un secret pour personne, j’avoue avoir contribué à établir cette performance en signant trois
traductions sous le pseudonyme d’Aloïs Tatu. À ce titre, je dirai un mot du processus qui, semble-t-il, vient d’arriver
à son terme : Philippe Picquier nous disait, lors d’une intervention récente donnée à Aix-en-Provence [ ], qu’il ne
comptait plus poursuivre dans cette direction. De son côté, Boris Goiremberg qui sous le couvert de quatre
pseudonymes différents et toujours en collaboration d’un Huang San qui n’est autre que M. Chan Hing-ho, éminent
chercheur au CNRS dont je vais bientôt reparler, en a traduit 5, m’avouait, il y a peu, ne plus ressentir le même
engouement que par le passé pour ce type d’activité et chercher à se ‘recycler’. André Lévy n’a peut-être pas dit son
dernier mot - il ne devrait pas avoir de difficulté à publier. Quant à votre serviteur, d’autres taches l’attendent,
notamment une œuvre romanesque d’exception à faire connaître et apprécier au public français : les belles nouvelles
et contes de Li Yu (1611-1680). Je peux donc annoncer, sans trop de risque de me dédire, la disparition définitive
d’Aloïs Tatu. Face à ses perspectives de stagnation prévisible, je peux tenter de dresser un rapide bilan qui pourrait
rester valide un certain temps.
Pour faire vite, je dirais que le résultat des quinze années qui viennent de s’écouler a été rendu possible grâce au
travail réalisé par Chan Hingho [Chen Qinghao]. Ce spécialiste d’origine chinoise, chercheur au CNRS, a, entre
autres activités de recherches et d’éditions, passé de nombreuses années à collecter les éditions anciennes de romans
érotiques. L’aboutissement de son travail fut la parution à Taiwan d’une collection – « Siwuxie huibao » -, totalisant
36 gros volumes ; elle propose le choix le plus étendu d’ouvrages relevant de ce genre, soit quelque 35 productions
présentées dans des éditions critiques d’une rare qualité.
Les plus sceptiques se diront que c’est beaucoup d’énergie dépensée pour un piètre profit ; les amateurs, les
traducteurs et les chercheurs du monde entier, au contraire, saluent sa ténacité et sa rigueur. On peut affirmer que
concernant les études sur la littérature érotique chinoise, et même le roman chinois en langue vulgaire, il y a un
‘avant’ et un ‘après’ la publication de cette collection. Avant, on connaît à peine une dizaine de textes dans des
éditions de qualité médiocre - chacun étant limité à quelques fac-similés rares et onéreux ou aux fonds de sa
bibliothèque la plus proche, quand il peut y accéder . Il me souvient d’un temps où en RPC seuls les chercheurs les
plus âgés pouvaient obtenir le droit de consulter les éditions de textes licencieux - interdiction leur été faite de les
recopier ; du reste, aucune revue n’aurait osé publier leurs commentaires. Maintenant, chacun peut y aller de son
analyse grâce à la collection qui a réussi à passer le Détroit. Plusieurs ouvrages qui ne fournissaient que des résumés
ont même été d’excellents succès de librairie. On ne peut plus dire comme le faisait encore en 2000, Jean-Jacques
Pauvert :
"La Chine où la littérature érotique est inexistante depuis le Ve siècle av. J. C., va connaître une période mal

déterminée (approximativement 1630-1660), où fleuriront quelques romans érotiques. .... Mais l’impitoyable
censure de la dynastie Ts’ing devait les faire disparaître de Chine dans la majorité. ... . On ne reverra plus
jamais en Chine une trouée de ce genre dans la chape de plomb d’une censure impitoyable. Aujourd’hui
encore, où il est toujours interdit de parler d’amour et de s’embrasser dans la rue, une telle floraison de
textes érotiques est inimaginable dans ce pays. Pourquoi a-t-elle eu lieu précisément au milieu du XVIIe
siècle, alors que les textes érotiques étaient pourchassés, et pourquoi cette période explosive n’a-t-elle pas
duré ? Aucun sinologue n’en a jamais fourni de raison." La littérature érotique. Paris : Flammarion,
"Dominos", 2000, 128 p., p. 65-66
Certes, le travail d’élucidation reste encore à accomplir, mais on peut, dors et déjà, allonger la période par les deux
bouts, et ne plus s’en tenir à une vision folklorique et anecdotique : le roman chinois n’a pas disparu avec les
Mandchous et leur censure. Le fait que, malgré elle, on dispose d’autant de titres et d’éditions anciennes, montre que
le phénomène ne fut pas aussi passager qu’on l’a longtemps pensé. Naturellement, des enquêtes rendues difficiles par
la discrétion qui entoure la diffusion de cette littérature livreront sans doute un jour prochain des lumières sur cette
aventure autant littéraire que commerciale. Cette publication - celle de Chan Hing-ho - constitue en tout cas un point
fort de ce mouvement d’approfondissement.
Mais revenons à la traduction : bien entendu, Chan et son fidèle assistant, Boris Goiremberg ont pu exploiter pour
leurs traductions ces éditions ; le plus surprenant est qu’André Lévy n’y ait pas eu accès lorsqu’il traduisait les
recueils de contes pour Picquier. Sans le travail de Chan, je n’aurais sans doute jamais accepté de me pencher sur un
genre tel que celui-ci, principalement pour éviter de dire de trop grosses bêtises.
Avant, les traducteurs s’en remettaient au hasard de la découverte d’un imprimé ancien, rare donc jugé idéal, sinon
original... leurs explications étaient pour le moins embrouillées et peu convaincantes. Voici ce qu’on peut trouver
concernant le Rouputuan (Chair, tapis de prière), dans l’édition de 1962 qui en fournissait la première traduction
française Jeou-P’ou-T’ouan ou la chair comme tapis de prière. [Pierre Klossowski (trad.), Paris : J.-J. Pauvert],
indication qui est toujours pieusement reproduite dans la réédition en format poche 10/18, 1995.
“La traduction de ce roman a été établie sur l’édition originale chinoise signalée au Catalogue des romans
populaires chinois de Souen K’ai-ti “ (La chair comme tapis de prière).
Si l’ouvrage de Sun Kaidi [(1898-1986)] (Zhongguo tongsu xiaoshuo shumu, 1932), est toujours utile, il
comporte un grand nombre d’erreurs, levées pour certaines par la synthèse des inventaires de ce type dressée
par le japonais Ôtuska Hidetaka, Zôho Chûgoku tsûzoku shôsetsu shomoku. Tôkyô : Kyûko shoin, 1987. En
l’occurrence, on peut émettre les plus grandes réserves sur ce jugement quelque peu ‘tape à l’œil’.
Ce roman a été retraduit en français depuis. On pouvait donc espérer une mise au point ; il en eut une :
« La version française que nous donnons ci-après est une version intégrale, établie sur la base des deux textes
qu’il nous a été matériellement possible de consulter : celui conservé à la Bibliothèque nationale au
Département des manuscrits orientaux sous la cote JA2762 et celui conservé à la Bibliothèque de l’Institut
national des langues orientales sous la cote CHI8304, ces deux textes étant conformes entre eux. » (De la
chair à l’extase, p. 22)
Certes les deux textes sont effectivement identiques, mais c’est malheureusement celui de l’édition japonaise
de 1705 - donc pas la meilleure édition disponible ! Mais ce n’est pas le plus grave. Dans certains tirages,
notamment celui de la BN, cette édition est présentée en quatre cahiers portant le nom d’une saison en guise
de mode de classement. Christine Corniot, la traductrice bombardée spécialiste, en extrapole la structure de
l’ouvrage, pour elle celle-ci est “explicitée par la division en quatre “saisons”, [et] d’une surprenante
simplicité” (p. 9). P. Hanan qui traduisit l’ouvrage [Li Yu, The Carnal Prayer Mat. New York : Ballantine
Books, 1990] rappelle pour sa part - et je le suis entièrement - le lien avec le théâtre tel que Li Yu le pratiquait
justement, qui pour être extrêmement fluide et percutant, n’en est pas moins très travaillé et sûrement pas
“simple”. Hanan, auteur d’une excellente monographie sur Li Yu [The Invention of Li Yu. ], avait travaillé sa
traduction à partir d’éditions anciennes conservées aux USA. Il a pu la revoir après la consultation du
manuscrit japonais qui en fournit la version la plus complète et la mieux établie et aussi une date 1657. Sa
traduction souple et élégante est indiscutablement la meilleure traduction disponible à l’heure actuelle du

Rouputuan.
J’en profite pour signaler un autre désagrément qui provient de ce que je n’hésite pas à qualifier d’erreur de
casting pour une traduction de commande. Le manque de préparation de celui ou celle à qui on la confie
conduit aussi le ‘non-spécialiste’ à tirer des conclusions hâtives et hasardeuses . Comme ici, toujours avec De
la chair à l’extase :
« C’est un ouvrage à part dans la littérature romanesque, non seulement en raison de son caractère érotique,
mais de sa densité : vingt chapitres, c’est très court pour un roman chinois et c’est un premier paradoxe :
voilà un livre qui ne semble pas outre mesure “commercial” » (p. 7)
Dommage ! Le format n’a en effet rien de surprenant, puisque c’est celui le plus souvent retenu par les auteurs
d’érotiques et la lecture des commentaires associés à chaque chapitre montre que leur auteur (Li Yu) fait tout
pour convaincre son lecteur qu’il est en possession, ou va entrer en possession d’un chef-d'œuvre. Lisons juste
celui qui est attaché au premier chapitre :
Voici un roman bien excitant ! M’est avis que lorsqu’il sera achevé, tout un chacun en fera l’emplette et le
dévorera. Les seuls à s’en abstenir seront les puritains. Encore que seuls parmi eux les vrais rigoristes ne
devraient ni l’acheter ni le lire ; quant aux autres, ceux qui par une rectitude d’apparat trompent leur monde,
ils ne s’en priveront sûrement pas, même si, comme il a été proposé, ils n’oseront pas en faire eux-mêmes
l’achat et devront prier un tiers de le leur procurer. Ne se risquant pas plus à le lire au grand jour, c’est en
catimini qu’ils s’en délecteront. [P. Kaser (trad.) in Jacques Dars, Chan Hingho, Comment lire un roman
chinois. Arles : Picquier, 2001, p. 182-196].
On pourrait reprendre la traductrice sur bien d’autres points de détails, mais le reproche qu’on ne peut
manquer de lui faire est de n’avoir pas pris la mesure du texte qu’elle devait traduire avec tous ses à-côtés,
notamment les commentaires de fin de chapitres qui offrent des visées très précises sur les intentions de
l’auteur ; ce manque de “sérieux” a eu me, semble-t-il, des conséquences dramatiques sur sa façon
d’envisager le texte et donc de le traduire, mais, le mieux ne serait-il pas de livrer une troisième traduction de
ce texte qui passe pour le chef-d'œuvre du genre érotique. Il est, en effet, facile de critiquer, faire est plus
délicat.
Mais abrégeons et tirons une leçon de ce constat. Une des exigences majeures qui s’impose au traducteur de roman
chinois ancien (érotique ou pas) (comme de tout texte quelles que soient sa nature et son époque) est de s’assurer
qu’il dispose bien de LA BONNE EDITION de son texte : respect par rapport au texte, correction minimum vis-à-vis
de son futur lecteur.... les éditions de Chan Hing-ho font gagner un temps considérable, ses conclusions aussi, même
si rien n’interdit de les mettre en question sur des points de détail, voire de les pousser encore plus loin.
Après le temps de formation (les cinq ou dix années dont je parlais tout à l’heure), ce travail de préparation est le
plus long dans le processus de traduction. Il comprend également, le temps d’élucidation de certains éléments du
texte, son paratexte [nom de maison d’édition, les illustrations, les commentaires, préfaces], puis l’inspection de
toutes données vers lesquelles on est conduit lorsqu’on part sur la piste de l’identification du
rédacteur/concepteur/compilateur, voire de l’auteur/commentateur/préfacier : cette quête met en contact avec tout un
éventail de matériaux presque essentiellement rédigés en langue classique : monographies locales, recueils de prose,
de poésies, anthologies, encyclopédies ... mais aussi de travaux récents : inventaires, dictionnaires généraux et de
termes techniques, en l’occurrence médicaux/anatomiques. À ceci s’ajoutent la consultation de traductions et les
travaux sinologiques dont on suppose qu’ils pourraient avoir un rapport avec l’objet de la recherche, etc. Le temps
de recherche en amont n’est, bien évidemment, pas proportionnel à la taille de l’ouvrage : il peut prendre plusieurs
mois même pour un ‘petit roman de rien du tout’, avec toujours la même interrogation « pourquoi tout cela ? » et la
réponse : c’est indispensable pour ne pas se fourvoyer, ou, ne pas se risquer à dire des bêtises du genre de cette
nouvelle bévue tirée de la préface à De la chair à l’extase :
« C’est à coup sûr une œuvre de la maturité, probablement même, à notre sens, des dernières années.” (p. 19)
Or, il est plus vraisemblable que Li Yu le pond à l’âge de 45-46 ans, alors qu’il a encore 23 ans à vivre !
Désolé, j’avais pourtant dit que je ne m’en prendrais plus à elle. Changeons de victime, avec une bêtise encore
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%