2.1. Projet scientifique de l`unité - Vague D - CEMAf

Unités de recherche
Vague D : campagne d’évaluation 2012-2013
Février 2012
1
Vague D :
campagne d’évaluation 2012 - 2013
Unité de recherche
2.1. Projet scientifique de l’unité
1. Présentation de l’unité
a. Historique
Le CEMAf, fondé en 2006 à partir de la fusion de trois UMR (MALD, IEA, SPAN) est devenu rapidement un
laboratoire majeur dans le paysage national et international des études africaines. Porteur depuis sa constitution du
RTP « Etudes africaines », puis du GIS qui doit lui succéder, porteur également de projets ANR transversaux, il a
entretenu avec les autres unités du champ un dialogue constant et fructueux et des recherches conjointes. Le CEAf,
fondé en 1957, fut l’un des premiers laboratoires consacrant ses travaux à l’Afrique et aux pays de la diaspora
africaine, et sa réputation n’est plus à faire. Le CHSIM, dès 1994, a eu « pour objectif de rompre l'enclavement » de la
recherche sur le monde arabe et musulman. Le CEAf et le CHSIM ont pour tutelle conjointe l’EHESS, qui doit rejoindre
avec deux tutelles du CEMAf, l’Université Paris 1 et l’EPHE, le futur campus Condorcet au sein du PRES HESAM. Ces
trois unités, à vocation pluridisciplinaire (historiens, anthropologues, sociologues, politistes, archéologues), ont
décidé, avec l’accord de leurs tutelles universitaires et EPST (CNRS, IRD), d’unir leurs forces pour se regrouper au sein
d’une nouvelle UMR au rayonnement prévisible qui doit devenir le pôle français (et européen) le plus important des
recherches en sciences humaines et sociales sur l’Afrique. La proximité des axes scientifiques des trois unités, la mise
en commun de leurs bibliothèques spécialisées, la longue habitude de travaux collaboratifs entre les chercheurs qui
les composent doivent permettre d’encore améliorer une productivité déjà excellente. Par ailleurs, l’expérience de la
fusion positive qui a permis la création du CEMAf, à travers l’accent donné à une grande transversalité, donne les
outils nécessaires pour fonder une nouvelle identité, loin d’une juxtaposition d’équipes. C’est sur ces bases que des
réunions communes ont été organisées depuis plusieurs mois pour envisager cette fusion, et qu’un projet scientifique
commun (décliné ci-dessous) a été élaboré pour la future grande unité.
b. Caractérisation de la recherche
L’unité proposée à la création a pour objectif, comme celles qui doivent la composer l’avaient déjà,
d’approfondir les connaissances historiques, anthropologiques, archéologiques, etc., concernant le continent africain,
et par là-même, au delà de la recherche fondamentale, proposer des réponses aux enjeux sociaux, économiques ou
culturels. Le programme scientifique de l’unité se fonde sur l’interdisciplinarité, en partant du constat que le
saucissonnage des réalités sociales en domaines séparés fait obstacle à la compréhension des faits sociaux : il est clair
que l’on ne peut rien comprendre des réalités actuelles sans éclairage historique, et que l’enquête historiographique
se fonde en partie sur les énoncés et interprétations proposés par les acteurs et analysés par les anthropologues
d’aujourd’hui.
Dans les rapports entre recherche fondamentale et science appliquée, de nombreux problèmes se posent,
notamment en ce qui concerne les temporalités différentes propres à la recherche et aux prises de décisions
gestionnaires ou politiques. Il s’ensuit que ce sont le plus souvent les études les plus superficielles – les moins
complexes – qui sont utilisées par les décideurs. Or, même en matière de développement aujourd’hui, un certain
nombre d’instances et d’organisations se rendent compte que les sciences humaines et sociales paraissent à tort

Unités de recherche
Vague D : campagne d’évaluation 2012-2013
Février 2012
2
comme les parents pauvres de la recherche scientifique. C’est surtout en période de crise : guerres civiles ou « de
religion », crimes de masse, famines, que l’on découvre ou redécouvre des recherches méticuleuses sur les
mouvements religieux, la circulation de l’argent, les institutions du sens, les faits sociaux de longue durée.
Aujourd’hui, l’ONU, ses différentes agences, le groupe des états d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et
bien d’autres instances soulignent la contribution essentielle de la culture à un développement durable. L’importance
de ces grands opérateurs internationaux et les relations entre instances globalisées et acteurs locaux s’offrent
d’ailleurs à leur tour aujourd’hui comme de nouveaux objets de recherche.
Pour ce faire, les réflexions communes qui ont été menées ont abouti à la rédaction d’un projet scientifique
structuré autour d’axes de recherche – et non d’équipes étanches, ces axes étant au nombre de six. La structuration
en axes plutôt qu’en équipes autonomes présente de nombreux avantages : la cohésion de l’unité de recherche
est préservée, entretenue par le cadre fixé par le conseil d’UMR, l’organisation d’événements collectifs est
renforcée par la multi-appartenance de plusieurs chercheurs à différents axes de recherche.
Axe 1 : Fabrique et circulation des savoirs
Cet axe de recherche se veut la synthèse des approches que les différents laboratoires qui envisagent de
fusionner consacraient déjà à l’épistémologie des études africaines ou orientales. Il s’agira ici d’explorer les pratiques
qui permettent, ou ont permis, l’élaboration d’un savoir sur l’Afrique, au sud et au nord du Sahara – et ce de la façon
la plus concrète possible puisqu’on s’intéressera aussi à la matérialité des documents mobilisés dans cette
élaboration.
Nous nous pencherons avant tout sur les pratiques d’écriture – et là nous ne pensons pas seulement à la
production des textes académiques, mais à toutes les écritures « ordinaires » qui se sont succédé en amont de ces
textes : notes, journaux, correspondance, etc. Nous nous interrogerons aussi sur ce qui, dans l’écriture scientifique,
porte la trace des souvenirs littéraires ou artistiques de ceux qui la produisent. De plus, aux côtés des travaux savants
et de leurs entours, nous considérerons des productions dites « littéraires ». On évoquera notamment l’incorporation
par certains écrivains (Nerval, Chateaubriand, Lamartine…) d’éléments estampillés comme « orientaux », et cet
intérêt pour l’« ethnographie » des écrivains a évidemment à voir avec un intérêt pour l’écriture savante. Plus
globalement, la question sera de savoir comment s’élaborent l’observation d’une société locale – présente ou passée –
et sa restitution sous forme de récit. Les textes vernaculaires publiés et traduits par les anthropologues ou les
historiens constituent un autre fait d’écriture sur lequel nous comptons nous pencher. Il s’agirait d’évaluer les choix
stylistiques auxquels ils ont procédé, ainsi que tout l’impensé, idéologique, esthétique, etc., qui a informé leurs
choix. Il faudra poursuivre également l’analyse généalogique et critique des savoirs académiques sur l’Afrique ; sur ce
point, on s’attachera d’une part à la période récente, postérieure aux années 1960, à partir notamment des archives
de chercheurs comme Raymond Mauny ou Yves Person ; d’autre part, à la période de l’Entre-deux-guerres, où une
ethnologie française largement africaniste commence à s’institutionnaliser.
Attentifs à l’écriture, nous le serons aussi parce que les sociétés que nous étudions produisent elles aussi de
l’écrit. Bien sûr, elles passent généralement pour des sociétés d’oralité, et nous comptons bien prendre en compte les
traditions orales dont elles sont porteuses, mais l’écriture est depuis trop longtemps présente en leur sein pour que
les écrits sur lesquels se penchent leurs lettrés n’interfèrent pas avec ces éléments d’oralité. L’influence, sans doute
ancienne, des poésies arabes archaïques sur les poésies orales du Sahel et du Sahara n’en offrant qu’un exemple
parmi d’autres ; et on sait aussi tout ce que, dans ces mêmes régions, les traditions d’origine des différents groupes
doivent au texte coranique ou à des écrits arabes médiévaux (Al Masoudi ou autres).
En tout cas, oraux ou écrits, les différents supports de mémoire seront évalués dans leurs réélaborations
successives, leurs différentes versions devant être considérées non comme les avatars d’une transmission imparfaite,
mais comme des objets à considérer pour eux-mêmes et à contextualiser pour percevoir les enjeux qui sous-tendent
ces remaniements. Pour ce qui concerne en particulier les sources historiques, il ne s’agira pas seulement d’informer
à partir d’elles une période ou un thème, mais plutôt de les déconstruire afin de mettre en évidence des méthodes
d’écriture et de réécriture et de faire apparaître à terme les groupes sociaux spécialisés dans la conservation et la
transmission de la mémoire, qu’elle soit écrite, orale ou iconographique (clercs/lettrés, artisans, musiciens,
photographes…). Cette démarche s’accompagnera d’une approche documentaire qui consistera à recueillir sur le
terrain des corpus de chants, poèmes et traditions orales, des textes, offrant une version non-officielle de l’histoire.
Concernant les manuscrits, l’intérêt se portera à la fois sur les textes et sur leur fabrication, leur circulation, leurs
lieux de conservation, ou encore la constitution de bibliothèques. Plusieurs projets ayant trait à ce thème de
recherche sont déjà en cours et appelés à se développer. Un premier projet porte sur les manuscrits éthiopiens, et
doit déboucher sur l’établissement d’une codicologie éthiopienne, notamment en analysant des processus tels que la
mise en compilation des textes historiographiques ainsi que les enrichissements des textes lors des échanges entre
transmission orale et mise par écrit. Un autre consiste à approfondir l’analyse et la comparaison des récits
historiographiques (« annales », « chroniques »…) produits par les sociétés africaines dès l’époque médiévale, des
« chroniques » de certaines villes Swahili au tarikh de Tombouctou. De la même manière, un programme d’édition
critique de textes écrits en arabe par des lettrés sénégalais ou maliens est en cours. De même encore, et pour une
Afrique plus australe, un projet déjà en cours sur les usages de l’écriture par les chefferies Ndembu en Angola (XVIIe-
XXe siècles) sera poursuivi, et ce projet implique lui aussi un travail d’édition de textes vernaculaires, en l’occurrence
des archives liées à l’exercice du pouvoir. Dans tout cela, on sera attentif à la matérialité des supports du savoir,
telle qu’elle se présente localement et telle qu’elle se présente à l’arrivée : codex, manuscrits, archives ; portails de
mise en ligne, etc. Notre attention aux faits d’écriture nous portera, en effet, à considérer les effets de l’utilisation
de nouveaux outils (internet, etc.) sur la fabrication, la diffusion et le stockage de nos productions scientifiques, avec
tout ce que cela implique sur leur forme et leur contenu.

Unités de recherche
Vague D : campagne d’évaluation 2012-2013
Février 2012
3
En un mot, on sera attentif à la genèse de tous ces textes, à leurs variations, à leur être matériel, ainsi qu’aux
valeurs que leur assignent leurs producteurs et leurs consommateurs. Étant entendu qu’il s’agira aussi bien de textes
produits ici que de ceux qui sont produits là-bas, où nos travaux prennent leur source. Et ce d’autant plus qu’il n’est
pas question, pour les productions locales, de se limiter à celles que nous aurions tendance à caractériser comme
« traditionnelles ». Ainsi, on s’intéressera aux écrivains et artistes maghrébins ou africains qui, dès le début du XXe
siècle, ont voulu s’inscrire dans des mouvements de pensée assez vastes pour leur permettre de sortir de l’échelle
locale ou du tête-à-tête avec la puissance coloniale, et dont les productions s’inscrivent aujourd’hui dans le marché
international de l’édition. On se posera en particulier la question de savoir quelles pratiques scripturaires et
artistiques innovantes ont été mises en œuvre dans ce cadre.
Les domaines de savoir ainsi explorés ne relèvent d’ailleurs pas seulement de l’histoire et de l’anthropologie,
car on compte s’intéresser de la même manière au sort du savoir archéologique. En particulier, on s’interrogera sur
les articulations contemporaines entre l'archéologie et l'histoire dans les pays maghrébins. Comment les strates
anciennes et récentes, faites d’un passé antéislamique et colonial, ont-elles été réinvesties par les représentants des
nouvelles archéologies nationales et indigènes ? Qu’est-il fait aujourd’hui, dans des pays majoritairement arabo-
musulmans, des traces matérielles laissées par des civilisations antiques célébrées notamment par Carcopino ou
Renan ? Qu’est-ce que cette question peut nous apprendre sur le rapport des sociétés postcoloniales à leur passé
colonial, ou à des périodes antérieures à l’islam ? On pense en particulier aux documents antiques qui étaient
précisément ceux que le colonisateur mettait en exergue, ou aux traditions populaires qui faisaient le fond de
commerce de l’orientalisme. D’une manière générale, on aura à se demander comment les intéressés se
réapproprient – qu’ils le déconstruisent ou le prennent à leur compte – le savoir que la colonisation a élaboré à leur
sujet. On peut se demander, par exemple, comment les Kabyles, les Dogons ou les Touaregs reprennent le savoir
archéologique, ethnographique ou linguistique qui les concernent, comment ils l’utilisent dans la réécriture de leur
histoire, et comment ils veulent, dans ce cadre, peser sur l’évolution des sciences humaines, aussi bien au plan
international que dans leurs pays respectifs.
Dès lors que nous parlons d’archéologie, il importe de considérer le rôle que les pays concernés lui font jouer
dans une optique de valorisation touristique ou patrimoniale (songeons, par exemple, au rôle que le régime de Ben
Ali a fait jouer aux vestiges de Carthage). Mais bien d’autres savoirs dits « locaux » sont mobilisés dans ce genre
d’entreprise, où une instrumentalisation politique de la culture est mise en œuvre par des initiatives locales. On peut
évoquer par exemple, la mise au patrimoine mondial de l’Unesco de certains rituels peuls de transhumance au Mali,
avec tous les effets sociaux que cela entraîne dans les communautés concernées ; ou bien les concours de poésie
auxquels donnent lieu des festivals sahariens destinés pour une bonne part à une consommation touristique ; ou bien
encore les reformulations contemporaines de l’histoire du Mandé au Mali, mises en parole lors de nouveaux rituels où
entrent en compétition des griots censés conserver la mémoire ancestrale. S’agissant de la circulation des savoirs, il
faudra aussi considérer ce qui y fait obstacle ou rend ces savoirs relativement opaques, l’ésotérisme et le secret, par
exemple, rarement pris en compte par les organisations internationales qui postulent un idéal universel de libre accès
aux savoirs quels qu’ils soient.
Il ne s’agira pas seulement de parler des hommes et des savoirs qui ont circulé entre ici et là-bas, mais de
s’intéresser à une série de figures dont l’existence même atteste la porosité de toutes les frontières qu’on pourrait
vouloir tracer entre ici et là-bas. C’est d’abord le cas de ceux qui, par contrainte ou par choix, ont franchi cette
supposée frontière en transportant avec eux un bagage de savoir qu’ils ont cherché à acclimater dans leur nouveau
séjour. La figure paradigmatique en est sans doute Léon l’Africain, mais on pense aussi à tous ceux, drogmans, élèves
de l’École des jeunes de langues, ou chrétiens d’Orient employés comme interprètes, qui ont contribué à
l’élaboration d’un savoir occidental sur l’Afrique et l’Orient. Il y a aussi le cas de ceux qui ont voulu être sur la
frontière, ou qui se sont donné pour tâche de l’abolir. On reviendra ainsi sur ceux qui, notamment autour de l’équipe
des Cahiers du Sud et de Gabriel Audisio, entreprirent de célébrer ce qu’ils appelaient le génie de l'« homme
méditerranéen ». Et il y a aussi ces « collaborateurs indigènes » souvent anonymes mais auxquels la recherche
commence à s’intéresser, et dont les contributions intéressent des domaines aussi divers que la cartographie, l’étude
du droit musulman, la philologie ou l’ethnographie.
Axe 2 : Mondialisations africaines dans la longue durée et globalisation
Cet axe doit fédérer des chercheurs et des enseignants chercheurs de différentes disciplines, sensibles à la
question des rapports du continent avec le reste du monde dans la longue durée. Les phénomènes d’intégration
réciproque de l’Afrique à d’autres espaces ne sont pas nouveaux, même si la colonisation a indéniablement constitué
une accélération de la « globalisation ». L’originalité des recherches de cet axe consiste à réexaminer le concept de
mondialisation dans la longue durée, à la fois pour nuancer la valence actuelle du terme et pour comprendre de
quelle(s) mondialisation(s) l’Afrique a été partie prenante à diverses époques. C’est à travers quatre thèmes,
complémentaires et transdisciplinaires, qu’on pourra mieux saisir les relations complexes entre le local et le global.
La réflexion sur la validité et les limites des travaux novateurs de la World history se poursuivront avec l’étude des
globalisations de l’océan Indien, espace central, avant — mais également après — le XVIe siècle et dans lesquelles
l’Afrique est partie prenante.
Ainsi, l’histoire des plantes et de l’alimentation s’inscrit dans la très longue durée, de l'utilisation des
premières poteries (à la charnière des Xe-IXe millénaires av. J.-C.) jusqu’à la période contemporaine. En plus des
sources « classiques » de l’histoire, écrites et orales, ces recherches font appel à l’archéologie, à l’anthropologie, à
l’agronomie et, pour les périodes historiques, à la linguistique (noms de plantes, de formations végétales, de produits

Unités de recherche
Vague D : campagne d’évaluation 2012-2013
Février 2012
4
ou de mets). Elles concernent le Sahara, l’Afrique de l’Ouest sahélo-soudanienne, la zone forestière du golfe de
Guinée, l’Ethiopie et Madagascar. Le premier volet s’intéresse aux plantes de cueillette et aux plantes cultivées,
domestiquées en Afrique ou ailleurs, ainsi qu’à leurs divers usages, alimentaires, artisanaux, médicinaux et religieux.
Parmi les espèces cultivées, il peut s’agir de plantes locales, comme le fonio et le tef, de plantes qui ont voyagé hors
d’Afrique, comme le mil et le riz « africain », ou de celles qui y ont été introduites depuis d’autres continents. Ces
circulations de matériel végétal sont liées à des migrations de population, à des échanges commerciaux (les
différentes traites notamment) ainsi qu’à la mise en place des empires coloniaux. Elles impliquent des
transformations dans les savoir-faire agricoles (création de variétés locales, techniques culturales) et culinaires
(préparation et cuisson des produits, intégration dans un répertoire de recettes). Si l’adoption de plantes nouvelles
répond parfois à des pénuries, elle s’accompagne généralement de recompositions culturelles, religieuses et
identitaires. Plantes et paysages végétaux peuvent constituer des sources de l’histoire rurale en l’absence, le plus
souvent, d’informations émanant directement des sociétés paysannes. Aujourd’hui, plantes et paysages sont au cœur
des processus de patrimonialisation de la nature et des politiques d’espaces protégés. L’histoire de l’alimentation
s’appuie sur l’étude des plantes mais aussi d’autres ressources, comme le sel, le miel, les produits de la pêche, de la
chasse et de l’élevage. Et concerne d’autres objets de recherche tels que les manières de table, les différentes
cuisines, les consistances et les goûts. Ces questions, qui témoignent souvent d’échanges et de métissages, prennent
tout leur sens une fois resituées dans leur contexte socio-économique, politique et culturel. On s’intéressera ainsi à la
distinction entre nourritures quotidiennes, festives ou rituelles, aux rapports entre hiérarchies culinaires et
stratifications sociales, au clivage entre milieux ruraux et urbains… Sans oublier les crises alimentaires, qui ont
longtemps marqué certaines régions par leur récurrence et qui (ré)apparaissent aujourd’hui avec des composantes
nouvelles.
L’esclavage, les différentes traites et les formes de dépendance font l’objet de nouvelles approches
historiques et anthropologiques. Après une période où les études sur l’esclavage concernaient surtout la traite
atlantique, on assiste aujourd’hui, en Afrique de l’Ouest et au Maghreb, à un double déplacement. A l’intérêt pour la
domination économique de l’esclavage s’est substitué celui pour sa dimension morale (honte, absence de maîtrise de
soi) et religieuse (exclusion de l’islam). Le second déplacement concerne de nouveaux terrains de recherche :
esclavage interne aux sociétés lignagères (Côte d’Ivoire), aux sociétés côtières qui fournissaient les vivres de la traite
atlantique (Rivières du Sud), et à celui de l’espace transsaharien, du Maghreb au Sahel. Ainsi dans la région
Mauritanie/Sénégal/Mali, la stigmatisation « islamique », qui frappe les esclaves mais aussi les nomades (Touaregs...)
et les « castés », entraîne une surenchère dans la piété sous forme de l’affiliation à des ordres soufis inclusifs ou,
récemment, aux Salafistes (Mauritanie). Loin de former un ensemble homogène, les « esclaves » sont divisés en
multiples sous ensembles, dominés par des esclaves guerriers — armées noires du Maroc, Mamelouks dans les États
musulmans peuls —, et des Royal Slaves. Ce feuilletage identitaire, condition de la perpétuation de l’esclavage-
catégorie explique que les sociétés sahéliennes contemporaines sont autant post-esclavagistes que post-coloniales.
L’histoire de l’esclavage en Afrique centro-occidentale (région Congo-Angola) est d’habitude centrée sur la traite
atlantique, laissant dans l’ombre les formes d’esclavage et de dépendance internes aux sociétés africaines. Comment,
derrière le macro-récit de la traite, est-il possible d’identifier les mots pour dire l’esclavage ou la dépendance, ainsi
que les pratiques sociales et juridiques auxquelles ils renvoient ? Les réponses aux enquêtes ethnographiques sur « les
formes analogues de l’esclavage » (enquêtes commandées par la Société des Nations en 1936) permettent de
reconstituer les lexiques qui, dans les différentes langues africaines d’Angola, servaient à distinguer les subtiles
gradations entre esclavage et dépendance, ainsi que le mode de fonctionnement des institutions qui leur étaient
associées. En dépit des biais que comporte ce genre d’enquête, son étude critique permettra de révéler un univers
linguistique et social extrêmement riche et complexe. Dans un deuxième temps, ces éléments seront confrontés aux
sources plus anciennes (XVIIe-XIXe siècle) des archives de Lisbonne et de Luanda. L’objectif final est d’évaluer
comment les deux régimes de captivité, l’africain et l’atlantique, ont été reliés ou séparés. Cette recherche s’intègre
dans un projet international, financé par la Fundação para a Ciência e Tecnologia de Lisbonne. Les partenaires
portugais développent la même méthodologie pour le Mozambique. Dans l’avenir, ce projet pourra s’élargir à d’autres
espaces et à d’autres chercheurs. Dans ce domaine, l’Afrique orientale est longtemps restée dans l’ombre des débats
historiographiques, centrés sur l’Afrique de l’Ouest et l’espace atlantique. Elle inclut la région des Grands Lacs, la
Corne de l’Afrique, la côte orientale et Madagascar, ainsi que des prolongements en direction de l’océan Indien, de la
mer Rouge et des Mascareignes. Outre la réévaluation des réseaux de traite, il s’agit d’éclairer la diversité — et la
complexité —, des formes de la dépendance et leur articulation tant avec les dynamiques externes qu’internes. Aussi
ces problématiques seront-elles systématiquement étudiées en rapport avec les évolutions sociales, politiques et
démographiques des zones concernées. Le marronnage, les résistances ainsi que les formes de dépendance et de
travail contraint, postérieures à l’abolition, seront également abordés. Deux régions feront l’objet de travaux
approfondis : l’Ouganda et le littoral swahili. Un volet est notamment consacré à l’étude des traites française et
omanaise entre 1750 et 1810. A ce sujet, deux points forts sont à souligner : une collaboration en cours avec le Centre
for Research on Slavery and Indenture (University of Mauritius) de l’Île Maurice, ainsi que l’élaboration de la première
base de données exhaustive des voyages de traite française sur la côte swahili.
Les études sur l’histoire et la mémoire de l’empire portugais concernent essentiellement le patrimoine
matériel et immatériel des civilisations cosmopolites africaines et indiennes, ainsi que sa résonnance toujours actuelle
dans les pratiques et les imaginaires. Une approche se focalisera sur les dynamiques transcontinentales de la mémoire
et de la transmission des cultures entre les océans Indien et Atlantique, dans les lieux d’implantation de l’empire
portugais aux XVIIIe et XIXe siècles. Elle portera sur la valorisation patrimoniale de la mémoire historique des
migrations, à des fins d’application pratique —muséales, scientifiques et économiques — dans les espaces africains et
indiens, et à partir d’études comparatives sur le patrimoine bâti, en particulier privé. Ces analyses concerneront les
espaces coloniaux (Goa, Benguela, Rio, Bahia) y compris les espaces insulaires (Sao Tomé, Ilha de Moçambique, Diu,
Madeira) qui présentent un métissage d’influences. L’autre approche est relative aux traces encore vivantes de

Unités de recherche
Vague D : campagne d’évaluation 2012-2013
Février 2012
5
l’Afrique orientale portugaise sur la côte occidentale de l’Inde, en particulier au Gujarat. La mémoire patrimoniale —
perceptible dans la langue, l’alimentation, les pratiques religieuses, les chants et les danses, l’architecture et
l’aménagement des espaces intérieurs dans les familles issues d’anciens commerçants indiens d’Afrique orientale (à
Diu et à Mandvi) —, se mélange aux mémoires familiales et aux imaginaires encore à l’œuvre nourrissant les nouvelles
migrations du Gujarat vers l’Afrique.
Les recherches sur les migrations et les diasporas s’organisent en quatre sous-ensembles. Le premier situe
les diasporas indiennes et chinoises dans l’empire portugais et dans son héritage (africain, asiatique et atlantique).
S’y inscrivent les projets de recherche concernant les diasporas indiennes et la construction des frontières dans la
ville de Lourenço Marquês (Mozambique) entre 1930 et 1975, ainsi que la question des diasporas non africaines
(Indiens musulmans, hindous, parsis, goanais, Chinois) du Mozambique re-diasporisées en 1975 dans l’espace
lusophone (Portugal, Brésil, Angola, Mozambique). A cela s’ajouteront de nouvelles recherches sur les migrations
récentes, depuis les années 1990, des Indo-pakistanais et des Chinois au Mozambique dans le contexte de la nouvelle
mondialisation.
Le second sous-ensemble concerne les relations entre les mobilités humaines et la santé : la migration comme
condition d’accès aux soins, les pathologies liées à la migration, le tourisme médical, le traitement social de la santé
des étrangers dans différents contextes. Ces recherches sont attentives à étudier en Afrique et hors d’Afrique les
circulations non seulement de personnes, mais d’objets et de ressources (médicaments, alicaments, gamètes, etc.),
de savoirs et de pratiques à travers la constitution de réseaux personnels et d’informations (forums, médias,
Internet), de réseaux d’entrepreneurs (banque de ressources, cliniques) ou encore d’associations.
Le troisième sous-ensemble porte sur une forme de migration, plutôt de déplacement forcé, qui tend à devenir
durable et qui recouvre la condition de « réfugiés » en Afrique (toutes catégories confondues). Si la situation des
réfugiés perdure, les interventions de « l’humanitaire » — jusque là exceptionnelles et liées à l’urgence —, se muent
en « aides » qui imposent à ces populations des politiques de « développement ». Des recherches transversales sont
conduites en coopération et en partenariat avec des collègues africains qui s’inscrivent dans une telle perspective.
Le quatrième sous-ensemble s’intéresse aux migrations africaines en Afrique et hors d’Afrique. Liées aux
contraintes économiques, ces migrations s’ouvrent sur des thématiques nouvelles telles que les recherches sur les
imaginaires urbains d’immigrants vus comme « clandestins », et sur les spécificités des mouvements migratoires Sud-
Sud par rapport aux flux Sud-Nord, davantage étudiés. Des études porteront sur le voyage des migrants d’Afrique
centrale vers l’Afrique du Sud (moyens mis en œuvre, rencontres inédites, durée des itinéraires), où la route à pied
devient un objet d’analyse en soi. Travailler sur les communautés transnationales, en associant ethnographie multi-
sites et analyse des réseaux, permet aussi de mesurer les flux migratoires et/ou les transferts d’argent. Actuellement
dans le plus ancien bassin d’émigration vers l’Afrique centrale et vers l’Occident, à la frontière du
Sénégal/Mali/Mauritanie, le montant de ces transferts dépasse largement celui de l’aide internationale. L’analyse des
réseaux sociaux (ARS) offre un instrumentaire conceptuel et analytique plus adéquat que les méthodes des
démographes et des économistes, focalisées sur des groupes prédéterminés (ménages, familles). Avec des logiciels
(libres) comme Pajek, Puck..., anthropologues et historiens disposent d’outils informatiques maniables pour étudier
les réseaux migratoires et de parenté, en partant des zones de départ.
Axe 3 : Pouvoirs, espaces, mémoires (frontières, mobilisation et dissidence, violence, conflits)
La question de la formation des Etats, de leur recherche du monopole de la violence légitime, de leur
légitimation est au cœur des investigations historiques, anthropologiques et politistes des chercheurs des trois unités.
Tout en continuant à travailler les questions des frontières et de l'héritage colonial dans la formation des Etats, il
s'agira également de scruter ce qui se joue dans les rapports quotidiens de domination et de subversion sans lesquels
les structures institutionnelles ne se matérialisent pas. Ces rapports de pouvoir seront appréhendés aussi bien dans
leurs dimensions violentes que pacifiées.
La violence et le conflit sont parties intégrantes de la vie des sociétés qu’ils contribuent à faire évoluer et le
conflit, qu’il s’exprime de façon violente ou non, est une dimension constitutive des rapports sociaux. Les formes de
conflits, les types de violence ou les styles de guerre qui affectent l’Afrique sont d’une infinie diversité : des
génocides contemporains au supplice du collier infligé aux accusés de sorcellerie, de la violence politique à la
violence ordinaire des rapports sociaux, de la guerre rituelle saisonnière des sociétés anciennes au terrorisme
international et à l’insécurité régnant dans les zones pétrolières et minières sans oublier la violence
environnementale consécutive aux désastres naturels, à la dégradation de la terre, de ses ressources et de la
biodiversité. Les institutions d’Etat, qui disposent du monopole légitime de la violence, mais aussi les institutions
internationales trouvent leurs raisons d’être dans les conflits qu’elles tentent d’éviter ou de réguler. La violence, sous
ses formes renouvelées, est l’objet d’interrogations récurrentes au cœur de l’étude anthropologique, politique ou
historique des sociétés et des problèmes sociaux liés à des processus économiques comme le libéralisme mondialisé ou
les processus de marginalisation. Ainsi, la guerre, en tant que forme collective de conflit majeur et source de violence
invite à s’arrêter sur l’évolution de ses formes et de ses pratiques tant dans le temps long de l’histoire que dans la
synchronie de l’actualité. La compréhension de la violence et de la dynamique des conflits, quelles que soient leur
intensité, leur échelle, leur dimension ou leur forme constituent sans doute l’une des clefs de la compréhension de
l’Afrique contemporaine, de ses institutions comme de ses transformations. Objets transversaux, la violence et le
conflit impliquent une approche pluridisciplinaire et/ou interdisciplinaire à laquelle collaborent toutes les disciplines
représentées dans la future unité.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%
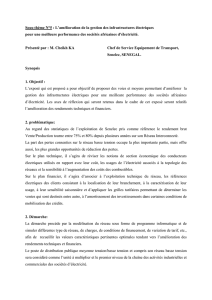



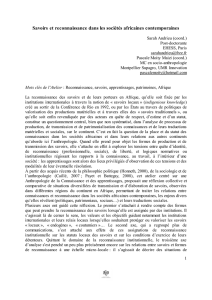



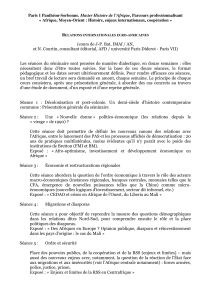
![Où est Dieu dans le terrain ? [DOC - 42 Ko ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005150914_1-9a4f161a9df654c67d74e91720fc519e-300x300.png)