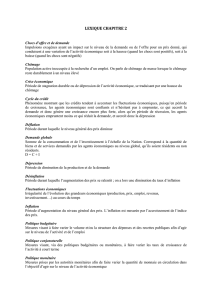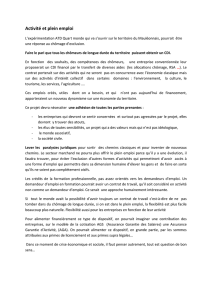1991-1993 : dès les années 1980, les pays développés mène une

MOREL Quentin
ECE1
Paul BAIROCH
Victoires et déboires
Tome III
Quatrième partie : le XX ème siècle chez les nantis : guerres, crises, prospérité,
schismes et intégrations
XXIV. La Première Guerre mondiale : la fin d’un monde et un entre-deux-guerres troublé
XXV. La Seconde Guerre mondiale et cinq décennies de croissance rapide
La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) et la reconstruction en Occident
1950-1973 : une phase de croissance sans précédent historique
Depuis 1973, une nouvelle phase économique en Occident ?
La désindustrialisation de l’Occident
XXVI. Le monde développé occidental : divisions, rivalités et intégrations de 1973 à nos jours
XXVII. L’Europe de l’Est : de la révolution bolchevique au retour du capitalisme
XXVIII. Les bouleversements des sociétés développées : de la démographie à la fin des Etats-nations ?
XXIX. Vie sociale : de la mise en place au début du démantèlement de l’Etat-providence
XXX. Les techniques au XX ème siècle : continuité et bouleversements
Cinquième partie : le XX ème siècle dans le Tiers-Monde

Chapitre XXV : La Seconde Guerre mondiale et cinq
décennies de croissance rapide
I. 1950-1973 : une phase de croissance sans précédent historique
1945-1973 : presque 30 années de croissance très rapide (« trente glorieuses » selon Jean Fourastié).
Cependant, l’analyse de Bairoch se concentre sur la période commençant en 1950 car la phase 1945-
1950 représente les années de reconstruction, ce qui n’est pas une « phase économique normale ».
1) Un rythme de croissance économique d’une ampleur sans précédent historique
Taux de croissance annuels des pays développés :
- 1750-1830 : +0,3%
- 1830-1913 : +1,3%
- 1920-1939 : +2%
- 1950-1973 : +3,9% (PNB/hab multiplié par 2,4 en 23 ans)
La période 1945-1973 correspond « à plus d’un siècle de croissance d’avant 1945 » (p126).
Cette croissance permet une amélioration économique et sociale pour la population de ces pays :
égalisation de la distribution des revenus et amélioration des législations sociales.
Avènement de la société de consommation : une vaste gamme de produits de plus en plus accessible
aux couches populaires de la population.
Un croissance rapide mais pas uniforme : de 1950 à 1973, le PNB/hab d’Europe occidentale progresse
de 3,8%, celui des E-U de 2,1%, celui du Japon de 7,7% (mais niveau faible au départ) => égalisation
des niveaux de vie.
2) Et aussi une expansion des échanges économiques internationaux
Trente glorieuses : le volume des échanges s’accroît 1,7 fois plus vite que le volume de production
mais 1,2 fois en valeurs => faible progression du taux d’exportation de l’économie (7,8% du PIB en
1950 à 10,2% en 1969-1971 sachant qu’il était de 13% en 1913) => les prix d’exportation ont
augmenté plus lentement que les prix intérieurs, ce qui s’explique par la différence de rythme de
croissance de la productivité entre les secteurs d’exportation et l’ensemble de l’économie, mais aussi
par un phénomène de dumping généralisé.
3) La troisième révolution agricole
« Très forte accélération de la progression de la productivité de ce secteur » (p129).
1950-1990 : taux annuel de progression de la productivité agricole = 4,8% (productivité x 5)
Facteurs :
- usage massif de pesticides, d’engrais (consommation x10) et sélection intensive des semences
et des animaux
- utilisation massive de machines agricoles et concentration des exploitations.
Les rythmes de progression de la productivité agricole dépassent ceux de l’industrie (+3,4% par
an de 1950 à 1980) dès la fin des années 1940 aux E-U et début des années 1950 en Europe.

4) Une période aux fluctuations économiques très atténuées
1946 : crise aux E-U => le volume du PNB recule de + de 10% alors qu’il représente presque la moitié
de celui de l’ensemble des pays développés occidentaux.
Récessions (et non crises économiques) : 1954 et 1958 (« très sensible ralentissement de la
croissance » p132).
1954 : le PNB/hab baisse de 2% aux E-U
1958 : E-U, Belgique, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Royaume-Uni (PNB/hab baisse
au maximum de 2%).
Les périodes de ralentissement et les récessions se situent souvent à des dates différentes selon les
pays (ex : 1958 est une bonne année pour l’Australie et l’Italie).
Facteurs de l’atténuation des fluctuations économiques :
- L’impact de l’agriculture sur l’économie et réduit par la faible importance de ce secteur (23%
de la pop active en 1950, 10% en 1970).
- Amélioration des connaissances des mécanismes économiques (ex :Keynes)
- Stabilité monétaire (ex : Bretton Woods)
- Planification souple dans certains pays d’Europe occidentale
- 3 changements structurels de l’économie : progression de l’importance relative du secteur
tertiaire (44% de l’emploi en 1960), accroissement de l’importance des revenus de transfert
(retraites…), production stable de l’agriculture (meilleure maîtrise des aléas du climat).
5) Les conséquences écologiques d’une croissance économique très rapide
1972 : Limits to Growth (rapport Meadows) => mise en évidence des aspects négatifs de cette
croissance rapide, notamment pour l’écosystème.
La consommation d’énergie dépasse largement celle des autres matières premières non-renouvelables.
Réserves de pétrole :
1970 : 70-80 milliards de tonnes (35-40 années de consommation)
1994 : 115-125 milliards de tonnes (les pays développées occidentaux n’en ont que 5%)
=> les craintes de pénurie sont peu fondées mais le problème se situe au niveau des effets négatifs
de la consommation de combustibles fossiles, d’autant qu’elle s’accroît de plus en plus
(ex :accroissement de la production en Chine).
- Pollution de l’atmosphère : concentration de gaz carbonique et destruction de la couche d’ozone,
cette dernière causant une augmentation de la quantité de rayons ultraviolets sur le terre (cancers de la
peau…).
1950 : la part dans l’atmosphère du CO2 provenant des combustibles fossiles dépasse celle du CO2
provenant du bois => effet de serre (réchauffement climatique).
- Pollution marine : détruit « une partie importante de la vie dans 70% de la superficie du globe
terrestre » (p142). Elle résulte des rejets industriels, agricoles, urbains et militaires (« retombées
radioactives des années 1950 » p142).
- Pollution des sols (pesticides et rejets des métaux lourds) : cultures contaminées par des produits
toxiques qui peuvent aussi contaminer les eaux souterraines et donc les plantes, les animaux et les
hommes.
Augmentation de la fréquence des accidents industriels :
1800-1914 : inférieurs à 5
1914-1946 : une dizaine
1946-1995 : une quarantaine (ex : Tchernobyl)
Mais l’énergie nucléaire a permis d’éviter de nombreux accidents dans les mines…

6) Une convergence des niveaux et des conditions de vie
Depuis les années 1930, l’Europe rattrape partiellement le niveau de vie de l’Amérique du Nord,
surtout après la Seconde Guerre mondiale (le PNB/hab des E-U dépasse celui de l’Europe occidentale
de 110% en 1929, dans les années 1990, l’écart n’est plus que de 40%).
Europe occidentale : depuis les années 1950, croissance plus rapide dans les pays moins développés
=> réduction des écarts de niveau réel de vie (PIB par tête : écart de 370% entre les pays pauvres et
les pays riches en 1950, réduction à 78% en 1995).
Harmonisation de la consommation, notamment pour les biens d’équipement (ex : automobile : les
Américains possèdent 7,1 fois plus de voitures que les Français en 1950, 1,4 fois plus en 1990).
7) Nationalisation des entreprises
« De tout temps, en Occident comme ailleurs, l’Etat a été propriétaire d’une plus ou moins grande
fraction des activités économiques » (p149) ex : manufactures royales dans la France du XVIIIème s.
L’histoire moderne des nationalisations peut remonter à certains réseaux de chemins de fer du
XIXème siècle (ex : Belgique 1836) => 1913 : l’Etat contrôle en partie ou en totalité les réseaux dans
tous les pays développés (sauf l’Espagne, les E-U et le R-U) car le chemin de fer doit privilégier
l’intérêt du public.
Prise de pouvoir des bolcheviques en Russie => nationalisation de pratiquement toute l’économie.
Entre-deux-guerres : nationalisations peu importantes en Allemagne (nazie), en Italie (fasciste), en
Suède (socialiste) et en France (Front Populaire).
Après le guerre : nationalisations dans les pays de l’Est (communisme) et à l’Ouest par De Gaulle,
notamment des usines Renault, des secteurs bancaire et aéronautique => milieu des années 1980 : le
secteur nationalisé français est les plus important d’Occident (24% de l’emploi industriel).
Mais mouvement de privatisation dès les années 1980.
II. Depuis 1973, une nouvelle phase économique en Occident ?
Début des années 1970 au milieu de la décennie 1990 :
- ralentissement de la croissance, accentuation de l’inflation et montée du chômage
- intensification du commerce et des investissements internationaux (mondialisation)
1973 : l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) multiplie par 4 les prix du pétrole
=> choc pétrolier
1980-81 : les prix sont encore multiplié par 3
=> récession dans les pays occidentaux (1974-75 : le PNB total recule de 0,5%, 1982 : de 0,3%)
=> hausse du chômage qui n’est pas stoppée par la reprise de la croissance
Dès 1966-68, l’inflation entraîne un dérèglement du système monétaire international (fin de la fixité
des taux de change instaurée par les accords de Bretton Woods).
« Avec l’écroulement des pays de l’Est, et l’acceptation du principe de l’économie de marché par
la Chine à partir de la fin des années 1980, l’économie occidentale est devenue encore plus
l’économie mondiale » (p154).

1) La montée des prix (à partir de 1968-69) et le désordre monétaire (à partir de 1971)
1967-1971 : hausse des prix de 4,8% entraînant d’une augmentation des taux d’intérêt concomitante
d’un ralentissement de la production (stagflation).
Le premier choc pétrolier (1973) amène une forte accélération de l’inflation (+13,2% en 1974)
réalimentée par le choc de 1980-81 (+9,1% entre 1972 et 1983).
Allemagne : hyperinflation dans les années 1920 mais très faible inflation pendant le dernier demi-
siècle, France et Italie : inflation relativement élevée => différences qui entraînent des écarts
importants dans la valeur des monnaies.
Inflation des années 1970 => hausse des taux d’intérêt (sommet en 1980 avec +13%).
Années 1960 : affaiblissement du dollar dû a la trop forte quantité de monnaie américaine en
circulation dans le monde => désordre monétaire et suspension de la convertibilité dollar-or en 1971.
=> début de l’ère des taux de change flottants (fixés librement par le marché) qui entraîne une forte
fluctuation et une montée des prix de l’or (mais le dollar reste monnaie de référence).
Choc pétrolier + ralentissement de la croissance + augmentation des dépenses de l’Etat pour les
programmes sociaux = forte augmentation des déficits budgétaires dès 1975 (pays développés
occidentaux : 1,5% du PIB en 1972-74, 4,6% en 1975, 3% en 1994-95).
=> emprunts élevés des gouvernements => constitution d’une dette publique croissante (7 pays les
plus industrialisés : dette = 15% du PIB en 1970, 33% en 1986, 45% en 1995) qui est le plus souvent
intérieure. Le paiement des intérêts absorbe de 5 (France, Allemagne…) à 15% (Belgique,
Italie…) des recettes budgétaires.
2) 1973-1995, un ralentissement de la croissance économique ?
Et une conjoncture plus cyclique
1971-1973 à 1991-1993 : recul de 46% du rythme annuel de croissance par rapport à la période
1957-59 à 1971-1973 (mais 1970-73 = sommet conjoncturel, et 1991-93 = creux conjoncturel). De
plus, les chocs pétroliers ont entraîné une perte du PNB de 10% et, de toute façon la croissance de
cette période est toujours de 20% supérieure à celle de la Belle Epoque.
Chômage + instabilité de la conjoncture + inflation = nouvelle phase économique.
Montée du chômage à l’Est depuis la fin du régime communiste sous lequel l’Etat garantissait
l’emploi…
3) Un ralentissement des rythmes de croissance de la productivité industrielle
Contrairement au niveau de l’ensemble de l’économie, les rythmes de croissance économique et ceux
de la productivité ne sont pas uniformes au niveau sectoriel.
Productivité du travail dans l’industrie manufacturière des pays développés occidentaux :
- 1950-1973 : rythme annuel de croissance d’environ 4%
- 1973-1983 : se réduit de moitié (2,1%) => ralentissement plus accusé que celui de la
croissance économique
- 1983-1991 : 3,7%
Plan géographique : différences dans les rythmes de croissance de la productivité et dans l’ampleur du
ralentissement.
Début de années 1990 : amélioration du rythme de progression de la productivité (ex :
E-U :+3,2%) dans l’ensemble, mais faible pour la France, l’Allemagne et le Japon (+2,2%).
 6
6
 7
7
1
/
7
100%