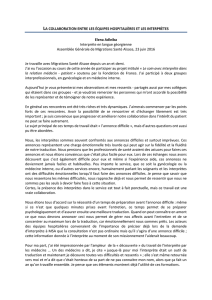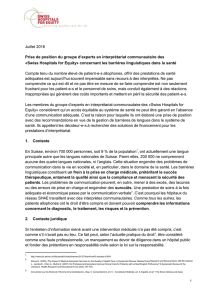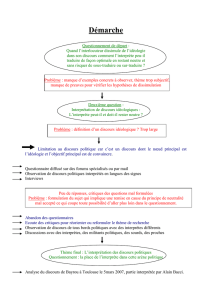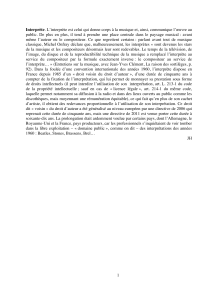interpretes mediateurs culturels

QUELLE EST LA PERCEPTION
DES “INTERPRETES MEDIATEURS CULTURELS”
DE LEUR ROLE ET COMPETENCES ?
Aline GOHARD – RADENKOVIC,
avec la collaboration de
Mirela BERA. VUISTINER et de Drita VESHI
La définition du rôle de «l’interprète médiateur culturel» est l’objet de débats actuels
tant au niveau fédéral qu’au niveau de la toute nouvelle Association suisse des
interprètes médiateurs culturels fondée sur le modèle de l’European Association of
Babelea
1
, dans un pays qui se trouve au coeur du dispositif européen d’accueil des
réfugiés de guerre ces quinze dernières années. Ces populations en exil proviennent
principalement du Rwanda, du Burundi, de la Somalie, de l’Angola, du Sri-Lanka, de la
Turquie (kurde), de la Bosnie, et plus récemment du Kosovo
2
. L’émergence de cette
nouvelle catégorie d’acteurs professionnels est indissociable d’une conjoncture
politique internationale avec l’afflux de réfugiés de guerre et de ses immigrés
économiques d’une part et d’une mission politique à visées humanitaires que s’est
donnée la Confédération helvétique, d’autre part. Les interprètes médiateurs culturels,
dont la dénomination varie d’un canton à un autre, d’un organisme à un autre et d’un
pays à un autre
3
, sont fréquemment sollicités par les services sociaux, la police des
étrangers, les services hospitaliers ainsi que par les milieux éducatifs et médico-
pédagogiques. Paradoxalement ces interprètes n’ont pas encore acquis de légitimité
professionnelle ni de pleine reconnaissance statutaire, alors qu’ils ont joué et jouent un
rôle majeur dans l’intégration sociale et culturelle des immigrés. Yvan Leanza et
Philippe Klein (2000) déplorent l’absence d’une définition concertée du rôle de
l’interprète avec les professionnels - ici du domaine médical - : “Un aspect qui nous
1
C’est à l’occasion de la 1ère Conférence sur « l’Interprétariat social communautaire », qui a eu lieu à
Vienne (Autriche) en novembre 1999, qu’a été officialisée la création de cette association européenne
dénommée « Babelea ». Cf. Actes du Congrès dans les références bibliographiques.
2
Toutes les données concernant les flux migratoires en Suisse et les informations relatives aux les
politiques d’asile et d’immigration en vigueur et mises en œuvre par l’Office fédéral des réfugiés à
Berne, sont regroupées, analysées et commentées dans le Journal d’information du Forum suisse pour
l’études des migrations en deux langues: Info FSM / SFM Info.
3
Dans le seul volume, cité plus haut, des Actes de la 1ère Conférence de Babelea, (Vienne, nov. 1999),
nous avons déjà repéré les dénominations suivantes : « interprète communautaire » (calqué sur le terme
anglo-saxon « Community Interpretor »), « médiateur linguistique professionnel », « interprète en milieu
social », « interprète en milieu professionnel », « interprète social »… pour ne citer que celles-là. Nous
retenons pour notre article la dénomination la plus fréquemment utilisée en Suisse francophone.

paraît incontournable dans une formation à la relation interculturelle est
l’apprentissage du travail avec un interprète. Or, l’introduction de la présence d’un
tiers ne va jamais de soi. Dans un récent rapport sur l’utilisation d’interprètes dans le
réseau médical suisse, Weiss et Stuker (1998) relèvent l’utilisation trop rare de ces
professionnels et leur statut souvent déprécié au sein des institutions”.
Si les différents organismes suisses font spontanément appel aux services de ces
personnes, c’est en raison de leur double appartenance linguistique et culturelle. En
effet, ayant vécu elles-mêmes l’exil et installées depuis un certain temps en Suisse, elles
sont supposées non seulement maîtriser la langue française mais aussi bien connaître la
société d’accueil. Par ailleurs, étant issues du même pays, partageant la même langue
que les réfugiés, elles sont supposées comprendre leurs compatriotes et leur culture de
référence. Y. Leanza et P. Klein (art. cit., 2000) soulignent ce dépassement du simple
rôle de traducteur entre culture du client et culture du professionnel: “Le deuxième
aspect concernant l’utilisation d’un interprète s’articule autour de la fonction que l’on
désire qu’il joue. Habituellement, l’interprète est appelé à traduire de manière plus
large que le mot à mot (Métraux & Alvir, 1995). Ainsi, en plus du sens des mots, il
s’agit également de traduire ou transmettre le vécu, la part émotionnelle, certains
préconisent une fonction encore plus importante pour l’interprète. Ainsi, Nathan (1986;
1994) et Métraux et Alvir (1995) insistent sur le fait que celui-ci est également un
médiateur culturel, c’est-à-dire qu’il apporte des éclairages sur les représentations
culturelles inconnues du professionnel”. Mais rien ne prouve que ces interprètes perçus
comme “médiateurs culturels” maîtrisent le décodage de ces «représentations
culturelles» et soient psychologiquement préparés aux situations de médiation et de
négociation, souvent difficiles et parfois conflictuelles, auxquelles ils peuvent être
confrontés dans leurs activités d’interprétariat dans des milieux institutionnels très
différents et des situations interculturelles diversifiées.
Deux d’entre nous ont eu une expérience directe d’interprétariat auprès de leurs
(ex)compatriotes tandis que la troisième a été intervenante dans une formation
organisée par la Croix-Rouge genevoise: la diversité de ces expériences et de ces
échanges ont amené les trois auteurs à s’interroger sur les parcours de ces «interprètes
médiateurs culturels» et sur le rôle qu’ils sont amenés à jouer comme «intermédiaire»
entre deux systèmes de référence, le plus souvent dans un contexte d’urgence ou de
crise. Jusqu’à maintenant les «spécialistes de l’interculturalité» (universitaires et

professionnels
4
) ont tenté de définir les attributions et les compétences nécessaires à
l’interprète médiateur culturel: un certain nombre de formations ont été confiées, ces
dernières années, par l’Office fédéral des réfugiés à Berne à des organismes privés (ex.
Appartenances) et à des associations caritatives (ex. Caritas, la Croix-Rouge, Mondial
contacts, etc.). L’objectif de notre enquête est de comprendre, à travers des témoignages
de vie, en quoi et comment l’expérience d’exil et d’intégration de nos interlocuteurs a
contribué à l’élaboration de leur propre conception et propres stratégies de médiation
interculturelle dans les situations d’interprétariat.
I. Choix de la méthodologie d’analyse
1. Une approche socio-ethnologique et raisons de ce choix
Au départ nous avions l’intention de mener des interviews avec des questions semi-
ouvertes mais ce type d’entretiens guidés nous a paru très vite réducteur. C’est la
complexité même de la problématique qui nous a dicté une autre démarche: à savoir
privilégier l’écoute de récits de vie en recueillant le témoignage des interprètes eux-
mêmes. Pourquoi une approche socio-ethnologique du récit de vie? Nous nous
appuyons sur la définition de Daniel Bertaux (1997): “Dans l’enquête socio-
ethnologique, les données remplissent de tout autres fonctions {que l’enquête
quantitative}. (…); elles donnent à voir comment “fonctionne” un monde social ou une
situation sociale. Cette fonction descriptive est essentielle et conduit vers ce que
l’ethnologue Clifford Geertz
5
appelle thick description, une description en profondeur
de l’objet social qui prend en compte ses configurations internes de rapports sociaux,
ses rapports de pouvoir, ses tensions, ses processus de reproduction permanente, ses
dynamiques de transformation”. Or les récits de migration et d’exil sont par excellence
porteurs de ces processus de tensions entre deux contextes socioculturels différents, de
cette dynamique entre des appartenances passées et présentes vécues sur le mode de la
rupture, du deuil, du changement et de la reconstruction. D. Bertaux (op. cit.) emploie la
métaphore suivante: “Les récits de vie raconte l’histoire d’une vie, il est structuré
autour d’une succession temporelle d’évènements et de situations qui en résultent: cette
suite constitue en quelque sorte la colonne vertébrale”. Et cette ligne de vie, ajoute-t-il,
4
On voudrait ici signaler l’excellent ouvrage intitulé: Interprétariat et médiation culturelle dans le
système des soins, (Rapport de base), de Regula Weiss et Rachel Stuker (1998 ; cf. références
bibliographiques) qui est la première étude sérieuse et poussée menée sur le rôle et les compétences des
interprètes médiateurs culturels dans les domaines médical et hospitalier.
5
Tiré de son ouvrage intitulé : Savoir local, savoir global (1986). Cf. Références bibliographiques

n’est pas une ligne droite, harmonieuse, mais une trajectoire ballottée au gré de forces
collectives qui réorientent le parcours de façon imprévue et généralement incontrôlable
(ex. guerre, révolution, coup d’Etat, crise économique grave, épidémie, déclin d’une
région, etc.). La plupart des lignes de vie sont donc “brisées” (Bertaux, 1986). Ce
phénomène de reconstruction a posteriori d’une cohérence est désigné par le terme de
“lissage de la trajectoire biographique” (Bertaux, op. cit.) ou encore d’“illusion
biographique” (Bourdieu, 1986).
Les modes de restitution des moments ou étapes clés - ou que le narrateur juge clés - de
sa vie et de son exil sont pour nous des indices importants. Mais récit de vie et réalité ne
coïncident pas forcément: il s’agit de la restitution d’une trajectoire, de plus racontée
dans la langue du pays d’accueil. Or, toute restitution est une réinterprétation du passé
par rapport au présent et comporte également ses oublis, ses omissions, ses non-dits, ses
propres interdits que D. Bertaux désigne par “zones blanches” (1997). Tout ce “non dit”
et ce “dit” mais aussi ce “trop dit” (par des retours incessants aux mêmes événements et
aux mêmes termes) ont leur raison objective dans la narration qui, ne l’oublions pas, se
déroule dans une relation dialogique (interviewer – interviewé). La densité de ce capital
d’expérience biographique (Bertaux, op. cit.) et l’intensité de la souffrance exprimée
dans ces récits d’exil étaient telles qu’il nous a fallu les écouter à plusieurs reprises pour
prendre une distance et être en mesure de mener à bien notre analyse.
2- Méthode d’interview : principes et corpus
Un contrat oral (sorte de pacte) a été passé avec chacun de nos interlocuteurs en
expliquant en amont les grandes lignes de notre démarche en vue de précentrer
l’entretien qui va jouer, il est vrai, un rôle de filtre dans le récit. Nous avons privilégié
l’écoute du narrateur, si possible, sans l’interrompre. Nous nous sommes permis
quelques interventions ponctuelles mais minimales dans le cas où notre interlocuteur
aurait oublié l’une des lignes directrices de notre contrat de départ (ou processus de
recentrage). Nous n’avons pas imposé de limite de temps au récit, enregistré sur
cassette-audio avec l’accord préalable de notre interlocuteur, et accompagné d’une prise
de notes simultanée. Enfin nous nous sommes donné la possibilité de rencontrer à
nouveau la personne, si nécessaire. Les entretiens enregistrés ont duré entre une heure et
deux heures en moyenne. Ils ont été complétés par des échanges informels hors micro.
Les orientations de l’entretien biographique proposées à nos interviewés étaient les
suivantes:

- racontez votre vie avant votre départ de votre pays, les raisons de votre exil et votre
exil même;
- racontez les étapes de votre installation, de votre intégration en Suisse; comment
êtes-vous devenu interprète médiateur culturel et pourquoi?;
- quelle est votre perception du rôle et des compétences d’un interprète médiateur
culturel à partir de vos expériences dans cette fonction ?
Nous avons contacté par téléphone une dizaine de personnes
6
mais la moitié seulement
a répondu favorablement à notre demande. Nous avons recueilli les témoignages de cinq
femmes, soit : une Croate de Bosnie (C1); une Péruvienne (P2); une Burundaise (B3);
une Albanaise du Kosovo (K4); une Somalienne (S5). Notre critère de base était simple:
les personnes que nous souhaitions interviewer devaient être de provenances différentes.
Mais la composition finale de notre corpus dépendait de leur décision. On peut déjà
remarquer une forte présence de représentants du sexe féminin et l’absence totale du
sexe masculin
7
ce qui correspond à la réalité de la fonction en Suisse: soit une majorité
écrasante de femmes. Dans ce sens, notre corpus est représentatif. Nos interlocutrices
partagent un autre point commun: toutes ont eu une expérience diversifiée et fréquente
de l’interprétariat. Elles se sont toutes exprimées en français sauf l’une d’entre elles
(K4) qui a terminé l’entretien dans sa langue maternelle tant l’émotion était forte. On
peut expliquer cette difficulté à maîtriser l’expression en langue étrangère (que pourtant
elle a enseignée) du fait de la proximité de ce vécu dans le temps, soit environ cinq ans,
tandis que nos quatre autres interlocutrices sont en Suisse depuis dix à quinze ans.
II. Analyse et interprétation des récits-témoignages
Plutôt que d’avoir des hypothèses préconstruites, que nous souhaiterions vérifier par
l’analyse comparée des témoignages, nous avons construit nos interprétations au fur et à
mesure de l’écoute de ces voix qui nous guident dans notre analyse: l’objectif de notre
étude sera donc de repérer les récurrences à travers les récits, car aussi différentes que
soient ces histoires individuelles, nous partons du postulat qu’elles n’en partagent pas
moins un même lieu de rencontre: celui de l’interprétation et de la médiation à travers le
prisme de l’exil.
6
Ce sont Mirela Bera-Vuistiner et Drita Veshi, qui, de par leur fonction d’interprète médiatrice culturelle,
avaient les coordonnées de ces personnes pour avoir suivi ou encadré des séminaires de formation avec
lesquelles elles sont alors entrées en contact. Nous ne connaissions de nos narratrices ni leur itinéraire, ni
leur situation présente avant l’entretien biographique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%