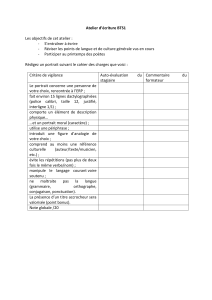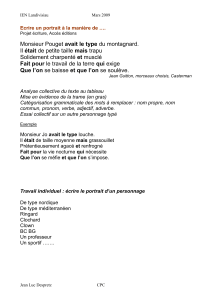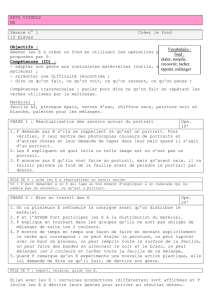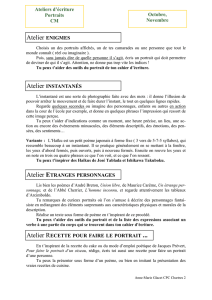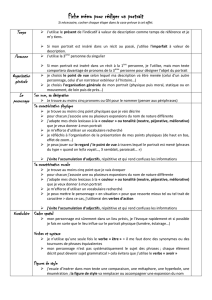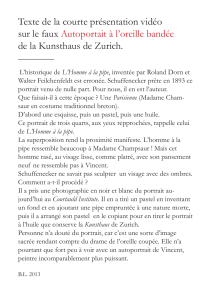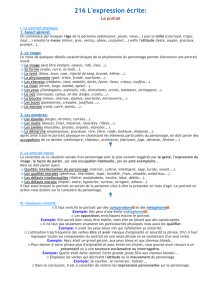Fidélité et trahison - E

1
Fidélité et trahison
L’art du portrait et de l’autoportrait maniéristes à
Florence
Une inspiration commune pour Constance Fenimore Woolson et
Henry James
Jeannine Hayat
A Catherine Cousin
L’émergence de l’individu à l’époque de la Renaissance a favorisé l’expansion d’un genre
pictural novateur: le portrait. Portraits de cour, portraits intimes ou autoportraits, les œuvres
profanes qui prennent pour modèle la figure humaine provoquent désormais chez le spectateur
une émotion esthétique aussi intense que la peinture religieuse ou historique. Le
développement rapide, tout au long du XVIe siècle, de l’art du portrait est européen. Mais
l’histoire de la peinture italienne offre de nombreux exemples d’œuvres inoubliables. De
Piero della Francesca à Raphaël et au Titien, les portraitistes de la péninsule ont démontré
qu’ils atteignaient à la perfection de leur art. Un voyage à Florence est l’occasion de découvrir
et d’apprécier ces chefs-d’œuvre. Car si l’art du portrait n’est pas né à Florence, l’atmosphère
artistique de la ville a néanmoins contribué à faire évoluer le genre, notamment dans la
deuxième phase de la Renaissance, cette période de crise, nommée après coup le maniérisme,
très influencée par l’anti-classicisme de Michel-Ange1.
La dynastie des Médicis a œuvré pour embellir Florence, et en faire le modèle des villes d’art.
Afin d’établir leur pouvoir culturel sur la ville, les grands-ducs successifs ou leurs parents se
sont montrés excellents bâtisseurs, et grands collectionneurs. Grâce à des commandes
officielles, ils ont su favoriser l’épanouissement de l’art du portrait. Le cardinal Leopoldo de
Médicis (1617-1675) fut l’un des mécènes les plus célèbres de la Toscane. Parmi ses
collections, celles de portraits et d’autoportraits sont très renommées. C’est même lui qui a
rassemblé la première grande collection d’autoportraits connue. Elle comprenait à sa mort
quatre-vingts autoportraits accrochés au troisième étage du Palais Pitti, le siège de la cour du
grand-duc Cosme 1er.
Les richesses artistiques de Florence expliquent que la ville soit l’une des destinations les plus
prisées d’Italie. Ainsi, au XIXe siècle, les auteurs américains ont-ils coutume de voyager en
Italie pour y découvrir des œuvres inconnues du Nouveau Monde. Définitivement sous le
charme de l’Italie, certains d’entre eux sont même devenus des spécialistes de l’histoire de
l’art italien. Constance Fenimore Woolson compte parmi les écrivains américains qui ont été
inspirés par la peinture de la Renaissance. Certes, cette passion pour l’histoire italienne ne l’a

2
pas gagnée par hasard. Son premier séjour à Florence au printemps 1880, long de quelques
semaines, lui a permis de rencontrer Henry James. Il lui a fait découvrir la ville, ses couvents,
ses églises, ses palais et ses musées. Et parmi les tableaux qu’ils ont pu admirer ensemble, au
musée des Offices, se trouvaient ceux d’Agnolo dit Bronzino, un artiste florentin du XVe
siècle, peintre de la première génération des maniéristes. Ensuite, chacun à sa manière, les
deux écrivains ont intégré à leurs fictions l’esthétique maniériste que Bronzino leur avait
enseignée. Woolson s’est montrée la plus rapide pour écrire un premier texte, largement
autobiographique, situé dans un milieu artistique florentin.
I.
La nouvelle Expérience à Florence, publiée en octobre 1880, est une évocation du récent
passage de Woolson à Florence. Dans cette fiction, les personnages américains Margaret
Stowe et Trafford Morgan, doubles de Woolson et de James, mènent deux expériences
parallèles successives. La première expérience doit permettre à Margaret d’oublier une
histoire d’amour ratée, en se laissant séduire par Morgan. C’est un échec. La seconde
expérience, également ratée, consiste à l’inverse, pour Morgan, à s’attacher à Margaret afin
d’oublier Béatrice, une amie de Margaret. Le prénom, Béatrice, choisi par Woolson pour l’un
de ses personnages contribue à inscrire le texte dans l’histoire de l’art italien. Il s’agit, par
antiphrase, d’une évocation discrète de la femme idéale dont Dante chante les louanges dans
les poèmes de Vita Nuova.
Margaret et Morgan souffrent d’avoir été trahis par celui et celle qu’ils aimaient naguère. Ils
ne croient plus en la fidélité. Une constante demeure pourtant dans la relation des
personnages : Morgan remplit auprès de Margaret le rôle de guide de Florence. Un jour,
pendant la phase expérimentale où Morgan s’applique à aimer Margaret, ils se rendent à la
basilique San Lorenzo. Les deux héros visitent la Nouvelle Sacristie, appelée également
chapelle des Médicis, commandée par le pape Léon X à Michel-Ange, et qui jouxte la
chapelle des Princes. Margaret et Morgan admirent les statues de marbre sur les tombeaux de
Julien de Médicis, duc de Nemours, mort en 1516, et sur celui de Laurent de Médicis, duc
d’Urbino, mort en 1519. Julien, le condotierre, est représenté assis, vêtu de sa cuirasse, le cou
et la face tournés, le torse présenté de trois-quarts. A ses pieds les statues à demi-étendues du
Jour et de la Nuit. Les statues de l’Aurore et du Crépuscule sont installées en vis-à-vis, sur le
tombeau de Laurent, également assis, mais la tête posée sur la main, dans la posture du
penseur. Margaret prend souvent l’avis de Morgan sur les œuvres. Quand elle lui demande
comment interpréter ces statues, Trafford Morgan répond :
« Elles évoquent le destin, notre triste destin humain. La magnifique Aurore éprouve de la
peine à s’éveiller, Le Jour manifeste une détermination ferme. L’échec se révèle au
Crépuscule et l’ennui d’un repos sans espoir apparaît avec La Nuit. C’est une manière de
représenter l’existence. »
Les statues de la chapelle des Médicis illustrent le style maniériste de Michel-Ange,
notamment dans le mouvement et les torsions qui les animent. Comme des doublures vivantes
de Julien et de Laurent de Médicis, Margaret et Morgan se sont assis dans la Nouvelle
Sacristie, pour mieux en admirer les beautés anti-classiques. A l’inverse des statues
funéraires, les deux héros du récit sont vivants. Ils se sentent néanmoins incapables de jouir de
leur existence, tourmentés par des sentiments contradictoires, inaptes à choisir leur destin. La
mélancolie les menace. Cependant, comme pour conjurer le sort, c’est le moment que choisit
Margaret pour évoquer sa rivale dans le cœur de Morgan. Espère-t-elle que le caractère sacré
de l’endroit incitera Morgan à lui donner la préférence sur Béatrice? C’est possible.
Malheureusement, la discussion tourne à la scène de dépit amoureux. Quoique trahi, Morgan

3
ne renie rien de sa récente passion pour Béatrice. Or, une chapelle funéraire ne semble pas, a
priori selon les normes de Margaret, l’endroit le plus approprié pour une querelle amoureuse,
même si d’après Morgan « les plus hauts sommets de l’art, ou de l’existence sont dédiés à
l’amour ». Morgan a assurément raison d’invoquer la relation étroite entre Eros et Thanatos.
Roméo et Juliette dans le tombeau des Capulet ont rappelé qu’érotisme et macabre ne sont pas
éloignés l’un de l’autre. Mais Margaret n’est pas prête à ce type de transgression, et ne
pouvant donner libre cours à sa déception dans la basilique, son malaise s’accroît. L’angoisse
des deux héros est, à la vérité, aisément explicable. Ce que Margaret et Morgan ressentent
dans cette chapelle, c’est une préfiguration de leur destin brisé. Faute de parvenir à oublier
leur chagrin d’amour respectif, ils ne connaîtront pas le bonheur ensemble. Les deux
personnages, dépités, ne s’attardent donc pas dans la Nouvelle Sacristie. Irritée, Margaret se
lève la première, et espérant sortir rapidement de la chapelle, elle pénètre dans la crypte. La
basilique San Lorenzo a été construite sur une hauteur. Ainsi s’explique que la crypte ne soit
pas entièrement souterraine. Elle avait, à l’époque de Woolson, une entrée sur la place
Madonna degli Aldobrandini.
L’aménagement de la crypte, que découvrent Margaret et Morgan en 1880 est assez récent,
ancien d’une vingtaine d’années seulement2. Et au moment de sa visite à San Lorenzo,
Woolson n’avait sans doute pas une connaissance très précise des lieux. Ainsi, la lecture de sa
correspondance indique-t-elle que la romancière se trompait sur la crypte. Car justement
l’emploi de ce mot, crypte, désignant habituellement un lieu entièrement souterrain, l’avait
induite en erreur. Dans une lettre sans date, elle s’adressait ainsi à Madame Crowell :
« Nous (elle-même et Henry James) avons traversé la crypte pour atteindre la sacristie et
presque tout le sol était recouvert de pierres tombales. Juste les noms et les dates. La vraie
crypte est en dessous. A cet endroit, une cinquantaine de corps gisent, pas sous des pierres
tombales, mais entassés les uns au-dessus des autres »3.
En réalité, il n’existe pas d’autre crypte que cette pièce octogonale, située sous la chapelle des
Princes. Et si la chapelle accueille des sarcophages vides, c’est dans la crypte que sont
conservées les dépouilles de trente-six membres importants de la famille Médicis, notamment
celles des grands-ducs. Il est vrai qu’antérieurement à 1857, les cadavres des Médicis avaient
été entassés sans ordre dans un souterrain. Cela n’a rien d’étonnant. Jusqu’au milieu du
XVIIIe siècle, en effet, en Italie comme en France, il était courant d’accumuler les morts dans
les églises4. Mais, en 1880, lorsque Woolson et James ont visité San Lorenzo, les dépouilles
se trouvaient bien sous les stèles, grâce au grand-duc Léopold II de Lorraine qui avait pris la
décision de remédier au désordre des cercueils. C’est sans doute un peu plus tard, au moment
d’écrire Expérience à Florence, que Woolson a étudié de près les résultats de l’exhumation de
1857. Dans son récit, elle a rectifié l’erreur commise dans sa correspondance. Ainsi
s’explique que dans le texte original de sa nouvelle Expérience à Florence, elle ait évité
d’employer le mot crypte qui, étant donné la configuration des lieux, ne devait pas lui paraître
pertinent. Elle désigne l’endroit par la périphrase suivante : « a cool law hall, paved with the
gravestones of the Medici (une salle basse et fraîche, pavée des tombes des Médicis) ». Puis,
un peu plus loin dans le texte, le personnage féminin ne se trompe pas sur l’endroit où se
trouvent les restes des Médicis5. Dès qu’elle a fait le tour de la crypte, Margaret, d’humeur
querelleuse, interpelle Morgan en ces termes:
« Ne pensez-vous pas à eux, étendus sous les dalles : Jean dans son armure et Eléonore de
Tolède parée de sa chevelure blonde? »
Pourquoi a-t-elle choisi ces deux tombeaux-là? C’est là une nouvelle énigme. Ce qui frappe
lorsqu’on observe un plan de la crypte, c’est l'éloignement des stèles associées dans sa
question par Margaret, celle de Giovanni delle Bande Nere ( Jean des Bandes Noires, 1498-
1526), le seul Jean en armes de la crypte, et celle d’Eleonora di Toledo (1522-1562)6. Les
tombes de Jean des Bandes Noires, le dernier des condotierri et de son épouse, Maria Salviati

4
(1499-1543), le couple fondateur de la branche cadette des Médicis, sont disposées presqu’au
centre de la crypte. Et un peu à l’écart, dans l’une des quatre niches situées de côté, sont
ensevelis Cosme 1er, son épouse Eléonore de Tolède et deux de leurs fils, Jean et Garçia.
Associer Jean à Eléonore, comme le fait Margaret, n’est donc guère justifié. Comment
expliquer cette anomalie dans les paroles d’une jeune femme agacée? Cette question est
d’autant plus délicate qu’en l’absence de précisions, d’après le contexte, le lecteur est fondé à
comprendre que Jean est l’époux d’Eléonore. Ce qui induit le lecteur en erreur.
Jean et Eléonore sont, parmi les dépouilles exhumées, les seules à avoir conservé dans le
tombeau des attributs essentiels de leur vivant : son armure pour l’homme et sa chevelure
blonde pour la femme. En effet, lorsque les restes de Jean, et ceux d’Eléonore ont été étudiés,
les chercheurs ont été très surpris. L’armure de Jean était en bon état. Et la robe d’Eléonore
gisait dans son cercueil, presqu’intacte. Autour du crâne de la duchesse, un cordon d’or
continuait même à retenir une touffe de cheveux très blonds. L’armure et les cheveux
retrouvés évoquent la personnalité publique de deux personnages exceptionnels dans l’histoire
de Florence : la bravoure de Jean, la beauté d’Eléonore. Mais cela ne justifie pas que Margaret
s’autorise à marier dans la mort le condotierre Jean à la duchesse Eléonore. Ce qui permet à la
jeune Américaine de rapprocher les défunts, malgré l’éloignement de leurs tombeaux, ce n’est
pas non plus leur lien de famille, assez distant. Jean des Bandes Noires est certes le beau-père
d’Eléonore, mais comme il est mort de septicémie à vingt-huit ans, ils n’ont pu se connaître.
Le rapprochement opéré par Margaret repose donc nécessairement sur un autre point commun
que la parenté. En fait, Margaret, agacée par Morgan, souhaiterait convoquer dans la crypte le
fantôme de Béatrice, son amie blonde, pour mieux éradiquer son souvenir. Dans le tombeau
d’Eléonore de Tolède, Margaret voudrait voir reposer sa rivale morte.
Ne pas quitter la basilique sans avoir supplanté Béatrice dans le cœur de Morgan, c’est le
projet de Margaret. Dans l’intention de réussir un habile tour de passe-passe, Margaret a donc
avisé les tombes de Jean et d’Eléonore, parce que le nom des défunts évoquait assurément, à
la fin du XIXe siècle, dans l’esprit d’une femme cultivée, passionnée par l’histoire de
Florence, le titre d’un tableau célèbre de Bronzino : Le portrait d’Eléonore de Tolède avec
son fils Jean, daté de 1545. La référence s’impose d’autant plus que les portraits des Médicis
par Bronzino, à la perfection glacée, sont l’anticipation des tombeaux installés dans la crypte.
Les événements qui se sont déroulés sur terre au temps glorieux des grands-ducs ont laissé
une trace sous terre. Profitant de ce parallélisme entre les vivants et les morts, Margaret
voudrait atteindre un double objectif : séparer symboliquement Eléonore de son époux,
Cosme 1er, puis associer Eléonore à un autre homme, nommé Jean. Le prénom n’a pas été pas
choisi au hasard car un Jean repose également auprès d’Eléonore, mais ce n’est ni son beau-
père, ni son amant, c’est son fils7. Le procédé employé, inconsciemment peut-être, par
Margaret consiste donc à brouiller des repères familiaux pourtant nettement établis par la
disposition des tombes dans la crypte. Cheminant dans cet espace à demi enterré, Morgan
devrait se perdre dans les ramifications de la dynastie Médicis, au point d’en oublier qui est
qui. Puis, désemparé, il devrait se retourner vers Margaret, enfin conscient que la femme la
plus aimable se trouve auprès de lui. Du point de vue esthétique, l’association d’idées était
tout à fait justifiée. En effet, Bronzino, grand admirateur de Michel-Ange, connaissait bien la
chapelle des Médicis. Pour plusieurs de ses portraits masculins, il s’est inspiré de la statue de
Julien de Médicis8. Et c’est en tant que peintre officiel que Bronzino a peint le portrait, à
portée dynastique, de l’épouse de Cosme 1er et de leur fils, Jean.
Assise sur un siège recouvert de velours rouge, Eléonore entoure de son bras l’épaule du
garçonnet, âgé de deux ans, appuyé contre elle, debout à sa droite, et elle laisse reposer sa
main gauche sur sa robe9. Le buste féminin de face et le visage de trois quarts se détachent sur
un fond bleu outre-mer. La perfection idéalisée du visage d’Eléonore, très peu expressif,
produit un effet de masque, qui ne laisse rien transparaître des émotions de la duchesse. La

5
singularité de ce portrait de cour réside dans la robe de brocart du modèle, somptueuse, aux
motifs en arabesques compliqués, mais de couleur sombre. L’impression de mélancolie qui se
dégage du tableau tient beaucoup à cette robe, et à l’effet de fascination que provoquent ses
motifs en trompe-l’œil, semblables à de la tapisserie. Parée d’un double collier de perles orné
d’un pendentif, de boucles d’oreilles assorties, d’une ceinture d’or sertie de joyaux, et d’un
riche ornement de coiffure, l’épouse de Cosme 1er, à la beauté hiératique, observe le
spectateur, les paupières lourdes, légèrement baissées. Les portraits de Bronzino ont cette
particularité que les objets du décor ou les accessoires appréciés du modèle sont plus
expressifs de l’intériorité du modèle que ses traits10. L’illusion du vrai que parvient à
produire Bronzino grâce à sa minutie dans le rendu des matières ouvre l’accès à l’intimité
d’Eléonore. D’ailleurs, dans le but d’aider le peintre, Eléonore avait fait tenir à Bronzino des
échantillons du tissu de sa robe11. La précision obsessionnelle avec laquelle les détails de la
robe imitent la réalité témoigne d’une tension dans la psychologie du personnage. Le
vêtement, qui occupe une large part de la partie inférieure du tableau, confère une tonalité
sombre à la scène. Noirs, gris et vieil or, les atours d’Eléonore pourraient sembler funèbres,
tant ils inspirent la tristesse12. Paradoxalement, à bien l’observer, le portrait semble être plus
annonciateur de malédictions à venir que de grandeur ducale. C’était bien prévoir car comme
nous le savons, le destin de l’épouse de Cosme 1er a été des plus tragiques. Moins de vingt ans
après avoir été portraiturée, elle est morte, quelques jours après ses fils, Jean et Garçia. On
raconte qu’à la suite d’une querelle, lors d’une partie de chasse, les deux frères se seraient
battus. Don Garçia aurait alors été blessé à mort. De colère, son père Cosme 1er aurait tué son
autre fils Jean. Et Eléonore serait morte de chagrin dix jours plus tard. Pourtant, l’analyse de
ses ossements indique qu’elle est plus probablement décédée de la malaria13.
Margaret, oppressée par l’atmosphère confinée de la chapelle des Médicis a superposé à
l’image froide des tombeaux celle du tableau de Bronzino, à l’esthétique glacée, mais moins
expressément morbide. Pour fuir une expérience attristante, elle a projeté ses fantasmes de
maternité sur Morgan. Il y aurait bien une manière pour elle de se prémunir contre la
déception et la trahison, ce serait de devenir mère. La mise en scène de la crypte, destinée à
célébrer la dynastie des Médicis, impressionne la jeune femme au point qu’elle songe à sa
propre filiation et à celle de Morgan. Que Margaret ait eu à l’esprit ce tableau de Bronzino est
explicable. La jeune femme avait auparavant arpenté tous les musées de Florence sous la
conduite magistrale de Morgan. Le portrait d’Eléonore ne pouvait lui avoir échappé.
D’ailleurs, d’une certaine façon Margaret a pu se reconnaître dans son portrait. Soucieuse
d’élégance, la jeune femme est elle-même confondue à un tableau dans Expérience à
Florence. Après une maladie de langueur due à un chagrin d’amour, Margaret réapparaît un
jour dans une robe de velours noir qui met en valeur sa beauté. Une amie en visite, Madame
Ferri lui déclare : « Vous ressemblez à un tableau ». Depuis Les essais de Montaigne, les
lecteurs savent à quel point les écrivains sont redevables aux peintres de leur avoir inspiré la
technique du portrait et de l’autoportrait. Dans les quelque huit portraits de femmes attribués à
Bronzino pourtant, aucun ne rappelle exactement Margaret en robe noire, portant une fleur
dans sa chevelure, une autre à la boutonnière de son corsage et un bouquet à la ceinture.
Néanmoins, la couleur sombre de la robe, l’ornement fleuri dans les cheveux et à la taille
peuvent parfaitement passer pour une reprise des attributs d’Eléonore portraiturée. Le portrait
de Margaret dans la nouvelle Expérience à Florence ressemble, en fait, à un autoportrait de
Woolson, à la belle manière14. L’autoportrait de Margaret-Woolson pourrait donc être une
sorte de copie actualisée du portrait d’Eléonore par Bronzino. Bronzino lui-même n’est pas
cité dans Expérience à Florence. En revanche, les références à la peinture italienne y sont
multiples. A la fin de la nouvelle, un hommage est même rendu à Giotto, l’un des pères de la
Renaissance italienne. Les deux héros finissent, en effet, par s’avouer leur amour réciproque à
l’intérieur du Duomo. Dans un élan de joie, Morgan exprime son bonheur et sa gratitude
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%