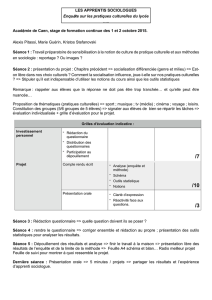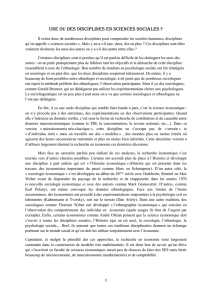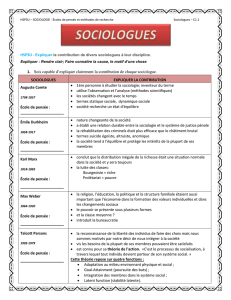BIBLIOGRAPHIE - Centre de Recherche en Gestion

29
29
LE TRAVAIL ET SA SOCIOLOGIE A L’ÉPREUVE DU LANGAGE
Anni Borzeix
1
Penser le langage, lui faire place dans et pour l'analyse du travail, ne va pas de soi en
sociologie du travail. Le projet est vaguement suspect : il présupposerait une vision du
social réduite au dialogue, à l'interaction, au relationnel, à un agir trop
"communicationnel", à des situations trop minuscules ; il ferait basculer nos manières de
raisonner et de travailler vers du descriptif aux dépens de l'explicatif, du "micro" aux
dépens du macro-structurel, de la forme aux dépens du fond ; le langage nous attirerait du
côté du symbolique et de l’immatériel aux dépens des forces matérielles, du consensuel au
dépens du conflictuel, de la coopération et du sujet individuel au détriment du collectif...
On risquerait d'y perdre nos objets, dilués ou miniaturisés, nos interrogations fondatrices,
notre regard critique, notre âme et notre histoire. D’être menacés de nanisme, de
réductionnisme, de formalisme. Le langage inquiète aussi pour d’autres raisons : son
exotisme, son mystère, la masse des savoirs accumulés à son propos, l’érudition souvent
inaccessible au non initié et auquel ce domaine de connaissance renvoie. Son aura -
l'impérialisme de la discipline dont il est l'objet et la renommée de ses “grands” auteurs -
impressionne. Il est souvent matière à confusion. Entre le langage, une pratique sociale
parmi d’autres, dont il sera surtout question ici et la langue, objet propre de la linguistique.
Confusion entre disciplines aussi qui se distinguent pourtant par leur visée théorique, par
leurs paradigmes et leurs méthodes mais qui ont en commun d’étudier des énoncés, des
“ matériaux langagiers ”. Du point de vue, par exemple, de leur signification (pour la
sémantique), de leurs structures et règles de fonctionnement internes (cas de la
linguistique), de leur rôle dans la communication (en sciences de la communication), de
leurs usages en société et en situation (pour la socio-linguistique) ou encore de leur rapport
à l’action (objet de la pragmatique).
Ce chapitre a l’ambition non pas de proposer une théorie du langage en sociologie du
travail mais d’essayer de dire pourquoi le langage aurait pu nous intéresser depuis
longtemps et pourquoi il nous concerne de plus en plus aujourd’hui. D’envisager aussi
comment nous pouvons, au profit de notre propre domaine disciplinaire, en faire bon
usage et en tirer partie. A cette perspective utilitariste s'en ajoutera une autre plus réflexive
: on se demandera quelles sont les incidences que cette prise en compte du langage peut
avoir sur nos objets, nos concepts, nos problématiques, nos méthodes d'analyse. Toute
1
CNRS, Centre de Recherche en Gestion de l'Ecole Polytechnique

30
30
importation, tout emprunt, tout commerce entre disciplines est, on le sait, source de
déplacements, de reprises, de remises en question.
Quels sont donc les effets de connaissance dont le langage est porteur? On procédera en deux
temps. En distinguant (1) des effets de connaissance “pour nous”, pour nos propres
pratiques professionnelles, nos matériaux, nos manières de comprendre le travail et d'en
faire la sociologie, (2) des effets de connaissance “sur le monde”, du moins celui qui nous
concerne ici plus directement : le monde du travail (Kergoat, Boutet, Jacot, Linhart, 1998),
des systèmes productifs et de l'emploi. On examinera d'abord les déplacements de regard
que cette perspective suppose ou entraîne. On passera en revue, ensuite, une série de faits
et d'arguments à l'appui d'une l'hypothèse : celle d'une place croissante qui reviendrait au
langage dans les transformations économiques contemporaines.
1 - Le langage comme action : entre paradigme et ressource descriptive
Les travaux engagés au sein du réseau Langage et Travail partaient, il y a dix ans, d'un
constat commun : l'existence d'une sorte de vide, d'angle mort de la connaissance
qu'aucune de nos disciplines respectives n'érigeait en objet de recherche à part entière, à
savoir la dimension langagière des activités de travail. On peut désigner cet objet
empirique de plusieurs façons selon la référence disciplinaire privilégiée. Les variations
sont le symptôme de la pluridisciplinarité qui marque nos travaux. Les ergonomes parlent
de verbalisation, les sociologues d’interaction verbale, les socio-linguistes de pratiques
langagières, les pragmaticiens d’acte de langage, sans oublier le terme le plus fréquent de tous
peut-être, le plus englobant, le plus polyvalent aussi, celui de communication, largement
passé dans la langue courante et qui fait l'objet du chapitre précédent. Bref, cet objet qui
nous rassemble se définit comme la part langagière du travail, celle qui dit, celle qui
accompagne ou celle qui accomplit l’activité.
Dire, accompagner, accomplir
Ces trois verbes ne sont pas équivalents. Ils qualifient des degrés différents de
chevauchement entre le dire et le faire. Dire renvoie aux fonctions référentielles, réflexives
et expressives du langage, à une parole "sur" ou "à propos" du travail (Lacoste, 1995), à une
matière énonciative de l'après coup (commentaires, sondages, enquêtes, entretiens, récits)
que les sociologues ont, depuis toujours, su solliciter, analyser, exploiter (Borzeix, 1995).
Les verbes accompagner et accomplir impliquent, en revanche, une relation étroite entre
parole et action. Ils invitent à comprendre cette relation comme une "coproduction", une
production conjointe où énonciation et activité s'étayent et, parfois, se confondent. Ils
soulignent le fait que les choses, au travail comme ailleurs, non seulement se disent mais se
font avec des mots, pour reprendre le titre du livre de John L. Austin Quand dire c'est faire

31
31
(1962). En partie, quand le langage "accompagne", assiste l'action (la parole d'action) ou
complètement, lors qu'il "l'accomplit" (la parole comme action). La thèse est connue. La
valeur performative de certains énoncés font d’eux des actes du seul fait d’être prononcés
(“je promets” équivaut à promettre), propriété étendue par la suite à tout énoncé
présentant les caractéristiques d’un acte de langage , direct ou indirect, à nombre d'énoncés
constatifs qui ont valeur illocutoire et dont les classifications peuvent être très extensives :
l’ordre, la requête, la réclamation..... (Searle, 1972)
2
.
Cette idée dont la portée sociologique a été reprise et discutée de façon critique par
Bourdieu vingt ans plus tard (Bourdieu, 1982) a connu jusqu'à une date récente peu de
retentissement chez les sociologues du travail et des organisations. Pour nous, sociologues
du réseau Langage et Travail, elle a fait l'effet d'une découverte : elle nous a servi de repère
théorique majeur. On s'y est référé chaque fois que l'on se prenait à douter de la pertinence,
pour nous et nos domaines de recherche spécifiques, de cet objet étranger qu'est le langage,
ce énième "palier en profondeur" de la réalité sociale, comme aurait pu dire Gurvitch (
Gurvitch, 1950).
Rétrospectivement, on pourrait dire que la performativité attribuée à certains énoncés
(appelés "performatifs") - ce pouvoir de faire ou de faire faire quelque chose à quelqu'un - a
fait office d'une sorte de paradigme nouveau, nous incitant à réviser nos problématiques,
nos théories en usage et à diversifier l'échelle de nos observations. A déplacer notre
compréhension de l'action sociale organisée qu'est le travail dans deux directions. Vers le
"bas", vers l'infiniment "petit" de ces unités langagières, si tant est que l'on puisse se
satisfaire de cette vision réductrice de la place et de la taille attribués aux "faits" de langage.
Mais aussi vers "l'intérieur", en prise plus directe sur les sujets de l'action, leurs intentions,
leurs interprétations, leurs interactions et la signification qu'ils leur prêtent. Si les mots,
dans certaines circonstances, contiennent une efficace telle qu'ils peuvent en arriver à
"guérir" (dans le cas de la cure psychanalytique) ou à "tuer", comme l'écrivait, en
anthropologue Jeanne Favret-Saada à propos de son expérience personnelle de la
sorcellerie dans le bocage (Favret- Saada, 1987), l'hypothèse pouvait-elle être transposée (et
à quelles conditions?), à des contextes plus profanes, celui des institutions productives, par
exemple ? Avait-elle un sens appliquée à des situations moins dramatiques et des activités
plus ordinaires, telles que celles réalisées au travail? Ou tombait-elle sous le coup de la
critique de "fétichisme" du langage, adressée par Bourdieu à Austin : les performatifs ne
détiendraient pas leur performance du fait de la vertu performative des mots eux-mêmes
2
Dans un ouvrage récent (Searle, 1998), John R. Searle va plus loin en proposant une version matérialiste du
pragmatisme étendu à la société : la construction sociale de la réalité - titre de l'ouvrage de Berger et Luckman de 1967
- dépendrait de la notion d’”intentionnalité” collective, ce qui met en évidence le rôle joué par le langage ainsi que par
les croyances individuelles que le langage a pour mission d’exprimer. Mais en dehors d'un milieu relativement
restreint de chercheurs spécialisés (souvent philosophes de formation), ces idées ont eu relativement peu d'écho
théorique en France.

32
32
mais plutôt de celle des situations sociales où ils sont prononcés et du pouvoir de ceux qui
sont légitimement autorisés à les énoncer?
La fin du langage -reflet
Cette "découverte" renouvelait nos façons d'envisager la relation entre langage,
connaissance et action. Elle nous a motivés aussi pour une autre raison. Elle coïncidait - et
venait conforter- avec une révision en profondeur de la conception courante du langage
qui a longtemps prévalu en sociologie. Elle nous aidait à rompre avec l'idée d'un langage
sans épaisseur, vu comme reflet, un véhicule, une matière transparente servant à
transporter de l'information.
Mais revenons d'abord, pour lever un malentendu, à la difficulté évoquée plus haut:
"penser" le langage en sociologie du travail. Si traiter du langage ne va pas de soi dans
notre domaine cela ne signifie nullement que la parole ou les mots n'y occupent aucune
place - ce qui pour une science humaine, serait pour le moins surprenant. Pour employer
un terme dont il nous arrive d'abuser on pourrait dire, en revanche, que le langage n'a pas
vraiment été "problématisé" dans nos recherches, que son statut épistémologique a été
assez peu clarifié, peu débattu. La conception commode du langage comme un miroir, une
trace, comme une réplique du monde à l'échelle des mots, a rendu les sociologues réceptifs
à deux branches de la linguistique : d'une part, l'analyse du discours, de l'autre, la
lexicologie et les études de terminologie. On a traité du vocabulaire propre à certains
métiers, considérés comme autant de signes d'appartenance identitaire, par exemple, ou
encore, plus près de nous, on s’est intéressé au "vocabulaires d'entreprise", les jargons et les
"dialectes", souvent ésotériques ou creux, ces mots du discours employés par les
responsables pour séduire, convaincre ou "communiquer".
Ce langage-reflet, utilisé dans nos travaux essentiellement à titre d’illustration, est aussi la
vision qui a nourri et continue de nourrir le gros de nos méthodes d’exploration et
d'exploitation des propos recueillis par entretien, quel que soit leur degré de non-
directivité (Demazière et Dubar, 1997). Sur elle repose le principe même de l'analyse de
contenu où c'est précisément le contenu "à extraire" qui compte pour les informations qu'il
contient, opération courante qui consiste à traiter les propos recueillis, à les classer, à les
thématiser, les catégoriser, les contraster, les coder, les comptabiliser - le contenant,
supposé transparent comme le verre, n'étant pas notre problème.
Mais si la formule chimique du verre, pas plus que les règles internes de l'agencement des
mots, ne sont, en effet, de notre ressort, le langage quant à lui est loin de se réduire à un
réceptacle inerte, un enchaînement structuré d’énoncés. On sait aussi, aujourd'hui, que les
sciences du langage ne se réduisent pas à la linguistique dont l’objet reste l'étude des
propriétés formelles de la langue. En font partie une série d'autres disciplines souvent plus

33
33
jeunes et moins stabilisées que la linguistique (comme la sociolinguistique, la linguistique
de l'énonciation, l’analyse de discours, la pragmatique, l'ethnographie de la
communication). Ce sont ces branches là qui alimentent plus directement les réflexions
présentées dans ce volume. Les recherches menées dans leur mouvance ont en commun de
s'intéresser au langage "en société", aux usages du langage et non plus seulement à sa
structure formelle ; à la variété de ses formes ; à ses différents aspects : l’écrit et l’oral, le
verbal et le gestuel ; à ses variations en contexte social, selon le cadre et la situation ; et enfin,
à l'utilisation qu'en font, réellement, les gens dans la vie courante pour interagir, travailler,
produire.
Et la fin du langage--véhicule
Les disciplines qui viennent d'être citées partagent aussi une posture critique vis à vis
d'une autre conception, dite instrumentale, du langage à laquelle nous avons longtemps,
largement mais implicitement adhéré en sociologie : du langage vu comme un message, un
outil de communication. Cette vision est généralement attribuée aux travaux précurseurs
d'ingénieurs en télécommunication des années 50 (Shannon et Weaver, 1975) et inspire
toujours, globalement, les pratiques et la littérature professionnelles sur la communication
en entreprise. Le langage y fait fonction de véhicule, servant à transporter, au moyen d'un
code supposé commun, des unités, c’est à dire des messages (des émulsions physiques),
entre un émetteur actif et un récepteur passif censés appliquer mécaniquement, du début à
la fin de l'émission, un code commun. Ce modèle, dit du code, a été largement remis en
cause depuis quarante ans (Sperber et Wilson, 1989) : parce qu'il ignore les différentes
“pollutions” qui sont pourtant la règle en matière de communication humaine (l’implicite,
le non-dit, le malentendu, l’interprétation, l’incompréhension)
3
qui se glissent entre ces
deux temps forts de la communication que sont l'émission et la réception ; parce qu'il
ignore aussi les circonstances de l'émission et les conditions de la réception ; parce qu'il
suppose une transparence pure et parfaite (comme les économistes orthodoxes postulent la
concurrence pure et parfaite sur le marché) entre ces pôles ; parce qu'il passe sous silence,
enfin, la question des places énonciatives (qui parle à qui et pour quoi faire) et celle des
mécanismes d’attribution ou de construction du sens (Boutet, 1994). Le dépassement de ce
modèle représente, pour nous sociologues, un préalable qui ouvre la voie à des recherches
conjointes ainsi qu’à un domaine de connaissance spécifique, la sociologie du langage
(Achard, 1993), sur la base d'un langage en quelque sorte "socialisé" dont la matière sera
désignée, en France - par analogie avec les autres pratiques sociales qui intéressent la
sociologie - par le terme de pratique langagière (Boutet, Fiala, Simonin, 1987).
Pourtant, cette conception ferroviaire ou postale du langage servant à transporter des
voyageurs, des paquets, des messages est si prégnante, bien que peu explicitée en
3
Sur le maquis terminologique auquel ces notions renvoient on peut se reporter à Catherine Kerbrat-Orecchioni, L'implicite,
Paris, Colin, 1986
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%