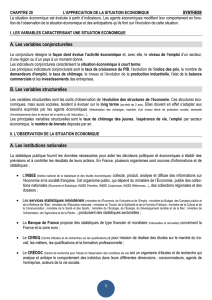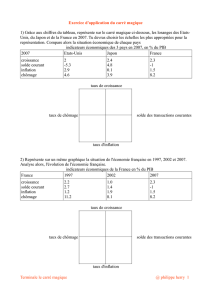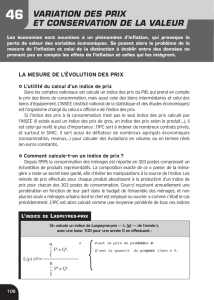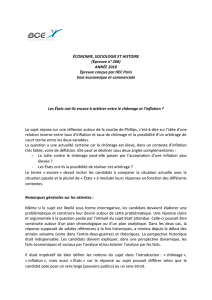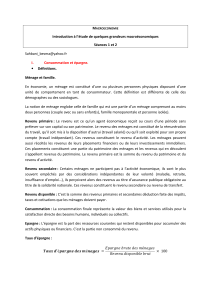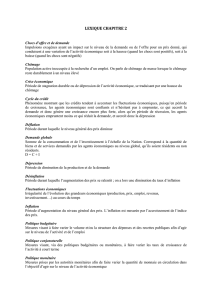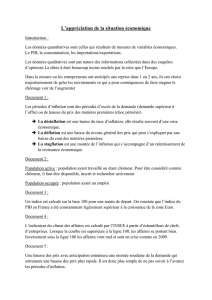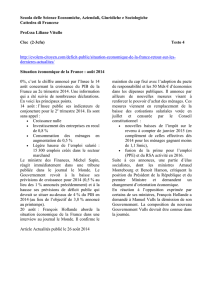Taux d`épargne (comptabilité nationale) - BTS

Les chiffres et les grands agrégats de l’économie
Page 1 sur 10
Taux d'épargne
Définition : Le taux d'épargne est le rapport entre l'épargne (part du revenu qui n’est pas
consommée) des ménages et leur revenu disponible brut.
Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité, les revenus du patrimoine, les transferts en
provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de
chômage), nets des impôts directs. Quatre impôts directs sont généralement pris en compte : l'impôt sur le revenu, la
taxe d'habitation et les contributions sociales généralisées (CSG) et contribution à la réduction de la dette sociale
(CRDS).
Les chiffres
Taux d'épargne
Taux d'épargne
financière
Taux d'investissement
immobilier
2003
15,8
6,7
7,5
2004
15,8
5,9
8,0
2005
14,9
4,8
8,3
Source : Insee, Comptes nationaux.
Commentaire
En 2005, la croissance du revenu disponible se ralentit, obligeant les ménages à puiser dans leur
épargne pour augmenter leur dépense de consommation. Leur taux d’épargne passe de 15,8 % en
2004 à 14,9 % en 2005, niveau le plus faible depuis 1995. La capacité de financement des
ménages se réduit une nouvelle fois (53,3 Mds d’euros soit - 11,2 Mds de baisse). Leur taux
d’épargne financière s’établit à 4,8 % après 5,9 % en 2004.
Taux d'investissement
Définition : Rapport de l'investissement à la valeur ajoutée
Les chiffres
Taux d'investissement des sociétés non
financières
2003
17,0
2004
17,4
2005
17,6
Source : Insee, comptes nationaux base 2000.
Valeur ajoutée
Définition : Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la consommation intermédiaire
(valeur des biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de
production).

Les chiffres et les grands agrégats de l’économie
Page 2 sur 10
Les chiffres
Valeur ajoutée
2005
2005/2004
Branches
millions d'euros
courants
valeur %
volume %
Agriculture
33 634
-7,9
-11,2
Industries agricoles et alimentaires
26 866
-12,1
1,5
Industries des biens de consommation
37 786
0,4
5,4
Industrie automobile
15 051
-13,4
-3,0
Industries des biens d’équipement
41 038
-0,1
2,1
Industries des biens intermédiaires
79 536
2,7
0,2
Énergie
31 587
8,4
5,5
Construction
88 549
5,7
0,6
Services principalement marchands
843 305
3,8
1,8
dont : Commerce
162 356
1,6
1,2
Transports
64 042
2,3
0,1
Activités financières
70 857
-2,0
2,3
Activités immobilières
207 436
6,6
2,5
Services aux entreprises
254 550
5,4
2,3
Services aux particuliers
84 064
2,4
1,0
Services administrés
333 921
3,4
0,3
dont : Éducation, santé, action sociale
213 165
3,6
0,4
Administration
120 756
3,0
0,2
Ensemble
1 531 273
2,8
1,1
Champ : France métropolitaine et DOM.
Source : Insee, comptes nationaux base 2000.
Commentaire
La valeur ajoutée totalise 1 531 Mds d’€ (+ 1,1 % en volume et + 2,8 % en valeur).
L’activité agricole s’est nettement dégradée, sa valeur ajoutée recule de - 7,9 % en valeur et de -
11,2 % en volume. Les industries agroalimentaires subissent un fléchissement prononcé de leur
activité en valeur (- 12,1 %), les volumes augmentant modérément (+ 1,5 %). Dans la branche
construction, la valeur ajoutée décélère un peu plus en volume mais reste dynamique en valeur.
Dans les branches manufacturières (hors IAA), la valeur ajoutée progresse peu en volume (+ 1,5
%). Les industries de biens de consommation et dans une moindre mesure de biens d’équipement,
sont à contre courant ; leur valeur ajoutée accélère, ces branches bénéficient d’une demande des
ménages et des entreprises dynamiques. Dans les biens intermédiaires, l’activité stagne. Le
secteur automobile voit sa valeur ajoutée chuter (- 3,0 % après + 4,3 % en 2004).
L’activité dans les services marchands est à peine plus dynamique que celle de l’industrie
manufacturière. La valeur ajoutée progresse de + 1,8 % en volume. Plus centrées sur le marché
intérieur et moins dépendantes des matières premières, ces branches résistent mieux. Les
services aux entreprises conservent de l’allant en raison du redressement des activités de
conseil et d’assistance. Les services aux particuliers, pourtant soutenus par la reprise de la
consommation des ménages en activités de loisirs, connaissent une croissance plus modérée.

Les chiffres et les grands agrégats de l’économie
Page 3 sur 10
Produit intérieur brut (PIB)
Définition : mesure la production de richesses d’un pays au cours d’une année. Il correspond à la
somme des valeurs ajoutées créées par les résidents, augmentée des droits de douane et de la
T.V.A.
Les chiffres
Commentaire
En 2005, malgré le redémarrage de la croissance en milieu d'année, le produit intérieur brut
s’accroît en moyenne annuelle de 1,2 % en volume, après 2,3 % en 2004 et 1,1 % en 2003. Le solde
extérieur continue de freiner l'activité et les dépenses des administrations publiques décélèrent
nettement. En revanche, la consommation effective des ménages et l'investissement des
entreprises restent dynamiques.
Produit national brut (PNB)
Définition : Il correspond à la somme des valeurs ajoutées créées par les unités économiques
nationales qu'elles soient sur le territoire national ou à l'étranger.
P.N.B. = P.I.B. + revenus des facteurs reçus du reste du monde - revenus des facteurs versés au reste du monde

Les chiffres et les grands agrégats de l’économie
Page 4 sur 10
Indicateur de Développement Humain (I.D.H.)
Définition : L'Indicateur de Développement Humain, ou I.D.H., a comme objectif d'essayer de
mesurer le niveau de développement des pays, sans en rester simplement à leur poids économique
mesuré par le PIB ou le PIB par habitant. Il intègre donc des données plus qualitatives.
C'est un indicateur qui fait la synthèse (on l'appelle indicateur composite ou synthétique) de
trois séries de données :
l'espérance de vie à la naissance (qui donne une idée de l'état sanitaire de la
population du pays),
le niveau d'instruction mesuré par deux indicateurs : le taux brut de scolarisation
(nombre d'élèves dans le primaire, le secondaire et le supérieur / effectifs des
classes d'âge concernées) et le taux d'alphabétisation des adultes,
le PIB réel (c'est-à-dire corrigé de l'inflation) par habitant, calculé en parité de
pouvoir d'achat (c'est-à-dire en montant assurant le même pouvoir d'achat dans
tous les pays) ; le PIB par habitant donne une indication sur le niveau de vie
moyen du pays.
L'IDH est calculé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il se
présente comme un nombre sans unité compris entre 0 et 1. Plus l'IDH se rapproche de 1, plus le
niveau de développement du pays est élevé. Le calcul de l'IDH permet l'établissement d'un
classement annuel des pays.
Les chiffres
Commentaire
L'Indicateur du Développement Humain ne cherche plus à mesurer le niveau de richesse d'un
pays, mais la possibilité pour ses habitants d'y vivre longtemps, en bonne santé, d'y acquérir une
instruction dans des conditions de vie convenables. Avec ce mode de calcul, le monde prend
encore une autre forme. Sur 174 pays étudiés, 64 présentent un niveau de développement humain
élevé, avec la Norvège en tête du classement, 66 un niveau moyen et 44 un niveau faible.

Les chiffres et les grands agrégats de l’économie
Page 5 sur 10
TAUX DE CROISSANCE
Définition : Le taux de croissance est un indicateur utilisé pour mesurer la croissance de
l'économie d'un pays d'une année sur l'autre. Il est défini par la formule suivante qui relie les
PIB de l'année N et de l'année N-1 :
((PIB de l'année N - PIB de l'année N-1)/PIB année N-1) x 100
Les chiffres
. Evolution de la croissance économique selon la zone géographique (source : IMF, avril 2006)
Evolution et projection de la croissance économique selon la zone géographique
Zone
2004
2005
2006*
2007*
Pays industriels
3,3 %
2,7 %
3,0 %
2,8 %
dont
Etats-Unis
4,2 %
3,5 %
3,4 %
3,3 %
Zone euro
2,1 %
1,3 %
2,0 %
1,9 %
Japon
2,3 %
2,7 %
2,8 %
2,1 %
Nouveaux pays industrialisés asiatiques
5,8 %
4,6 %
5,2 %
4,5 %
Autres pays émergents et pays en développement
7,6 %
7,2 %
6,9 %
6,6 %
dont
Afrique
5,5 %
5,2 %
5,7 %
5,5 %
Europe centrale et orientale
6,5 %
5,3 %
5,2 %
4,8 %
Communauté des Etats Indépendants
8,4 %
6,5 %
6,0 %
6,1 %
Chine
10,1 %
9,9 %
9,5 %
9,0 %
Inde
8,1 %
8,3 %
7,3 %
7,0 %
Moyen-Orient
5,4 %
5,9 %
5,7 %
5,4 %
Brésil
4,9 %
2,3 %
3,5 %
3,5 %
Mexique
4,2 %
3,0 %
3,5 %
3,1 %
Monde
5,3 %
4,8 %
4,9 %
4,7 %
* estimations
Commentaire
La croissance mondiale est estimée à 4,9% en 2006. Selon cette étude du FMI, ce sont les pays
en développement, notamment l'Asie et les pays de l'ex-Union soviétique qui soutiendront la
croissance en 2006. Avec une progression attendue de 2 %, la zone euro est à la traîne.
INFLATION
Définition : L'inflation est une hausse généralisée et persistante (donc cumulative) du niveau
général des prix, se répercutant sur les anticipations des agents économiques. Il peut y avoir
hausse des prix sans inflation, lorsque cette hausse est subite et de faible durée, n'affectant
pas durablement les anticipations.
La stabilité des prix décrit la situation où la hausse des prix est durablement très faible ou nulle,
n’influençant donc pas les décisions des agents économiques.
La déflation est le contraire de l'inflation. C'est donc un phénomène durable et généralisé de
baisse des prix, qui modifie les anticipations des agents économiques. Comme le phénomène
historiquement le plus fréquent (du moins dans la période contemporaine) est bien l'inflation, on
parle parfois aussi d'une inflation négative.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%