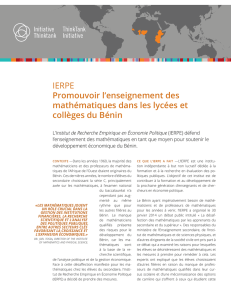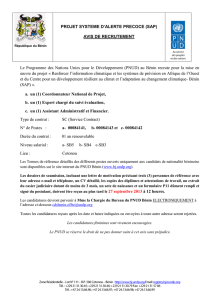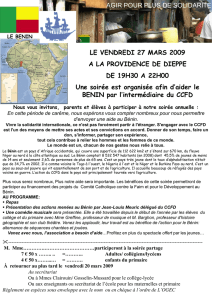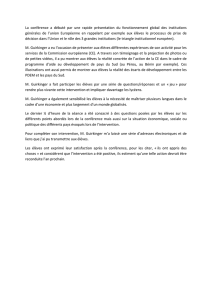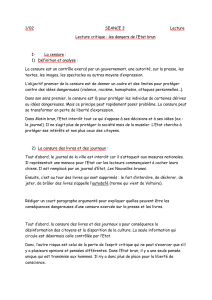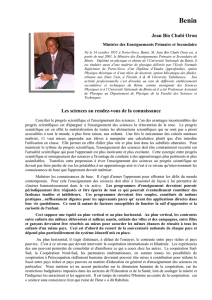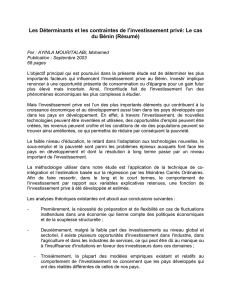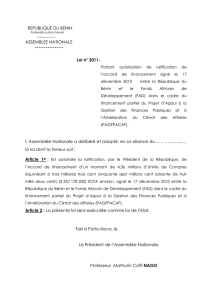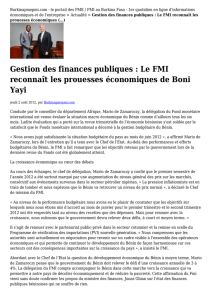La presse au Bénin : une influence étatique encore trop

La presse en Afrique : une influence étatique encore trop forte
Sur le continent noir, les journaux ont acquis plus de liberté et se développent. Mais beaucoup
sont menacés par la censure, qu’elle soit de caractère économique ou judiciaire.
Dans les pays francophones, le bouillonnement de la presse du début des années 1990 a bouleversé le
paysage médiatique africain. Après la libéralisation des espaces audiovisuels et la démonopolisation
des médias d’Etat, les organes de presse se sont multipliés presque partout sur des marchés nationaux
trop étriqués pour assurer la survie de tous. Dans cet environnement, ce que la presse africaine a gagné
en liberté du point de vue législatif, elle l’a perdu de par la censure économique. Cela se ressent au
Niger, au Tchad, au Cameroun, en Côte-d’Ivoire, au Bénin et au Burkina Faso. La précarité
économique des entreprises de presse a beaucoup joué, tant dans le non-respect des règles
déontologiques que dans la qualité des contenus des médias.
L’ex-président Kérékou disait qu’il n’était pas à même de donner des emplois à tous les Béninois,
mais que, si le fait d’écrire n’importe quoi sur lui pouvait permettre à des journalistes de gagner leur
vie, c’était tant mieux. Quand on sait qu’il est à l’origine du renouveau médiatique dans son pays pour
avoir incité à la création du premier journal indépendant et qu’il n’a jamais consenti à mettre un
journaliste en prison, on comprend que sous son régime le Bénin ait occupé son meilleur rang dans le
classement de Reporters sans frontières.
Dans plusieurs pays, la liberté de la presse a fait des progrès remarquables et l’on peut affirmer que la
presse africaine est bel et bien libre. Toutefois, cette liberté est sérieusement mise à mal par la censure
économique. Dans la plupart de ces pays, l’outil économique se trouve concentré entre les mains de
l’Etat. Il manque aux opérateurs économiques privés, qui auraient pu donner une bouffée d’oxygène à
la presse, la culture de la publicité ou le courage de s’afficher dans des médias qui revendiquent leur
indépendance. Voilà pourquoi de nombreux patrons de presse sont contraints de fermer boutique.
Certains font paraître leurs journaux épisodiquement, d’autres jouent les thuriféraires des régimes ou
les équilibristes entre les tenants du pouvoir et les autres composantes du pays. Les aides croissantes
des Etats à la presse auraient pu contribuer à sauvegarder sa liberté. Mais, dans certains pays, l’infinie
multiplication des médias réduit ces aides à une simple goutte d’eau dans la mer.
Dans un petit pays comme le Bénin, on enregistre plus d’une cinquantaine de quotidiens. On
comprend alors que des « enveloppes rouges », appelées ici « communiqué final », circulent pour
récompenser les prestations des journalistes. Et que des « contrats » ou « partenariats » avec des
sociétés ou institutions d’Etat, voire avec le gouvernement, aient raison de l’esprit critique et de
l’impartialité de certains confrères. A cela s’ajoutent les redressements fiscaux à l’encontre des
entreprises de presse, qui constituent de véritables moyens de chantage ou de pression. La censure
économique est plus efficace encore que la rétention de la publicité.
Tous ces phénomènes sévissent dans plusieurs pays africains, mais au Bénin ils ont pris des allures
inquiétantes, au point qu’on est passé des médias de référence de la fin des années 1980 à des médias
de révérence. Et pour cause : afin d’échapper aux redressements fiscaux ou de bénéficier de ces
fameux « contrats » qui assurent la pérennité des entreprises de presse, ils sont nombreux à rivaliser
d’éloges à l’endroit du pouvoir d’une part, et à désinformer d’autre part.
Serge Félix N’Piénikoua
Dans l’Action Républicaine (Cotonou, Bénin).
1
/
1
100%