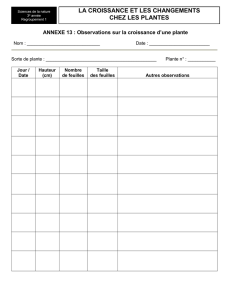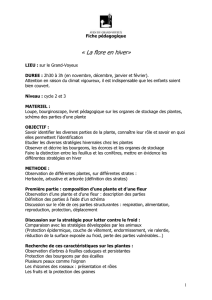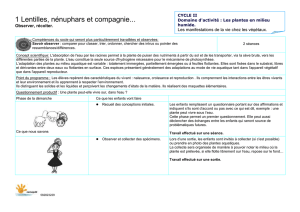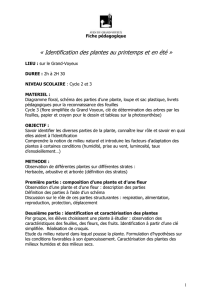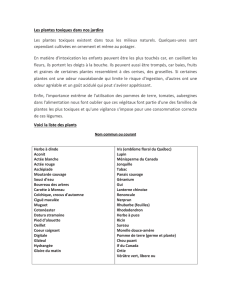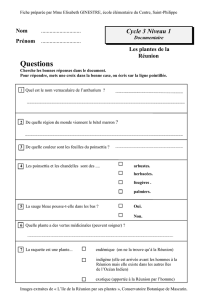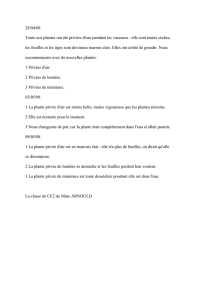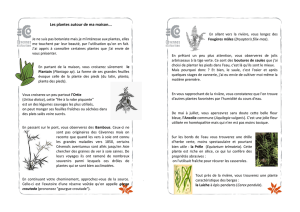Les variétés résistantes à des insectes nuisibles

1
Les variétés résistantes à des insectes nuisibles
Les variétés de maïs résistantes à la pyrale et la sécurité
sanitaire
Gérard PASCAL
Directeur de recherche honoraire, INRA
Je vais sans doute répéter un message que vous avez souvent entendu mais il n’est pas inutile
de rappeler certaines choses que beaucoup de participants à des débats sociaux et politiques
semblent encore ignorer.
L’approche toxicologique de l’alimentation est née dans les années 1950, au niveau de
l’OMS. Elle est attribuable en particulier au Professeur René Truhaut, titulaire à l’époque de
la chaire de toxicologie à la Faculté de Pharmacie de l’Observatoire. Cette méthodologie a été
sans cesse améliorée depuis. Elle s’applique à des molécules chimiquement définies pour
lesquelles l’exposition du consommateur – humain ou animal – est faible. Les additifs
alimentaires ont servi de base à la construction de cette méthode, qui a été ensuite étendue aux
contaminants, aux arômes, aux matériaux en contact avec les aliments, aux auxiliaires
technologiques et à toute substance pour laquelle l’exposition du consommateur est faible.
Mais, au contraire, aucun des aliments que nous consommons aujourd’hui n’a fait l’objet
d’une évaluation du point de vue de la sécurité sanitaire à quelques rares exceptions près :
- les aliments irradiés (depuis une trentaine d’années) ;
- les aliments cuits ou réchauffés dans les fours à micro-ondes (au début des années 1990), qui
ont fait l’objet de quelques expérimentations seulement, alors que des millions de fours à
micro-ondes avaient été vendus sans qu’aucune étude n’ait été réalisée ;
- les fruits et légumes, qui ont fait eux aussi l’objet de quelques rares études.
Les aliments consommés aujourd’hui bénéficient d’une « history of safe use ». Un récent
article de la revue Food and Chemical Toxicology (décembre 2007) dresse un bilan de
l’application de ce concept. La notion de sûreté alimentaire correspond aussi au concept
GRAS (generally recognised as safe) né et appliqué aux Etats-Unis. Nous savons en fait
simplement que nos aliments courants ne sont pas des toxiques violents : mais les études
épidémiologiques qui étudient les effets à plus ou moins long terme de la consommation d’un
aliment sur la santé sont cependant peu nombreuses et apportent peu d’informations sur une
relation causale. Si nous savions tout des effets à long terme des aliments, nous éviterions
depuis longtemps de gaspiller des fonds en recherches en nutrition humaine.
La méthodologie toxicologique intègre deux aspects : le degré d’exposition – très faible mais
pour autant très variable entre les substances étudiées – et la structure chimique des molécules
: nous tentons d’établir un rapport entre la structure et l’activité toxique en même temps que
nous prenons en compte le degré d’exposition. La batterie de tests est complète si la structure
est inquiétante et l’exposition assez élevée et elle peut être simplifiée si l’exposition du

2
consommateur est faible, et l’on peut même appliquer le concept de « seuil de préoccupation
toxicologique » lorsque l’exposition est située en deçà d’un certain seuil : les tests nécessaires
sont alors très allégés. Cela permet d’économiser des moyens et des vies animales lors de la
phase expérimentale. Tous les laboratoires d’expertise du monde ne suffiraient pas si nous
devions évaluer toutes les substances auxquelles nous sommes exposés avec toute la batterie
de tests toxicologiques et nous devons donc établir des priorités.
La plupart des tests in vivo sont standardisés et les lignes directrices de l’OCDE relatives à ces
protocoles sont acceptées au plan international. Les résultats ne peuvent être pris en compte
que si ces règles sont respectées. En outre, les laboratoires réalisant les essais doivent
respecter les bonnes pratiques de laboratoire (GLP) et être placés sous assurance qualité. Il
existe peu de laboratoires publics en France remplissant ces conditions. Je mets en garde les
parlementaires sur le risque de distribuer une partie des fonds publics (les 45 millions d’euros)
à des laboratoires qui n’ont ni la compétence, ni les installations qui leur permettront de faire
reconnaître leurs résultats sur le plan international.
Nous pratiquons des tests à 28 jours conditionnant les conditions de l’étude à 90 jours chez les
rongeurs et qui identifient les tissus et organes cibles de la substance. Si une étude à plus long
terme s’impose du fait de résultats inquiétants constatés à court ou moyen terme, les doses
employées devront alors être inférieures à la dose toxique. En particulier, si la toxicité est
manifeste, les résultats des études de cancérogenèse ne seront pas interprétables.
S’agissant d’expositions faibles, les doses choisies pour l’expérimentation sont toujours très
largement supérieures à l’exposition humaine (jusqu’à 100 000 fois) de façon à pouvoir fixer
des coefficients de sécurité ou d’incertitude dans le cadre de la gestion du risque. Ces
coefficients sont d’au moins 100 mais peuvent être supérieurs. Nous définissons ensuite une
dose journalière acceptable (DJA) – dans le cas des additifs alimentaires, par exemple – une
dose journalière tolérable (DJT) – dans le cas des contaminants – ou nous émettons une
recommandation ALARA (as low as reasonably achievable) dans le cas des substances
contaminantes cancérogènes génotoxiques. Dans ce dernier cas, nous proposons aujourd’hui
de fixer des marges de sécurité (margin of exposure) qui permettront aux gestionnaires de
risques de définir des priorités : tous les risques ne peuvent pas être gérés de la même façon et
les décisions doivent par conséquent être prises en fonction des niveaux comparés de risque.
Nous ne pouvons pas disposer de marges de sécurité de ce type pour les aliments. Nous ne
pouvons pas nourrir des rats avec plus de 50 % de maïs. Ainsi, si l’on compare l’exposition de
ces rats à des Mexicains gros consommateurs de maïs, la marge de sécurité sera faible. C’est
la raison pour laquelle la sécurité sanitaire de la majorité de nos aliments n’a jamais été
testée : les méthodes applicables pour des molécules chimiquement identifiées ne le sont pas
pour des aliments. J’ai tenté d’expliquer cela à plusieurs reprises à certains de mes collègues
de la commission du génie biomoléculaire, sans succès malheureusement.
L’évaluation du MON 810 ou du MON 863 pose les mêmes types de questions. Ces plantes
présentent des différences intentionnelles par rapport aux plantes non modifiées : elles
résultent des gènes d’intérêt ou des gènes marqueurs introduits dans la plante. Dans le cas du
MON 810, il s’agit uniquement de gènes d’intérêt. Les différences intentionnelles consistent à
faire exprimer une protéine à une très faible concentration par le gène d’intérêt (de l’ordre
d’un microgramme par gramme de plante) ou par le gène marqueur. La toxicologie
alimentaire traditionnelle permet d’étudier la sécurité de ces protéines, comme nous venons de
le voir.

3
Ce que nous ne savons pas en revanche évaluer ce sont les effets non intentionnels de la
modification génétique. Il existe un risque, en théorie, à introduire une construction étrangère
dans le génome d’une plante qui fonctionne harmonieusement sans elle. Cela peut créer des
modifications du métabolisme de la plante, donc des risques imprévisibles. Il faut alors
réaliser une évaluation sanitaire de la plante elle-même et non de l’un de ses constituants.
Nous en sommes ramenés au cas précédemment évoqué : l’évaluation d’un aliment, ce que les
méthodes traditionnelles ne permettent pas de réaliser correctement.
Il fallait donc imaginer une autre approche : il s’agit d’une approche comparative, née voici
une quinzaine d’années et affinée depuis. En 1993, l’OCDE a publié un rapport intitulé :
« évaluation de la sécurité des denrées alimentaires issues de la biotechnologie ». Des
réunions internationales ont eu lieu sur le sujet, à l’initiative notamment de l’OCDE, dont une
en France en 1997. Je l’ai coprésidée en compagnie d’un membre de la Food and Drug
Administration, Jim Marianski. Je représentais alors la commission du génie biomoléculaire
(CGB). De nombreuses réunions ont eu lieu par la suite à l’initiative de la FAO, de l’OMS, de
l’Union européenne.
Nous avons abouti à un consensus au sein de la communauté scientifique internationale
(Figure 1). Puisque les méthodes traditionnelles de la toxicologie alimentaire sont
difficilement applicables aux aliments, il s’agit de comparer la plante génétiquement modifiée
ou les aliments qui en sont issus à un comparateur : la plante génétiquement la plus proche
possible à n’avoir pas été génétiquement modifiée. On compare alors les caractéristiques entre
ces deux plantes : moléculaires, phénotypiques, agronomiques, de composition. Il s’agit du
concept d’équivalence en substance. De multiples rapports ont été rédigés sur le sujet auprès
de l’Union Européenne, de l’OCDE, de l’OMS, etc. Lorsque certains prétendent que nous ne
savons rien et que nous n’avons rien fait, je les invite à venir consulter ma documentation.
J’insiste en particulier sur un gros projet européen (un « cluster », réunion de cinq ou six
projets de recherche) « ENTRANSFOOD » dont les résultats ont été également publiés dans
Food and Chemical Toxicology, la « Bible » des toxicologues de l’alimentation (Figure 2).
Cette approche a été reconnue par le Codex alimentarius et fait référence dans les discussions
internationales au niveau de l’OMC.
La mise en œuvre du concept d’équivalence en substance n’est pas une évaluation
toxicologique ; sa conclusion est : la PGM est ou n’est pas aussi sûre que la plante non
génétiquement modifiée, considérée comme sûre, alimentaire.
Pour aller au-delà du concept d’équivalence en substance, et accroître encore la sécurité des
aliments, il faut donc envisager de nouvelles approches. Lorsque j’exerçais ma fonction de
directeur scientifique à l’INRA, j’ai encouragé les recherches sur des méthodes plus sensibles
qui pourraient nous permettre de répondre aux questions toxicologiques posées. Ces méthodes
reposent sur la mise en œuvre de techniques en « ique », de post-génomique :
transcriptomique, protéomique et métabolomique.
L’allergie est une autre question difficile à traiter. J’ai reporté sur la figure 3 le consensus
international en la matière. Je conteste violemment la partie gauche du schéma : il ne faut
surtout pas rechercher des transgènes dans des sources connues comme des allergènes. C’est
l’objet d’une polémique, depuis une dizaine d’années, avec nos collègues américains. Je
pense que c’est un risque supplémentaire superflu dont la démonstration a été faite à
l’occasion de la vieille affaire du soja ayant intégré un gène de la noix du Brésil.

4
En conclusion, les débats ont été très animés avant d’aboutir au consensus international. Il
serait faux de dire que les scientifiques et les entreprises de biotechnologie étaient de mèche et
que le consensus est venu rapidement. D’intenses conflits scientifiques ont eu lieu, dont
certains ne sont pas tout à fait terminés. Après une quinzaine d’années de réunions
internationales, un consensus a été obtenu. Si vous voulez connaître plus en détail la
méthodologie d’évaluation en toxicologie et en sécurité sanitaire, sachez que l’autorité
européenne de sécurité alimentaire a réalisé récemment un document sur le rôle de
l’expérimentation animale. Vous pouvez le trouver sous une forme encore non définitive sur
le site de l’AESA ou EFSA (European food safety authority). Il s’agit d’un rapport
scientifique qui a d’ailleurs été accepté pour publication dans Food and Chemical Toxicology.
L’expérimentation animale n’est envisagée que si des éléments inquiétants résultent de
la mise en œuvre des étapes préliminaires de l’approche comparative de l’équivalence en
substance.
Une réunion s’est tenue le 13 novembre à Bruxelles à l’initiative de l’Autorité européenne de
sécurité alimentaire en présence des représentants des autorités nationales chargées de la
sécurité sanitaire des aliments. Au cours de cette réunion, nous avons évoqué la méthodologie
que je viens de présenter. Seules trois agences nationales ont émis des critiques à propos de
cette méthodologie : il s’agissait des délégations de l’Autriche, de la Hongrie et de la
Belgique – dont la position était ambiguë. Toutes les autres agences – y compris l’AFSSA –
ont reconnu la validité de cette méthode
Une communication est – ou sera très prochainement – disponible sur le site de l’AESA, au
sujet de la différence entre la signification statistique et la signification biologique d’un
résultat. Certains statisticiens ont tendance à faire abstraction de la biologie.
Aucun risque avéré des plantes génétiquement modifiées mises en culture – ou dont une
demande d’autorisation de mise sur le marché a été déposé – n’a pu être révélé à ce jour par
une quelconque étude scientifique réalisée selon un protocole reconnu au niveau international.
Nous ne prétendons pas que le risque de ces plantes est nul mais il est clair que le risque
sanitaire qu’elles représentent n’est pas plus important que pour les aliments courants.
Les questions encore en suspens concernent les effets à long terme des aliments – et pas
seulement des plantes génétiquement modifiées et des aliments qui en sont issus. Je pense en
particulier aux aliments nouveaux, voire exotiques, qui nous sont régulièrement proposés sur
les marchés. Personne ne les a jamais évalués et personne ne nous a jamais interrogés à leur
propos. Par ailleurs, l’évaluation des risques allergènes reste un problème très complexe. La
recherche travaille sur le sujet depuis des années et progresse mais ne permet toujours pas, à
l’heure actuelle, d’apporter une sécurité absolue (le risque 0 !) au consommateur humain.
Figure1

5
 6
6
 7
7
1
/
7
100%