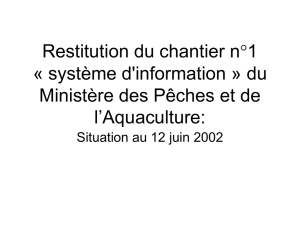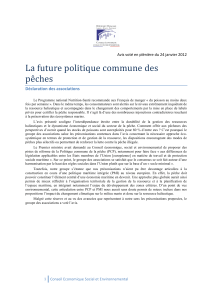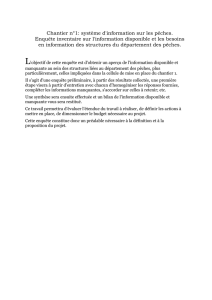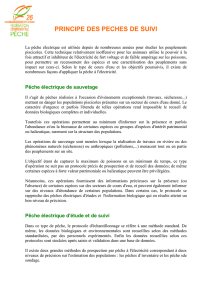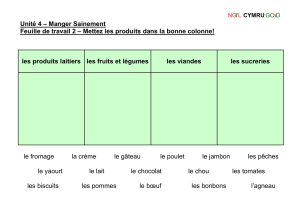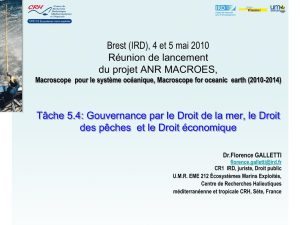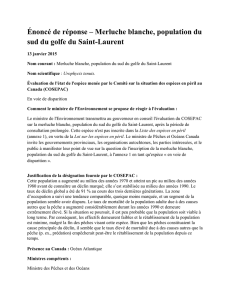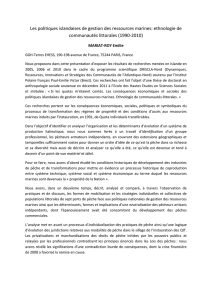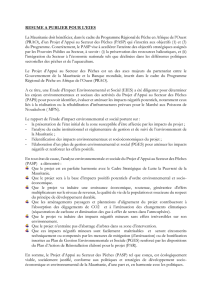le document - Jean Le Fur

1
ORGANISATION ET ORIENTATION SCIENTIFIQUE
DU GRAND PROGRAMME 4
“ DYNAMIQUE DE L’EXPLOITATION ET PRATIQUES DE
GESTION ”
UR15 DEPARTEMENT TOA
Responsable : Christian CHABOUD
Introduction
Les nouveaux enjeux liés aux usages et à la gestion des ressources marines, largement mis en
évidence par l’évolution des pêcheries des pays tropicaux, plaident en faveur d’une nouvelle
approche plus globale et pluridisciplinaire des systèmes halieutiques, tant pour
l’identification et l’analyse de leurs éléments constitutifs et de leur structure que pour la
production d’informations destinées à éclairer les choix décisionnels des différentes
instances présentes dans le secteur des pêches. La question du développement viable des
pêcheries, qui doit permettre aux générations actuelles de tirer profit des composantes
vivantes des écosystèmes, sans remettre en cause le bien-être des générations futures et la
reproduction biologique des ressources, apparaît particulièrement cruciale alors que le bilan
général des politiques d’aménagement et de gestion des pêcheries est plus que mitigé.
Conflits pour le partage des ressources, difficultés de constitution de flottilles nationales
industrielles viables, durcissement des nationalismes halieutiques, sont autant de questions
qui interpellent notre capacité d’analyse et de propositions pour des modes de gestion
alternatifs, dans une perspective globale qui ne peut isoler l’activité de pêche de ses
environnements naturel, socio-économique et politique.
Le Grand Programme 4 développera des recherches en partenariat pour renforcer notre
capacité de représentation et d’analyse des questions relatives à ces nouveaux enjeux
halieutiques. Ces recherches viseront également à renforcer les capacités de gestion et
d’aménagement des pêches des pays partenaires.
Elles s’appuieront donc sur une identification préalable et une analyse approfondie des
questions posées par les décideurs, et sur leur reformulation en termes scientifiques.
1. Les thèmes de recherche
L’intitulé du Grand Programme “ Dynamique de l’Exploitation et Pratiques de Gestion ”
met clairement en évidence les deux grandes composantes, exploitation et gestion, en étroite
liaison, de la thématique du Grand Programme.

2
Les processus dynamiques à l’interface ressource société
Etudier la Dynamique de l’exploitation des ressources halieutiques suppose l’identification
et l’analyse des processus induits, à l’interface ressource-société, par les usages et pratiques
mis en oeuvre par les hommes pour s’approprier techniquement, économiquement et
socialement certaines composantes vivantes de l’écosystème marin. Les études porteront
donc à la fois sur des aspects relatifs à la ressource exploitée et aux caractéristiques
économiques et sociales des activités humaines liées à l’exploitation. Cependant, ces aspects
ne seront abordés que dans la mesure ou ils participent de façon explicite aux interactions
entre composantes sociale et naturelle des systèmes halieutiques.
Les pratiques de gestion
Etudier les pratiques de gestion c’est repérer et analyser l’ensemble des arrangements,
conventions et institutions de régulation produits et mis en oeuvre par les acteurs
individuels et collectifs. Ils visent au contrôle de l’accès à la ressource et à l’usage des
facteurs de production (travail, capital). Ils régulent la création de la valeur économique et
son partage aux différents niveaux organisationnels présents dans les systèmes halieutiques.
L’approche de la gestion proposée ici se veut plus positive que normative. Il se s’agit plus
désormais de simplement proposer des recommandations s’appuyant sur une analyse
scientifique mais de décrire et de décrypter les processus décisionnels, individuels ou
collectifs, à différentes échelles, qui orientent les choix technologiques, économiques et
organisationnels, tels qu’ils s’imposent à l’observation et en fonction des questions de
développement.
2. Les domaines de recherche
Quatre domaines de recherche ont été identifiés. L’articulation entre des domaines s’appuie
sur une progression partant de démarches scientifiques exploratoires et analytiques pour
s’orienter progressivement vers des représentations plus globales et intégratrices, tant du
point de vue des disciplines impliquées que de questions prises en compte. Chaque domaine
entend répondre à des questions de développement.
2.1. Domaine n°1 : analyse statistique exploratoire pour la représentation
des exploitations halieutiques
La complexité des exploitations halieutiques explique en partie l’incapacité des décideurs à
suivre et à comprendre les dynamiques en jeu et donc à influer sur leur trajectoire. Les
actions de recherche proposée visent à réduire la complexité par la production de synthèses,
de typologies et de représentations intelligibles pour les décideurs. Elles visent aussi à
assister les recherches menées en aval pour disposer d’informations élaborées.
L’analyse statistique dans l’étude de l’exploitation halieutique conduit à la présentation de
synthèses des informations collectées. La nature et le contenu de ces synthèses est
déterminée, d’une part, par la nature des questions scientifiques et de développement, et
d’autre part, par les résultats des analyses exploratoires et préliminaires relatives à cette
information disponible ou à recueillir. Cette double détermination conduit à une implication
de la démarche statistique dans la construction de cadres synthétiques selon lesquels on
représente l’exploitation.
La recherche d’une représentation synthétique de la complexité du réel conduit à mettre en
oeuvre des démarches statistiques exploratoires (analyse de données, analyse de séries
chronologiques, estimation fonctionnelle, modèles linéaires généralisés, sélection de

3
modèles, méthodes d’analyse hiérarchique et de segmentation, analyse des données
symboliques) qui visent à produire :
des typologies qui alimenteront les diverses démarches modélisatrices présentes dans le
grand programme.
des réflexions sur la qualité et la validation des modalités de collecte des informations au
regard des objectifs de représentation poursuivis.
des modes de synthèses et de présentations des données qui soient plus directement
intelligibles pour les décideurs.
des représentations qui intègrent de façon plus explicite et complémentaire les
dimensions spatiales et temporelles des phénomènes halieutiques.
Les résultats obtenus et attendus dans le domaine de l’analyse statistique se situeront à
l’interface des différents domaines abordés dans le Grand Programme 4, relatifs à la
modélisation, à la représentation et bien sûr aux systèmes d’information en général.
2.2. Domaine n°2 : Dynamique des systèmes productifs et des systèmes de
gestion.
L’une des grandes questions de l’halieutique aujourd’hui est l’ajustement des capacités de
gestion et des modes de régulation à l’évolution rapide des conditions de l’exploitation. Les
pêches des pays tropicaux connaissent aujourd’hui une ouverture croissante vers les
marchés mondiaux, une accélération des innovations technologiques pour les moyens de
capture, des enjeux accrus pour le partage des ressources et pour l’accès aux facteurs de la
production. Une telle évolution n’est pas sans conséquence sur les ressources biologiques,
qui, dans certains cas, peuvent être pleinement exploitées, voire surexploitées. Les modes de
gestion classique s’avèrent le plus souvent insuffisants et trop peu adaptatifs pour assurer
l’ajustement des moyens de capture aux capacités de renouvellement de la ressource et à ses
variations naturelles.
Les différentes formes de modélisation, présentées par ailleurs, abordent ces questions sous
l’angle spécifique d’une approche très formalisée et quantifiée, elles ne sauraient cependant
être le moyen unique et suffisant pour y répondre. Elles supposent également des études
préalables.
L’analyse des systèmes halieutiques et de leurs composantes (système productif, système de
gestion) repose également sur une caractérisation préalable des acteurs, des modes de
captures et de valorisation, des unités d’exploitation et de gestion, des modes de gestion et
de régulation mis en oeuvre aux différents niveaux décisionnels. A une autre échelle, plus
fine, on analysera les formes d’organisation sociale des groupes de pêcheurs, les rapports de
production au sein des unités de pêche, la formation micro-économique des revenus et des
coûts, les rapports d’échange (formation des prix) et les règles de répartition de la valeur.
La question de l’ajustement des institutions et des modes de régulation à l’évolution des
conditions de l’exploitation suppose l’étude comparative des différentes modalités déjà
existantes au sein de pêcheries particulières et l’évaluation de leur capacité à remplir les
objectifs qui leur sont assignés. Ceci suppose également l’étude des systèmes de gestion
centralisés nationaux, du rôle des instances internationales, mais aussi des formes locales de
régulation de l’accès aux ressources et aux autres moyens de production, fondés sur des
formes d’emprise territoriales, sociale ou politique. Il conviendra ici également, dans la
mesure du possible, de procéder à des analyses comparatives des systèmes de gestion dans
différentes pêcheries, situées dans des contextes différents en termes de ressource et
d’environnement économique et social, pour juger du caractère générique ou spécifique de
leurs qualités par rapport aux objectifs poursuivis.

4
2.3. Domaine n°3 : systèmes d’information halieutiques.
Définir, constituer et mettre en oeuvre un système d’information halieutique est l’une des
conditions premières pour l’étude des dynamiques dans le secteur des pêches. Il s’agit en
conséquence d’un élément très présent dans les demandes des partenaires qui disposent
rarement des compétences suffisantes dans ce domaine. Pendant longtemps ce domaine a
été abordé sous l’angle privilégié des statistiques de pêches. Cette démarche a été critiquée à
juste titre en raison du caractère répétitif et parfois pérenne de ces actions et de leur manque
de lisibilité scientifique. Cette difficulté doit être contournée en abordant la question des
bases de données halieutiques comme un domaine de recherche visant à produire une
démarche générique pour leur conception, actualisation et utilisation à des fins d’analyse et
d’aide à la décision. Une telle démarche suppose la collaboration de thématiciens,
spécialistes des domaines disciplinaires présents (sciences de la nature, sciences de la
société), d’informaticiens et de statisticiens. Elle doit déboucher sur la mise à disposition, à
des fins d’analyse et d’aide à la décision d’outils synthétiques de collecte, d’échantillonnage,
de représentation de l’information dans différentes dimensions. La représentation spatiale
tend aujourd’hui à connaître un intérêt croissant avec les perspectives offertes par les
Systèmes d’Information Géographiques comme moyen de représentation synthétique et
comme support d’aide à la prise de décision. La dimension spatiale, abordée par ailleurs par
les GP2 et 1, est l’objet de nombreuse avancées en halieutique, ainsi que l’attestent les
développements présentés lors du dernier colloque de l’Association Française
d’Halieumétrie. Le projet SIG Afrique de l’Ouest de la Fao qui implique des pays partenaires
(Sénégal, Guinée, Maroc, Mauritanie) et auquel l’Orstom et le GP4 participent, atteste de
l’importance de ce domaine pour nos actions de recherche en partenariat. La dimension
temporelle, avec la production de séries chronologiques des variables les plus pertinentes
pour suivre l’état des systèmes halieutiques reste toujours indispensable. Une réflexion est
actuellement engagée sur la possibilité de croiser les dimensions spatiales et temporelles
dans les SIG, ainsi que sur le couplage de modules d’analyse. Le GP4 développera des
actions dans cette direction, tant en raison de l’expérience de ses chercheurs sur les bases de
données halieutiques, que de l’intérêt, scientifique et pour la recherche en partenariat, de ce
domaine. Cet axe de recherche concerne également les autres Grands Programmes de l’Unité
de Recherche, et peut être considéré comme transversal.
2.4. Domaine n°4 : modélisations intégrées et plurisdisplinaires de la
dynamique de l’exploitation
Les pêches artisanales sont, pour l’instant, le domaine privilégié, de cette démarche. A terme
il conviendra d’aborder également celui des pêches industrielles et celui des pêcheries
composites où coexistent différents types de flottilles, artisanales et industrielles.
Parmi les outils d’aide à la décision pour l’aménagement et le développement, la
modélisation tient une place privilégiée en raison de sa capacité à simuler les conséquences
d’événements exogènes ou de choix de gestion sur les variables d’état des systèmes
halieutiques. Les modélisations par simulation permettent notamment de produire des
scénarios mettant en évidence les réponses respectives des composantes naturelle et
économique des systèmes halieutiques. Elles permettent ainsi de juger de la viabilité
écologique et économique de systèmes halieutiques, à court et moyen terme, en fonction des
choix de gestion et de développement, et selon différents niveaux dans les contrantes
exogènes imposés par leurs environnements naturel, économique et politique.
L’évolution des systèmes halieutiques, aux différentes échelles temporelles et spatiales, est la
résultante de multiples interactions entre les éléments du milieu naturel et ceux relatifs aux
pratiques et usages des hommes. Représenter et étudier cette dynamique suppose de faire

5
appel aux formalismes de la modélisation, qui permettent de focaliser l’analyse sur les
relations et les éléments qui paraissent les plus déterminants au regard des questions de
développement posées. La modélisation est également un moyen de représenter la
complexité en la rendant plus intelligible grâce aux recours aux instruments mathématiques
(modélisation bio-économique classique) ou à ceux de l’intelligence artificielle.
La modélisation par intelligence artificielle
Parmi les différentes formes de modélisation des systèmes halieutiques, les méthodes
faisant appel aux techniques de l’intelligence artificielle sont parmi celles qui ont produit
les résultats récemment les plus novateurs. Les différentes méthodes disponibles dans ce
domaine (systèmes de connaissances expertes, approche orientée objet, simulation
multi - agents) permettent de représenter les processus de décision des pêcheurs et leurs
choix tactiques des différents types de pêcheurs en fonction des fluctuations de leur
environnement.
Les développements produits jusqu’ici au sein du Grand programme ont permis de
représenter la dynamique de l’activité de pêche et du mareyage en réponse à des
perturbations exogènes (marché, ressource). Cette voie de modélisation sera poursuivie
en élargissant son application à de nouvelles études de ces, à des fins de validation de la
démarche mais aussi pour identifier les facteurs génériques de la dynamique de
l’exploitation de ceux qui sont spécifiques à certains contextes. De même on intégrera de
façon explicite la réaction des stocks exploités à l’évolution de l’activité de pêche. Enfin
on s’orientera vers la mise au point d’outils conçus spécifiquement pour l’aide à la
décision (construction d’interfaces utilisateurs).
La modélisation bioéconomique : il s’agit de représenter l’interaction dynamique entre la
ressource biologique et l’activité de pêche dans le cadre de simulations de scénarios de
gestion dans différents contextes de variabilité. Les outils utilisés font appel aux
techniques classiques de la dynamique des populations exploitées pour la représentation
de la ressource, à celles de l’économie pour la représentation des principales relations en
rapport avec le marché, la dynamique du capital productif, l’impact des décisions de
gestion.
Les modèles bio-économiques sont en cours de développement au sein du Grand
Programme. Un modèle de simulation à moyen terme permet en outre d’étudier l’impact
du risque et de l’incertitude, tant économiques que naturelles sur la dynamique des
diverses variables d’état représentant la pêcherie. Ce modèle sera utilisé pour la
présentation de pêcheries monospécifiques. Un second type de modèle, de court terme,
décrit la dynamique des flottilles artisanales à travers la diversité des tactiques des pêches
et en relation avec la dynamique plurispécifique de la ressource et de perturbations au
sein de l’environnement de la ressource et des pêcheurs. Ce type d’approche est
particulièrement adapté pour représenter la dynamique adaptative à court terme des
pêcheries artisanales multispécifiques, particulièrement délicate à prendre en compte
dans les politiques d’aménagement et de gestion.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%