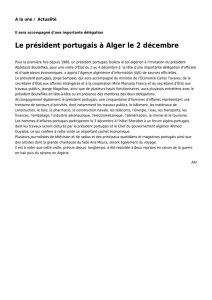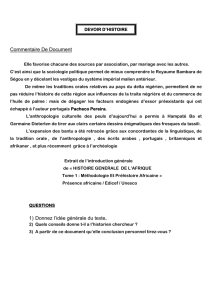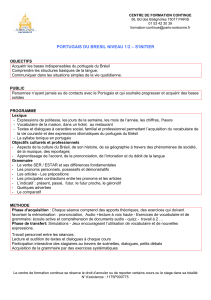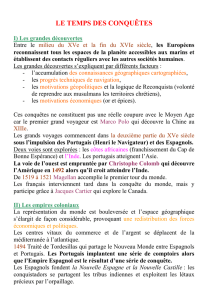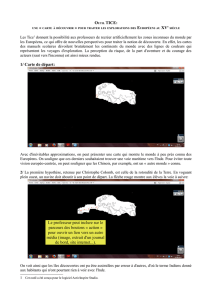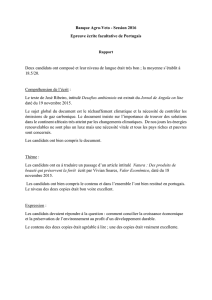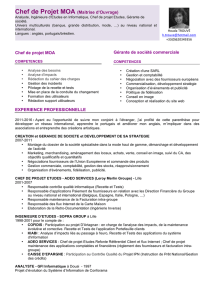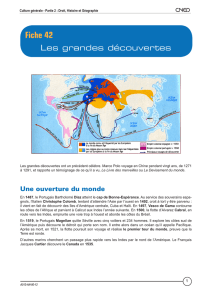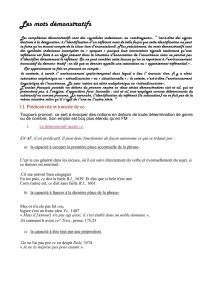Prédéterminants

Sur quelques divergences dans l’évolution
des démonstratifs français et portugais
1. Epoque moderne
La deixis et l’anaphore sont, de nos jours, l’objet d’un nombre d’ouvrages
considérable. L’intérêt pour les déictiques spatiaux en général et des démonstratifs
en particulier, s’explique par l’implantation profonde de la théorie de l’énonciation
dans la linguistique moderne.
Notre analyse n’a pas l’ambition de tracer les limites qui séparent la deixis
de l’anaphore ni de définir les domaines du démonstratif et du défini. Il nous
semble néanmoins qu’une étude contrastive et diachronique des formes des dé-
monstratifs français et portugais dans l’optique de la linguistique textuelle pourrait
contribuer à une meilleure intelligence du système de ces formes et des raisons qui
sont à l’origine des différences entre les paradigmes des démonstratifs français et
portugais.
En effet, une analyse synchronique ne peut que constater et inventorier ces
différences illustrées par les tableaux ci-dessous. Il nous faut pourtant les décrire
d’abord, pour ensuite essayer d’en trouver les raisons dans la diachronie.
1.1. Les paradigmes contemporains
Représentants
Prédéterminants
masculin
neutre
féminin
sing.
pluriel
sing.
pl.
masc.
fém.
simples
celui
ceux
ce
celle
celles
compo-
sés
celui-
ci
ceux-ci
ceci
celle-ci
celles-ci
singulier
ce, cet
cette
celui-
là
ceux-là
cela,ça
celle-là
celles-là
pluriel
ces
ces
este
esse
aquele
singulier / pluriel
neutre
singulier / pluriel
neutre
singulier / pluriel
neutre
masc.
fémin.
masc.
fémin.
masc.
fémin.
este(s)
esta(s)
isto
esse(s)
essa(s)
isso
aquele(s
)
aquela(s)
aquilo
Le paradigme français contient deux séries de formes distinctes, les unes
employées comme prédéterminants (articles), les autres comme représentants
(pronoms), mais recouvrant, pour beaucoup, à la fois le champ de la démonstration
et celui de la reprise. Cette opposition est strictement respectée en français
moderne. Le portugais utilise les mêmes formes comme prédéterminants et comme
pronoms.

2
Une autre opposition, moins rigoureuse, existe au sein du paradigme fran-
çais. C’est l’opposition binaire qui définit l’éloignement des référents. Pour
l’expression de ce rapport, le français recourt à des formes composées. Parfois
cette opposition n’est pas à même d’expliquer à elle seule leur distribution réfé-
rentielle, mais l’approche énonciative a fourni des thèses convainquantes qui
viennent combler ces lacunes (Kleiber, 1994 ; Corblin, 1995). En portugais, cette
opposition est ternaire. Les formes des trois séries sont en relation avec les trois
personnes du discours et la distribution spatio-temporelle des référents est plus
précise.
Il est possible de dégager une troisième différence : le français possède une
forme, le « neutre » ce, qui est indifférente à toute opposition ; les formes
portugaises de la série isto, « neutres » elles aussi, ne pourraient être considérées
comme des équivalents de ce. Elles gardent l’opposition ternaire et ne peuvent
rendre en portugais le sens de ce.
Par ailleurs, le portugais emploie souvent les formes de l’article défini o(s),
a(s) comme démonstratifs. Cet usage est correct et nullement archaïsant. Une telle
possibilité en français moderne n’existe pas. (Dragnev, Petrova, 1995)
2. Remarques sur l’histoire externe des deux langues
Le cadre historique, socio-politique et culturel dans lequel ont évolué les
deux langues détermine plusieurs convergences linguistiques.
Plus d’un siècle sépare la romanisation de la Gaule de celle de la péninsule
Ibérique. Les invasions germaniques sur le territoire actuel du Portugal qui ont
suivi ont eu un impact linguistique minime, se limitant aux apports lexicaux. La
domination arabe a peu marqué elle aussi la future langue portugaise. Aucune
modification significative du système grammatical n’en résulte (Teyssier, 1980).
La venue des Francs a été, en revanche, décisive pour l’évolution du fran-
çais. Le nord de la Gaule, romanisée plus tard et moins massivement, devient le
siège de changements galopants, à la différence du Midi ou la langue d’oc reste
conservatrice.
Ces événements déclenchent des phénomènes linguistiques souvent diver-
gents dans les deux langues et rendent impossible une analyse parallèle des dé-
monstratifs, d’autant plus que les étapes de l’évolution du français et du portugais
diffèrent beaucoup : l’ancien français date du IXe siècle et le galicien-portugais du
début du XIIIe. Le français connaît encore trois périodes, le portugais, selon les
ouvrages disponibles, une seule. Il s’agit donc de présenter les époques de
l’évolution des deux systèmes correspondant aux changements qui les ont modifiés
sensiblement.
3. Les origines
Le système des démonstratifs latins est fondé, comme celui du portugais
moderne, sur une opposition ternaire : hic, haec, hoc ; iste, ista, istud ; ille, illa,
illud appartiennent respectivement aux domaines du locuteur, de l’allocutaire et de

3
la personne qui est absente de l’espace de l’énonciation et sont indifféremment
pronoms ou adjectifs. On rattache souvent aux démonstratifs les formes is, ipse et
idem.
4. Ancien français vs galicien-portugais
Voici comment se présentent les deux paradigmes à la fin du XIIe et au début
du XIIIe siècles :
cist (<iste)
cil (<ille)
masculin
neutre
féminin
masculin
neutre
féminin
sing.
pluriel
sing.
pl.
sing.
pl.
sing
pl.
CS
CR1
CR2
cist
cest
cestui
cist
cez, ces
cez, ces
cest, ce
ceste
ceste
cesti
ceste
s
cil
cel
celui
cil
cels
cels
cel, ce
cele
cele
celi
celes
este
esse
aquele
masc.
fémin.
neutre
masc.
fémin.
neutre
masc.
fémin.
neutre
este(s)
aqueste(s)
esta(s)
aquesta(s)
esto
isto
esse(s)
(ipse)
essa(s)
esso
aquele(s)
aquela(s)
aquelo
La comparaison de ces paradigmes appelle les remarques suivantes :
— Le portugais a abandonné entièrement la série hic, haec, hoc ; le
français n’en a gardé que le troisième élément qui est à l’origine du neutre
ce(<ecce hoc) qui ne fait pas partie du système constitué par les formes de cist et
de cil. Les deux langues ont gardé les séries de iste et de ille.
— Dans les deux langues, toutes les formes, à l’exception des
« neutres », peuvent fonctionner à la fois comme prédéterminants et comme pro-
noms. — Dans les deux langues se produisent des interversions qui marquent
l’évolution ultérieure des paradigmes et qui au début suivent la même voie. Après
la disparition de hic, le champ du locuteur se voit déserté et il est occupé par les
formes dérivées de iste qui à leur tour quittent le domaine de l’allocutaire. Dans
une étude réalisée par P. Teyssier, étude sans laquelle cette analyse aurait été
impossible, il démontre qu’en galicien-portugais « ce qui se rapporte à l’allocutaire
(2e personne) peut aussi bien être désigné par este-aqueste que par aquel, selon que
l’objet est saisi par le locuteur comme présent ou absent, proche ou lointain. »
(Teyssier, 1990, p. 167) L’ancien français a opté pour une distribution
différente qui a suscité une discussion parmi les romanistes et a été à l’origine de
plusieurs thèses (Queffélec et Bellon, 1995). Pour donner une explication à la fois
claire et exhaustive, nous avons choisi un passage de G. Hasenohr : « Il (le
démonstratif déictique) situe les êtres et les objets dans l’espace. Il apparaît dans
les monologues et les dialogues ; cist, ceste désignent alors ce qui se trouve à

4
proximité de la personne qui parle et de son interlocuteur — a fortiori le locuteur
lui-même ; cil, cel désignent ce qui est à une certaine distance d’eux. » « Il (le
démonstratif de rappel) est fréquent dans les récits comme dans les dialogues.
D’une manière générale, cist, pronom des deux premières personnes (je, tu)
évoque ce qui concerne les personnages présents et parlants, ce qui est proche
d’eux, aussi bien dans l’espace ou le temps que dans la sphère affective (…), et qui
est précisément identifiable par le contexte immédiat (contexte linguistique,
contexte spatio-temporel). Étymologiquement pronom de la 3e personne, cil
évoque souvent ce qui concerne autrui, celui, ce dont on parle ; mais il fonctionne
avant tout comme terme non marqué de l’opposition cist/cil, simple mot de rappel
sans contenu propre, qui ne se différencie guère d’un pronom personne de 3e
personne ou d’un article défini. Cist est donc plus fréquent, et la distribution
cist/cil plus cohérente, dans les dialogues, où l’identification des référents doit être
immédiate, que dans le récit, où des informations peuvent toujours être fournies en
dehors du contexte direct. » (Hasenohr, 1993, p.56)
— L’ancien français et le portugais médiéval laissent déjà deviner les
futures évolutions. Le paradigme français est constitué de deux séries de dé-
monstratifs qui sont à l’origine des adjectifs et des pronoms d’aujourd’hui. Il
existe, dès le Xe, siècle une tendance à préférer cist comme prédéterminant et cil
comme représentant. Le paradigme portugais est constitué de trois séries ;
l’opposition sémantico-logique reste néanmoins binaire. Esse, issu de ipse, venu
combler le vide laissé par iste, n’a encore aucun rapport avec la 2e personne, du
moins jusqu’au XIVe siècles, mais il est déjà intégré au système. Dans les tout
premiers textes écrits en galicien-portugais il garde sa valeur et, dans une occur-
rence au moins, sa graphie d’origine, ou fonctionne comme anaphorique pur :
… in ipso die (« ce jour même ») (Noticia de torto, XIIIe siècle)
… e tirou sa espada da bainha e descabeçando o menor mouro que havia em
toda a Gaia , andaram todos á espada, e nom ficou em essa vila de Gaia pedra
sobre pedra, que toudo não fosse em terra. (A lenda de Miragaia XIIIe siècle)
« … et il tira son épée du fourreau et tranchant la tête à tous les Maures qui
se trouvaient à Gaia, ils avançaient tous, l’épée nue, et il ne resta dans cette ville de
Gaia rien qui ne fût rasé ».
En gallo-roman, ipse, s’emploie encore en concurrence avec iste pour
remplacer hic, mais ne parvient pas à s’imposer et en ancien français ses occur-
rences se limitent à quelques expressions figées à valeur adverbiale : en es le pas.
Hic disparaît à date précoce et ne s’emploie plus en gallo-roman, mais persiste
assez longtemps sur la péninsule Ibérique : on le retrouve dans Noticia de torto
sous sa forme originelle employé comme adverbe de lieu :
E subre becio et super fíímento, se ar quiser ouir as desõras qve ante ihc
furu, ar ouideas (Noticia de torto, XIIIe siècle)
« E après s’être embrassés et après avoir fait la paix, si tu veux de nouveau
entendre les infamies qui ont été commises ici, tu les entendras ».

5
— L’écart le plus voyant entre les deux paradigmes médiévaux résulte
de l’évolution du système casuel. Le démantèlement des cas a eu lieu avant
l’apparition de textes en galicien-portugais : seules les formes de l’accusatif sin-
gulier et pluriel subsistent. Le syncrétisme des cas s’observe aussi en gallo-roman,
mais il n’aboutit pas à la ruine totale du système : deux cas subsistent jusqu’au
XIVe siècles, mais on en trouve des débris même au XVIe siècle. Ainsi, le
paradigme français est plus étoffé syntaxiquement, ce qui permet d’ailleurs une
variété parfois déroutante des tournures phrastiques, alors que le paradigme
portugais est simplifié au maximum et se base sur la seule opposition de genre et
de nombre.
— Aussi bien en portugais qu’en français, les formes de la série ille
sont à l’origine des articles définis. Cette parenté est à l’origine d’un emploi spé-
cifique dans les deux langues. Dans certains contextes il est possible d’employer
l’article défini avec la valeur d’un démonstratif anaphorique. Cet emploi est fré-
quent :
1. Ancien français :
L’ame Uterpandragon son pere,
Et la son fil et la sa mere (Le chevalier au lion)
« L’âme de son père, Uterpandragon, et celle de son fils et celle de sa mère »
2. Galicien-portugais :
E o bispo do Portu. E o de Lixbona. E o de Coibria. (Testamento de D.
AfonsoII)
« Et l’évêque de Porto et celui de Lisbonne et celui de Coimbra. »
Toutes ces remarques nous permettent de constater que jusqu’au XIVe siècle
les systèmes des démonstratifs français et portugais contiennent beaucoup plus
d’analogies que de nos jours. Ressemblance renforcée par l’existence en portugais
médiéval d’équivalents exacts des pronoms français en et y (hi et ende). Mais ils
contiennent aussi les germes de divergences qui s’accentueront et qui
provoqueront la modification des traits fonctionnels et sémantiques de ces formes.
5. Du XIVe siècle à nos jours
Le paradigme portugais aux XVe et XVI siècles ne diffère pas beaucoup de
celui du galicien-portugais. Les changements formels sont rares et insignifiants :
esto et isto se confondent, celui-là s’alignant sur celui-ci, de même que aquel et
aquele. Deux tendances modifient pourtant les rapports qu’entretiennent les formes
des trois séries. 1. Esse devient de plus en plus fréquent et son emploi commence à
se généraliser. Il subit une autre évolution importante : il continue à s’employer
comme anaphorique, mais aussi, et de plus en plus souvent, comme déictique de la
2e personne et au XVIe siècle il « est complètement intégré dans le système » et
« la langue a reconstitué un nouveau système ternaire ». (Teyssier, 1990, pp. 195-
197). 2. Au XVIe siècle, le nombre des occurrences de aquele a chuté sensiblement
par rapport au XIVe siècle. De cette manière la fréquence d’emploi de chaque série
 6
6
 7
7
1
/
7
100%