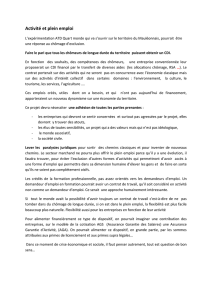Le chômage

Le chômage
Doc. a Taux de chômage harmonisés en % de la population active
Estimation pour novembre 2015 en % de la population active :
Japon
3,4
Allemagne
4,5
Autriche
5,6
Etats-Unis
5,2
Roy.-Uni
5,6
Danemark
6,1
Pays-Bas
6,8
France
10,8
Zone €
10,8
Italie
11,7
Espagne
21,8
Grèce
25,0
Source : O.C.D.E
.
Doc. b Trois définitions statistiques du chômage
1975
1990
2010
2015
au sens du B.I.T.
ou déduit
(enquête-emploi
de l’INSEE)
Etre sans travail.
Etre disponible immédiatement pour travailler.
Etre en recherche effective d’un emploi
815
2250
2653
2900
(3ème
trimestre)
au sens de Pôle Emploi
ou enregistré
(DEFM)
Etre sans emploi (sauf activité réduite > 78 heures)
Etre disponible pour travailler
Etre à la recherche d’un emploi à temps plein en CDI
(inscrit en catégorie A)
755
2520
2680
3575(nov .)
(5442 toutes
catégories
confondues)
au sens du recensement
ou spontané
Se déclarer chômeur et ne pas déclarer ne pas être à la
recherche d’un emploi
Ou se déclarer mère de famille, femme au foyer ou
retraité et déclarer être à la recherche d’un emploi
841
2733
3370
???
Rapport entre les estimations extrêmes
89,8%
82,4%
78,7%
Doc. c La critique keynésienne de la théorie classique du chômage
L'explication généralement admise est, si nous la comprenons bien, des plus simples. Elle ne fait intervenir aucune répercussion
indirecte, semblable à celles que nous examinerons par la suite. Le raisonnement est simplement le suivant: toutes choses égales
d'ailleurs, une réduction des salaires nominaux, en diminuant le prix des produits finis, stimule la demande et par suite développe
la production et l'emploi […]
Si tel est bien le principe du raisonnement (et sinon nous ignorons quel il peut être), l'argumentation est certainement fallacieuse.
Car, pour tracer la courbe de la demande dans une industrie particulière, on est obligé d'adopter certaines hypothèses fixes quant à
la forme des courbes de l'offre et de la demande dans les autres industries et quant au montant de la demande effective globale. Il
n'est donc pas légitime de transférer le raisonnement à l'industrie dans son ensemble à moins d'y transférer aussi l'hypothèse de la
fixité de la demande effective globale. Or cette hypothèse réduit l'argumentation à une pétition de principe. Personne en effet ne
songerait à nier que, lorsque la demande effective reste constante, une réduction des salaires nominaux s'accompagne d'une
augmentation de l'emploi ; mais la question qui se pose est précisément de savoir si les salaires nominaux réduits se trouveront ou
non associés à une demande effective globale qui, mesurée en monnaie, sera égale à la demande antérieure ou qui, au moins,
n'aura pas subi une réduction pleinement proportionnelle à celle des salaires nominaux (i. e. qui, mesurée en unités de salaire, sera
plus ou moins supérieure à la demande initiale). Mais, s'il est interdit à la Théorie Classique d'étendre par analogie à l'industrie
dans son ensemble ses conclusions relatives à une industrie particulière, elle est tout à fait incapable d'indiquer l'effet qu'une
réduction des salaires nominaux produit sur l'emploi, car elle n'a aucune méthode d'analyse qui lui permette de résoudre le
problème. La Theory of Unemployment du professeur Pigou nous semble extraire de la Théorie Classique tout ce qu'on peut en
tirer ; l'ouvrage est donc une preuve saisissante de l'inutilité de cette théorie lorsque on l'applique à la recherche des facteurs qui en
fait déterminent le volume global de l'emploi
John M. KEYNES, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1936, Livre V, « Salaires nominaux et prix »

Le chômage
Doc. d la typologie de la théorie du déséquilibre
Marché du travail
O > D
D > O
Marché des biens
O > D
Chômage keynésien
D > O
Chômage classique
Inflation contenue
D’après E. MALINVAUD, Réexamen de la théorie du chômage, 1980
Doc. e Le salaire minimum en France et aux Etats-Unis, 1950-2013
Lecture : Converti en pouvoir d'achat de 2013, le salaire minimum horaire est passé de 3,8$ à 7,3$ de 1950 à 2013 aux Etats-
Unis, et de 2,1€ à 9,4€ en France. Thomas PIKETTY, Le capital au XXIème siècle, chap. 9
Doc. f La substitution des facteurs de production lorsqu’on prend en compte la qualification du travail :
Travail substituable au Capital Travail non qualifié substituable au Travail qualifié
substituable au complémentaires
Capital
Doc. g Taux de croissance annuels moyens du PIB, de la productivité et de l’emploi en France
en %
1950-1974
1975-1989
1990-2007
2008-2014
PIB (Y)
5,3
2,4
1,9
0,3
Productivité par tête (Y/N)
4,8
2,2
1,1
0,3
Emploi (N)
0,5
0,2
0,9
0,0
Doc. h Politiques de stimulation de la demande de travail
1795-1834 : Speenhamland Act.
Mars-juin 1848 : expérience des Ateliers Nationaux à Paris.
1935-1943 : Work Progress Administration aux Etats-Unis
1936 : Durée réglementaire du travail hebdomadaire à 40h
en France
1938 : le Fair Labor Standars Act instaure un salaire
minimum et plafonne la durée réglementaire du travail à
44h au x Etats-Unis
1981 : Durée du travail hebdomadaire à 39h en France
1982 : désindexation des salaires
1984 : Travaux d’Utilité Collective.
Depuis 1993 : allègement de cotisations sociales
1997-2002 : emplois-jeunes
1998-2000 : lois Aubry I et Aubry II fixant à 35h par semaine
la durée réglementaire du travail
2003 : Loi Fillon assouplissant les lois Aubry
2012 : Emplois d’avenir et contrats de génération
2013 : Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi
(C.I.C.E.) 2014 : pacte de responsabilité
2016 : Prime à l'embauche pour les P.M.E.

Le chômage
doc. i Demandeurs d’emploi et naissances
Michel AGLIETTA, Didier BLANCHET &
François HERAN,
« Démographie et économie », Rapport du
C.A.E., 2002
http://www.cae.gouv.fr/Demographie-et-
economie.html
Doc. j Impact théorique de l’immigration sur le marché du travail en équilibre partiel
w/p
LS avant immigration
LS après immigration
(w/p)I
(w/p)F
LD
L’F LI LF L
L’immigration déplace LS vers la droite.
L’emploi d’équilibre augmente de LI à LF, le salaire d’équilibre
diminue de (w/p)I à (w/p)F.
L’emploi des travailleurs présents avant l’immigration diminue
de LI à L’F.
L’emploi immigré correspond à LF-L’F.
L’aire colorée correspond à l’augmentation du profit des
employeurs. D’après M. BURDA & C. WYPLOSZ,
Macroéconomie, une perspective européenne, 2014
Doc. k Les politiques de l’offre de travail :
des politiques malthusiennes…
… à l’activation des dépenses passives
1974 : interruption de l’immigration de travail
1977 : aide au retour
1979 : programme de préretraites dans la métallurgie
1985 : congé parental (Allocation Parentale d’Education
A.P.E.) pour les parents de 3 enfants ou plus qui interrompent
leur activité.
1994 : extension du congé parental rémunéré dès le 2ème enfant.
2001 : la Prime Pour l’Emploi (P.P.E.) instaure un crédit
d’impôt pour les salariés
2001 : Plan d’Aide au Retour à l’Emploi (P.A.R.E.)
2009 : Revenu de Solidarité Active (R.S.A.)
2016 : la prime d'activité Fusionne la P.P.E. et le R.S.A.
2016 : proposition de loi visant à faire disparaître le chômage
de longue durée
Doc. l : Taux de chômage courant et NAIRU en France en % de la population active
Taux de chômage courant
NAIRU
Données O.C.D.E.

Le chômage
Doc. m Le modèle d’appariement
v (taux d’emplois vacants)
VS (job vacancies supply)
(offre d’emplois vacants)
v*
UV (courbe de Beveridge)
u* u (taux de chômage)
Forme de VS : lorsque le taux de chômage augmente, les
salaires réels tendent à être plus faibles et les emplois vacants
trouvent plus facilement preneurs, ce qui peut inciter les
entreprises à accroître l’offre d’emplois vacants.
Position de VS : dépend de chocs macroéconomiques.
Forme de la courbe de Beveridge : moins les entreprises offrent
d’emploi, plus le chômage est important.
Position de la courbe de Beveridge : sa proximité par rapport
aux axes est une indication de l’efficacité de l’appariement
D’après William BEVERIDGE,
Full Employment in a Free Society, 1945
Dale T. MORTENSEN & Chrisotpher A. PISSARIDES,
"Job Creation and Job Destruction in the Theory of
Unemployment", Review of Economic Studies, 1994)
Doc. n La courbe de Beveridge dans la zone Euro
Part des employeurs déclarant rencontrer des pénuries de main
d'oeuvre
Lecture : au 2ème trimestre
2014 (14Q2), le taux de
chômage dans la zone € s'élève
à 11,5%. Environ 5% des
employeurs déclaraient
rencontrer une pénurie de main
d'oeuvre.
Sources : Eurostat,
Commission Européenne
Boele BONTHUIS, Valerie
JARVIS, Juuso VANHALA,
« Shifts in euro area Beveridge
curves and their
determinants »,
Bank of Finland Research
Discussion Papers, 2015 , p.5
https://helda.helsinki.fi/bof/bitstre
am/handle/123456789/13552/BoF
_DP_1502.pdf
Taux de chômage en %
Doc. o Les politiques de flexibilité du marché du travail
1967 : A.N.P.E.
1986 : libéralisation du recours au C.D.D. et à l’intérim
1987-2007 : contribution Delalande
1998-2000 : lois Aubry I et Aubry II fixant à 35h par semaine la durée réglementaire du travail
2001 : Plan d’Aide au Retour à l’Emploi (P.A.R.E.)
2002 – 2006 : réformes Hartz en Allemagne : « mini-jobs » et « midi-jobs », fusion de l’assistance sociale et de l’assistance chômage
(Hartz IV), placement des chômeurs.
2003 : Loi Fillon assouplissant les lois Aubry
2005 : le placement est ouvert à la concurrence
2008 : Rupture conventionnelle du contrat de travail + C.D.D. sur objet défini. Fusion de l’A.N.P.E. et de l’assurance-
Pôle-emploi.
2013 : loi sur la sécurisation de l’emploi.
2016 : assouplissement du droit du travail ? / 500 000 formations pour les chômeurs de longue durée.
L’emploi temporaire (CDD + intérim) représente actuellement plus de 15% des salariés et 80% des embauches.

Le chômage
Doc. p les formes de la flexibilité du travail
interne
externe
quantitative
chômage partiel,
flexibilité salariale
CDD, intérim, mini-jobs,
rupture conventionnelle…
qualitative
Polyvalence
Sous-traitance
Doc. q Les inégalités face à l’emploi en 2013
Global
Femmes
Jeunes (15-24 ans)
Seniors
Nés à l'étranger
Taux de chômage
(chômeurs / pop. active)
France
10,3
10,2
24,8
-
16
Allemagne
5,2
4,9
7,8
-
8
Taux d’emploi
(actifs occupés / pop. totale)
France
69,6
65,6
44,5
45,6
Allemagne
77,3
72,5
58,1
63,6
Données Eurostat et O.C.D.E. en %
La stratégie de l’Europe pour l’emploi - Europe 2020 - donne pour objectif un taux d’emploi global fixé à 75%
Doc. r Le modèle WS/PS
w/p (salaire réel)
PS
(w/p)*
WS
u* u (taux de chômage)
Forme de PS (Price Setting) : les entreprises fixent le niveau des prix p en
fonction du salaire w, de sorte à dégager une marge bénéficiaire. Elles opèrent en
concurrence imparfaite. Une hausse du chômage les pousse à comprimer leur
marge et le prix, ce qui entraîne, toutes choses égales par ailleurs, une hausse du
salaire réel. Le salaire réel est donc une fonction croissante du chômage.
Position de PS : tout ce qui accroît les prix déplace PS vers la droite, par exemple
une hausse du prix du pétrole, des prélèvements obligatoires, une moindre
concurrence.
Forme de WS (Wage Setting) : les exigences salariales des salariés et de leurs
syndicats sont tempérées par le niveau du chômage : le salaire réel est donc une
fonction décroissante du taux de chômage.
Position de WS : tout ce qui accroît les exigences salariales déplace WS vers la
droite, par exemple une meilleure indemnisation du chômage, un pouvoir de
négociation des syndicats renforcés etc…
D’après R. LAYARD, S. NICKELL & P. JACKMAN Unemployment, Macroeconomic Performance and the Labour Market, 1991
Doc. s Le modèle danois de flexicurité
On peut parler de complémentarité
institutionnelle, puisque la fonction de
réallocation du travail n’est assurée qu’à
travers la conjonction de trois dispositifs – le
droit du travail, la couverture sociale et une
politique d’emploi active – régissant les
relations des trois acteurs : les entreprises, les
salariés et l’État. Les bénéfices de cette
configuration – plus grande réactivité et
croissance de la productivité – sont ensuite
partagés entre ces mêmes acteurs, selon leurs
propres objectifs : la survie et la profitabilité
des firmes grâce à la compétitivité, la sécurité
du revenu pour les salariés, la capacité de
prélèvements obligatoires pour l’État.
Robert BOYER,
La flexicurité danoise, quels enseignements
pour la France , 2006, p.19,
http://www.cepremap.ens.fr/depot/opus/OPUS
02.pdf
 6
6
 7
7
1
/
7
100%