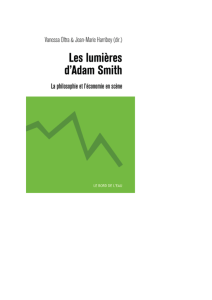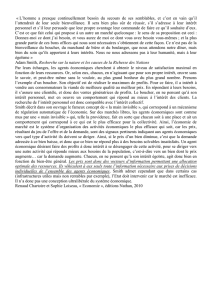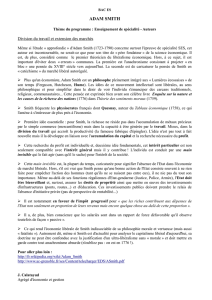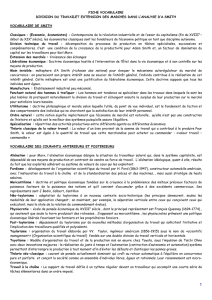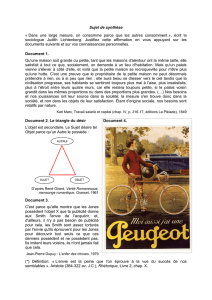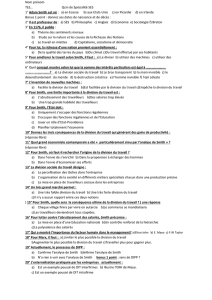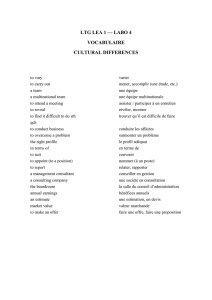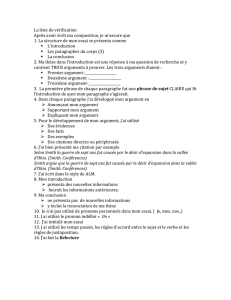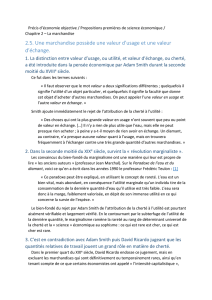Histoire analyse éco - 2eme année d`économie et de gestion

Histoire de l’analyse économique
Introduction générale 1
Section 1 : But du cours 1
A- Aspect chronologique. 1
B- Aspect transversal 1
Section 2 : Modalité du cours 2
Chapitre 1 : Adam Smith père de l’économie politique et du libéralisme ? 2
Section 1 : Thèmes traditionnels de l’économie politique d’Adam Smith. 2
A- La division du travail et l’échange à la base de la création de richesse. 2
1- Définition de l’économie. 2
2- La division du travail. 3
a- Définition de la division du travail. 3
b- Conséquences générales. 3
c- La dynamique endogène de la division du travail. 3
Section 2 : Théorie de la valeur et des prix. 3
A- Valeur d’usage, valeur d’échange. 4
B- Valeur travail et prix naturel. 4
C- Prix naturel et prix de marché. 4
Introduction générale
Section 1 : But du cours
Il s’agit de poursuivre le cours de première année d’histoire de la pensée économique avec un aspect
chronologique et un aspect transversal, théorique.
A- Aspect chronologique.
Comment la discipline économique s’est-elle formée ? Il s’agit de réinterroger les éléments
traditionnels, comme par exemple, comment la discipline d’est constituée comme discipline
autonome ? Comment l’économie s’est séparée de la sociologie, de la philosophie ? Au départ,
l’économie n’a pas été conçue comme une discipline autonome. Aujourd’hui, cette question est
réinterrogée de deux côtés, par des contestations ; la discipline serait devenue une matière modélisée,
mathématisée qui serait déconnectée des réalités de la société ; et par des extensions actuelles,
l’expansion de la microéconomie qui examine les questions d’égoïsme, d’altruisme, de morale. De
quelle manière s’est constituée la partition entre microéconomie et macroéconomie ? Comment y’a-t-il
eu remise en cause de cette partition ? Par exemple, les fondements microéconomiques de la
macroéconomie, ou les problèmes d’agrégation, les agents individuels prennent des décisions mais
l’interaction entre agents crée des phénomènes nouveaux non prévus par les agents.
B- Aspect transversal
L’aspect transversal est la définition du libéralisme. C’est une question actuelle et confuse. On peut
partir d’une définition initiale du libéralisme économique. Il y a théorie économique libérale quand
trois conditions sont respectées :
- L’individu et ses capacités décisionnelles (information, calcul) sont à la base de la théorie.
- On fait l’hypothèse de marché : il existe abstraitement ou réellement un mécanisme ou une
institution qui met en relation offre et demande et crée une homogénéité de l’économie en confrontant
les choix individuels autour d’une situation d’équilibre (équilibre partiel, équilibre global, équilibre
inter temporel, équilibre temporaire).
- Le rôle de l’Etat est limité sur le plan économique ou soumis à l’arbitrage du choix décisionnel des
agents individuels.
Cette première définition pose cependant une série de problèmes :

Exemple 1 : L’Etat peut intervenir de manière essentielle pour restaurer le mécanisme de marché. On
va trouver des cas où l’intervention de l’Etat sera extrêmement importante pour restaurer la politique
de marché (politique de la concurrence européenne et mondiale). N’y aurait-il pas contradiction ?
Exemple 2 : On peut admettre que les individus ont des capacités à faire des choix mais que
l’interaction entre les choix des divers agents implique une telle complexité que l’individu lui-même
ne peut concevoir l’effet global de ces interactions. Ainsi, on peut accepter l’hypothèse 1 tout en
avançant l’idée que le fonctionnement global de l’économie n’est pas le produit conscient des
individus. Il existerait donc un effet macroéconomique des actions microéconomiques (théorie de
l’ordre spontané).
Exemple 3 : Il existe de nombreuses exceptions à la possibilité pour l’agent individuel à établir un
ordre de préférence (et donc maximisation sous contrainte), externalités, biens collectifs. N’y a t il pas
là non plus contradiction ?
Exemple 4 : L’hypothèse d’égoïsme, d’intérêt individuel est elle une des bases de l’hypothèse des
capacités décisionnelles ou non ? C’est une question très controversée. Beaucoup de libéraux
aujourd’hui répondraient non. Ainsi, on essaiera de montrer d’une part que la définition du
libéralisme économique reste à éclaircir et d’autre par t que les pères du libéralisme, dont Adam Smith
ne sont pas ce que l’on croit.
Section 2 : Modalité du cours
On effectuera une analyse d’auteurs (Adam Smith, Walras, Keynes). Des textes seront distribués.
L’évaluation comptera plusieurs questions et durera 1h30.
Chapitre 1 : Adam Smith père de l’économie politique et du libéralisme ?
C’est le père de la discipline économique comme discipline autonome (rupture avec la morale et la
politique). C’est le père du libéralisme : recherche de l’intérêt personnel (ordre global) par le biais d’un
mécanisme de marché (main invisible). > Rôle de la concurrence.
Rappel :
Smith (1723-1790). En 1759, il écrivit la Théorie des Sentiments Moraux ; en 1776, la Richesse des
Nations ; Leçons de jurisprudence. Smith fait partie du mouvement des « Lumières Ecossaises » avec
notamment Hume.
Il s’agit de constituer une science de l’homme dont l’économie fait partie. A ce titre, il a eu des liens
directs avec toutes les Lumières européennes, Voltaire, Rousseau, Quesnay, Turgot. Smith a été
professeur de logique et de morale à l’université de Glasgow.
Section 1 : Thèmes traditionnels de l’économie politique d’Adam Smith.
On va définir en quoi Smith est considéré comme le père de l’économie politique et du libéralisme.
A- La division du travail et l’échange à la base de la création de richesse.
On le trouve dans trois des chapitres les plus lus de la Richesse des Nations.
1- Définition de l’économie.
On va trouver une définition de l’économie avec un objet propre, la science des richesses avec deux
problèmes, l’origine et la répartition. La richesse est l’ensemble des objets utiles aux individus
produits par le travail et consommés autour d’un cycle annuel. Cette richesse dépend du nombre de
travailleurs relativement à la taille de la population et de l’habileté de ces travailleurs. Elle dépend de
plus du capital employé que le nombre de travailleurs est capable d’utiliser. Fondamentalement, c’est
la productivité du travail qui explique la création de richesses à cause à la fois du nombre de

travailleurs et du capital utilisé. On trouve pour la première fois chez Smith un objet propre de
l’économie qui semble indépendant des questions de morale et de politique. Le travail et sa
productivité sont à la source des richesses et donc la richesse ne s’assimile plus à un ensemble
monétaire, à la différence des mercantilistes, indépendante d’une forme matérielle déterminée
(différents des physiocrates : produit agricole). Ce peut donc être des produits agricoles, des produits
manufacturés, des produits matériels ou des services.
2- La division du travail.
L’augmentation de la productivité du travail résulte de la division du travail.
a- Définition de la division du travail.
Pour décrire les effets de la division du travail, Smith prend l’exemple de la manufacture du travail
avec une division technique qui procure trois effets bénéfiques :
La division des tâches en opérations simples et répétitives conduit le travailleur à acquérir une plus
grande habileté et donc augmenter sa productivité.
La spécialisation sur une tâche permet d’économiser le temps généralement perdu pour passer d’une
opération à l’autre.
La simplification des tâches rend possible l’emploi de machines destinées à faciliter le travail et à
l’abréger.
Lorsque le travailleur est spécialisé, il a une plus grande connaissance de sa tâche et est plus capable
d’y introduire des innovations. Ces innovations se traduisent par la mécanisation avec substitution
par le travail machine du travail physique.
b- Conséquences générales.
Ces trois effets contribuent à augmenter la productivité du travail et donc sont une source de progrès
et d’enrichissement qui crée ce que Smith appelle une opulence générale qui se répand jusque dans les
dernières classes du peuple. La division du travail, dans la mesure où elle repose sur la maîtrise de
l’individu dans son travail réduit les inégalités comme jamais auparavant. En effet, la division du
travail suppose la liberté de se spécialiser et de vendre ou d’échanger le produit de son travail. Elle
suppose donc l’indépendance des agents économiques qui ne sont plus soumis à l’esclavage ou au
travail forcé. Le produit global de l’économie ou le surplus économique dépend de cette dynamique
de la division du travail. Ce sont les opportunités de la complexité de la division du travail avec
l’invention perpétuelle de nouvelles manières de produite et d’échanger qui crée la richesse. La
richesse n’est pas un don gratuit de la nature mais un processus de création lié à l’imagination
humaine.
c- La dynamique endogène de la division du travail.
Pour Smith, la seule limitation au développement de la division du travail est l’étendue du marché,
c’est-à-dire le volume de la demande. Si le marché est très petit, personne ne sera encouragé à
s’occuper entièrement à une seule occupation faute de pouvoir échanger tout le surplus du fruit de
son travail. La division du travail permet grâce aux gains de productivité qu’elle engendre
d’augmenter le volume de production pour un nombre de travailleurs donné. Or cette production à
plus grande échelle n’est rentable que si elle peut être écoulée sur le marché, que si d’autres agents
spécialisés dans d’autres tâches sont amenés à acheter les produits. Donc il faut du pouvoir d’achat
qui lui-même est fonction du revenu ; ce que Smith a vu, c’est que ce revenu est lui-même le résultat
en monnaie du volume de la production, et ce volume de production est gouverné par la division du
travail. Donc Smith indique finalement que la division du travail dépend dans une large mesure de la
division du travail elle-même et donc qu’il y a une dynamique endogène de création de richesse dans
les économies modernes. Smith donc conçoit l’économie comme un processus qui a tendance à s’auto
organiser. Au cœur de ce processus, il y a la division du travail et l’innovation. Le changement se
propage de lui-même dans les sociétés marchandes. Un accroissement de l’offre d’une partie
quelconque de l’économie a un effet stimulant sur la production du reste de l’économie. L’offre crée sa
propre demande. Cette thèse sera reprise et simplifiée par Say sous le nom de loi de Say ou loi des
débouchés.
Section 2 : Théorie de la valeur et des prix.

C’est vraiment un thème standard qui fait de Smith le père de l’économie et surtout de l’économie
politique classique (Smith, Ricardo, Say, Stuart Mill, …). Ensuite, la contestation socialiste a pris le pas
(Saint Simon, Marx, …), le courant marginaliste (Walras, Jevons, Menger) qui va être à l’origine de la
microéconomie. A la fin du XIXème siècle, l’Ecole Historique conteste un des aspects importants de
l’abstraction, qu’on ne peut concevoir que des lois en fonction des populations pour lesquelles elles
s’appliquent (institutionnalistes). Sa théorie de la valeur et des prix examine l’origine de la richesse et
la fonction des prix. La richesse est issue de la division du travail est automatiquement associée à
l’échange et l’échange va avoir lieu au travers des prix sur un marché. Cet échange est possible parce
que les marchandises échangées possèdent deux qualités : l’utilité (rapport aux besoins) et la seconde
est qu’elle permet l’acquisition d’autres marchandises. Sur cette base, Smith va distinguer la valeur
d’usage et la valeur d’échange de la marchandise.
A- Valeur d’usage, valeur d’échange.
La valeur d’usage définit l’utilité d’un objet. C’est une condition nécessaire pour qu’un bien soit
échangé mais elle ne permet pas à elle seule de mesurer la valeur d’échange de la marchandise. En
effet, certains biens qui ont une grande utilité s’échangent à de faibles prix. La valeur d’échange est la
faculté que donne la possession d’une marchandise d’acheter d’autres marchandises, pouvoir
d’acquisition d’une marchandise contre une autre. Pour Smith, la valeur d’échange est décisive
puisqu’elle va déterminer le prix naturel de la marchandise. La théorie de la valeur est l’explication
des règles fondamentales de l’échange marchand, pourquoi une marchandise s’échange contre une
autre. Pour répondre à cette question, il faut trouver un étalon commun et invariable mesurant la
valeur d’échange d’une marchandise. Cet étalon commun est le travail.
B- Valeur travail et prix naturel.
La mesure de la valeur des marchandises est le travail au sens où cette valeur est commandée par le
travail que la marchandise permet d’acheter. La théorie de Smith est la théorie de la valeur travail
commandée (qu’on oppose à la valeur travail incorporée). Smith avance que ce n’est pas la quantité de
travail incorporée dans la marchandise qui explique sa valeur mais c’est le rapport entre la quantité de
travail incorporée dans une marchandise et celle qui est incorporée dans une autre marchandise.
Si pour produire le bien A, il faut 5 heures de travail.
Si pour produire le bien B, il faut 10 heures de travail.
Smith dit qu’avec cinq heures de travail incorporée dans le bien A, on peut commander une demi
unité du bien B.
Si pour produire le bien B, il faut maintenant cinq heures de travail, on peut commander alors une
unité du bien B avec le bien A. Ce qui varie, c’est la valeur de la marchandise et non la valeur du
travail.
La valeur d’échange s’exprime en quantité de travail qui forme donc son prix réel. La monnaie ne
constitue pas un étalon invariable. Elle ne peut que traduire en signes monétaires le prix réel lié à la
quantité de travail. La valeur d’échange est une mesure objective indépendante de l’appréciation
individuelle de l’agent économique. C’est le travail et sa quantité objectivement mesurable qui fondent
l’échange et finalement le prix. Donc, le prix naturel n’est pas un prix de marché mais c’est un prix qui
est seulement l’expression monétaire de la valeur d’échange travail. La valeur d’échange ne concerne
que les objets reproductibles par le travail. Pour les objets non reproductibles, air, eau, œuvre d’art, la
théorie de la valeur travail ne s’applique pas et c’est la rareté qui déterminer la valeur d’échange.
C- Prix naturel et prix de marché.
Le prix naturel est le prix issu de la valeur travail. C’est donc ce que coûte réellement la marchandise à
celui qui l’apporte sur le marché. Ce prix se détermine donc à l’intérieur de la sphère de la production
et il est donc indépendant du niveau de la demande. C’est un prix d’offre ou de production.
Cependant, Smith indique qu’il n’y a aucune raison pour que le prix naturel soit celui auquel la
marchandise se vend sur le marché. En effet, la détermination du prix sur le marché suit une logique
différente du prix naturel. Ce prix de marché est déterminé par une logique d’offre et de demande. La
notion de demande chez Smith exprime la demande effective, celle qui vient des consommateurs qui
ont un revenu suffisant pour amener les producteurs à vendre leurs marchandises. Les pauvres sont
exclus de l’expression de la demande. C’est la demande sauvage. A partir de cette demande effective,
un prix de marché va se former. Le mécanisme est le suivant. Lorsque le volume de production (offre)

est égal à la demande effective, le prix de marché est égal au prix naturel. Mais lorsque la demande
effective ne coïncide pas avec l’offre, le prix de marché est en décalage avec le prix naturel afin que le
marché absorbe la totalité de l’offre.
Si la demande effective est supérieure à l’offre, la pression de la demande va tendre à faire augmenter
le prix de marché par rapport au prix naturel et inversement.
Dans cette approche, le prix de marché se détermine toujours par rapport au prix naturel qui est une
sorte de point fixe autour duquel gravite le prix de marché. C’est la théorie de la gravitation. Cette
gravitation est expliquée par le mécanisme suivant : les décalages constatés entre prix naturels et prix
de marché vont inciter à la période suivante à une réaffectation des moyens de production : par
exemple, si à la période t, le prix de marché est en dessous du prix naturel, les producteurs à la
période t+1 ne seront pas en mesure de renouveler leur niveau de production. Ils vont donc transférer
une partie de leurs capitaux, de leur terre, de leur travail vers d’autres branches de l’industrie pour
lesquels le niveau de marché est au moins équivalent au prix naturel. Ce que Smith utilise pour
expliquer la gravitation du prix de marché autour du prix naturel est un mécanisme de concurrence.
Ce mécanisme de concurrence a très vite été invoqué pour faire de Smith le père du libéralisme
économique. Le mécanisme de concurrence permet d’éviter les déséquilibres économiques et pousse
l’économie vers une situation naturelle d’équilibre PM = PN. Cette interprétation est très discutable
pour deux raisons :
- La concurrence chez Smith est une donnée secondaire. La donnée fondamentale est la valeur travail
et le prix naturel. Fondamentalement, ce n’est pas la concurrence et le marché qui créent le prix, mais
c’est la quantité de travail commandée. On est donc très loin d’une approche microéconomique qui
explique la fondation du prix par un jeu concurrentiel sur le marché.
- La concurrence présentée par Smith n’est pas une concurrence entre tous les agents économiques sur
un marché. C’est seulement une concurrence des producteurs. Il faut donc distinguer concurrence et
marché. Toute concurrence n’est pas concurrence de marché et donc le thème libéral de la concurrence
devient confus.
Contrairement à ce qu’on pense, l’hypothèse égoïste n’est pas retenue par Smith. On va trouver un
appareillage subtil :
- Passions. Les individus agissent selon des motifs divers.
- Sympathie.
- Spectateur impartial.
Sur les passions, Smith distingue trois types de passions principales, sociales (bienveillance), égoïstes
(amour de soi), asociales (ressentiment, soif de vengeance).
Il y a un opérateur qui s’appelle la sympathie, déjà présent chez Hume. Ce n’est pas une passion mais
un processus qui va diffuser les effets des passions. L’agent individuel est capable de se mettre à la
place de l’autre. Il ressent ce que l’autre ressent. Ce que je ressens est relatif à une situation (situation
de pauvreté). La sympathie ne naît pas tant de la vue de la passion que de celle de la situation qui
l’excite. C’est plus subtil var je peux réagir même si l’autre ne réagit pas ou même s’il est absent. Je
peux me représenter des situations extérieures dans ma tête.
On passe ensuite au spectateur impartial. Quand l’opérateur de sympathie s’exerce, je me mets à la
place de l’acteur dans une situation donnée mais je ne suis jamais l’acteur. Il y a donc toujours une
dualité à l’intérieur de moi entre l’acteur et le spectateur. Cette dualité permet au jugement impartial
de se constituer à l’intérieur de moi-même. Il y a en quelque sorte deux rôles à l’intérieur d’une même
personne et cette personne va donc pouvoir juger de la justesse du rapport entre la passion et ce qui la
cause. Sur cette base, l’opérateur de sympathie fait apparaître une sorte de spectateur impartial en
chacun de nous qui va permettre la constitution de régularités de jugement dans les comportements.
On pourra définir alors à partir d’une sorte de point de convenance quelles sont les passions
vertueuses, justifiées, et celles qui sont nocives, et à quel degré. Le spectateur impartial est un
 6
6
 7
7
1
/
7
100%