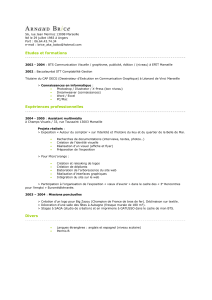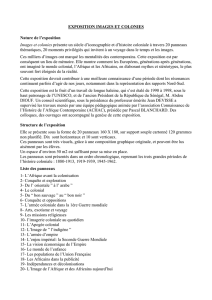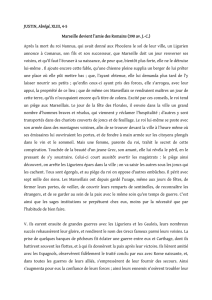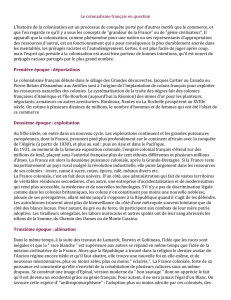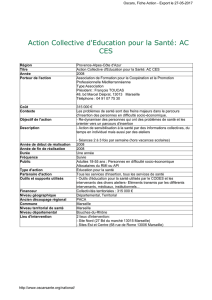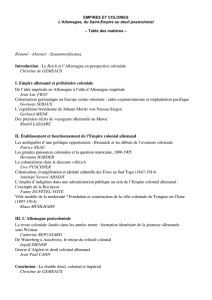Conclusion - L`esprit économique impérial

Le patronat marseillais face à la politique de la préférence impériale
(1931-1939)
Xavier Daumalin (UMR TELEMME-Université de Provence)
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les élus et les milieux économiques
marseillais réaffirment avec force la vocation coloniale du port de Marseille.
Reprenant le projet d’exposition initialement prévu pour 1916, ils confient à l’un
d’entre eux, Adrien Artaud, le soin de mener à bien l’opération. Député des Bouches-
du-Rhône, ancien président de la Société pour la défense du commerce et de
l’industrie de Marseille (1902-1904), président en exercice de la Chambre de
commerce depuis 1913, très impliqué dans les échanges coloniaux avec sa société de
négoce en vins et sa participation aux conseils d’administrations de plusieurs maisons
de commerce, Artaud réussit bien au-delà de ce qu’espéraient les promoteurs de
l’opération : plus de 3 millions de visiteurs se pressent à l’exposition coloniale pour
découvrir les représentations exotiques des colonies françaises, leurs produits et les
productions des industriels marseillais obtenues grâce aux matières premières
coloniales. Dans la foulée de ce succès, Artaud organise une grande conférence sur les
perspectives de la politique économique coloniale de la France et déclare : « Il faut
savoir nous faire pardonner l’acquisition d’un domaine colonial magnifique, et nous
faire pardonner par les colonies de les avoir conquises. Comme ce n’est pas elles qui
nous ont demandé de faire cette conquête, le seul moyen de légitimer notre
intervention est de leur assurer plus de prospérité qu’elles n’en auraient eu si nous
n’étions pas allés chez elles. »
1
Favorable aux nombreux investissements prévus par le
projet de loi Sarraut toujours en discussion au sein de la Commission coloniale du
Parlement, il ajoute : « La colonisation paie et nous avons donc le plus grand intérêt
à faire pour les colonies ce qui doit être fait »
2
: plus que jamais, Marseille se
revendique comme la métropole coloniale de la France.
Douze ans plus tard, la tonalité n’est plus tout à fait la même. En 1934, Édouard
Rastoin, descendant d’une famille d’huiliers marseillais très en vue – son père, Émile
Rastoin, a été successivement président des deux grandes instances patronales
locales
3
–, se montre nettement moins optimiste. Dans un rapport consacré à
l’évolution du commerce franco-colonial – document publié avec l’aval de la Société
pour la défense du commerce et de l’industrie de Marseille –, il s’interroge
ouvertement sur le bien fondé de la politique coloniale française : « Parce que nous
payons un tiers en trop, soit de 800 à 900 millions de plus par an, les ventes que
nous font nos colonies, parce que le tonnage des objets qu’elles nous achètent reste
stationnaire depuis de nombreuses années, certains pourraient être tentés de
s’écrier – ils ont eu dans l’histoire de nombreux devanciers : « Abandonnons donc
des colonies qui nous rapportent si peu et nous coûtent si cher. »
4
Une dizaine
d’années après l’unanimisme affiché lors de l’exposition coloniale de 1922, l’évolution
est de taille. Autrefois favorables à la colonisation, certains entrepreneurs marseillais
1
Adrien Artaud, « La politique économique coloniale », Compte rendu des travaux de la
Société pour la défense du commerce et de l’industrie de Marseille, 1923, annexe XXIV, p.
280.
2
Idem, p. 288.
3
Émile Rastoin a été président de la Société pour la défense du commerce et de l’industrie de
Marseille (1909-1910) et de la Chambre de commerce de Marseille (1924-1927).
4
Édouard Rastoin, « Le commerce franco-colonial », Compte-rendu des travaux de la
Société pour la défense du commerce et de l’industrie de Marseille, 1934, annexe IV, p. 48.

2
en sont désormais venus à douter de l’utilité des colonies et à suggérer qu’elles
constituent un handicap pour l’économie nationale. Comment en est-on arrivé à un
tel désenchantement ? C’est l’objet de cette communication, un sujet qui sera abordé
non pas dans sa globalité mais à travers l’exemple particulier des échanges entre
Marseille et l’Ouest africain.
1. L’empire, seulement un marché d’appoint pour les Marseillais
Que représentent, à la veille de la récession des années 1930, les échanges entre
Marseille et l’Ouest africain ? En volume, cela constitue un commerce de 271 000
tonnes dont les trois-quarts sont réalisés avec la seule AOF : 167 000 tonnes, pour les
importations ; 104 000 tonnes pour les exportations. Les oléagineux – arachides,
palmistes et huile de palme – représentent 87 % du total des importations
5
: comme
au XIXe siècle, le marché ouest-africain demeure avant tout une source
d’approvisionnement en matières grasses pour les besoins des huileries, des
savonneries et des stéarineries marseillaises, un complexe industriel rassemblant
près de 70 usines et employant 10 000 personnes
6
. La production de cet ensemble
s’élève alors à 270 000 tonnes d’huiles de graines, 178 000 tonnes de savons, 55 000
tonnes de graisses végétales et une quarantaine de millions de paquets de bougies.
Les principales unités de production sont alors celles des sociétés Rocca, Tassy & de
Roux, Verminck, Fournier, Ferrier, Régis, Magnan, Darier de Rouffio, l’Huilerie
nouvelle (famille Rastoin) etc. L’importance du marché ouest-africain est cependant
relative : en 1929, il ne représente que 22 % du total des approvisionnements des
huileries marseillaises, ce qui le situe au troisième rang seulement derrière l’Inde
(37 %) et les îles indonésiennes (27 %). Pour le complexe oléagineux marseillais,
l’Ouest africain n’est finalement qu’un marché d’appoint. Autre caractéristique de ces
échanges, ils s’effectuent dans un cadre douanier relativement libéral contrairement à
d’autres domaines coloniaux comme l’Algérie, l’Indochine ou Madagascar. La loi de
1892, confirmée en 1910, a en effet classé l’AOF dans la catégorie des colonies non
assimilées au tarif douanier métropolitain, tout en garantissant la libre entrée de ses
oléagineux sur le territoire national. Par ailleurs, la convention franco-anglaise du
Niger, signée le 14 juin 1898, assure aux deux puissances coloniales une réciprocité
commerciale en Côte d’Ivoire, en Gold Coast, au Dahomey et au Nigeria. Ces marchés
coloniaux sont donc relativement ouverts à la concurrence.
Deux maisons de commerce dominent ces échanges : la CFAO (Compagnie française
de l’Afrique occidentale) et la CICA (Société commerciale et industrielle de la Côte
d’Afrique). Avec 74 millions de capitaux propres, un chiffre d’affaires de 142 millions
de francs, un bénéfice net de 21,1 millions de francs et une action donnant un rapport
de 36 %, la CFAO est en 1928 la plus importante de toutes les sociétés françaises
installées dans l’Ouest africain, bien loin devant la SCOA, sa principale rivale
7
; elle
possède des comptoirs dans presque toutes les colonies de la Côte occidentale et
transporte elle-même une partie de ses oléagineux. Depuis 1919, elle vend la quasi-
5
Sauf indication contraire, tous les chiffres cités sont issus de : Xavier Daumalin, Marseille et
l’Ouest africain. L’outre-mer des industriels (1841-1956), Marseille, Chambre de commerce
et d’industrie de Marseille-Provence, 1992.
6
Gaston Rambert, Marseille. La formation d’une grande cité moderne. Etude de géographie
urbaine, Marseille, Éditions Maupetit, 1934, p. 493.
7
Hubert Bonin, CFAO, Cent ans de compétition (1887-1987), Paris, Économica, 1987. Xavier
Daumalin, Marseille et l’Ouest africain, op.cit.

3
totalité de ses achats d’arachides à l’une des plus modernes huilerie-savonnerie de
Marseille, gérée par Paul Cyprien-Fabre, les nouveaux Établissements Verminck. La
CICA est une entreprise beaucoup plus modeste ; fondée en 1917 sur les décombres de
l’ancienne maison Armandon & Cie (1905-1916), elle est dirigée par l’armateur Jean
Fraissinet ; ses comptoirs sont implantés au Dahomey, en Côte d’Ivoire et au Togo ;
avec 16,7 millions de francs de capitaux propres, l’entreprise réalise un chiffre
d’affaires de plus de 20 millions de francs, dégage un bénéfice net de 1,5 million et
son action donne un taux de rentabilité de 7 %. Elle est contrôlée par l’armateur
Fraissinet et l’industriel Paul Fournier : le premier assure le transport des oléagineux
jusqu’à Marseille, tandis que le second fabrique des bougies et des savons avec les
cargaisons de palmistes et d’huile de palme achetées par les agents de la CICA.
Ces maisons de commerce ont en commun d’être très liées aux milieux bancaires
internationaux. Pour financer ses achats de produits et de marchandises, la seule
CICA, société relativement modeste, possède des lignes de crédit dans près de dix
banques différentes : la Société marseillaise de crédit, la Société générale, le Crédit
lyonnais, la Banque de France, la Manchester & Liverpool District Banking Corp., la
Bank of British West Africa, la Banque de l’Afrique occidentale, la Dredsner Bank et
Monneron & Guye
8
. Certaines de ces banques accordent leur caution sans pouvoir
exercer le moindre contrôle sur l’utilisation des fonds ainsi débloqués : « Les crédits
de campagne se réalisent au Sénégal par l’escompte de traites qui expriment
généralement des échéances de 90 à 120 jours. Les agents des factoreries émettent
ces tirages sur le siège social ou administratif de leur firme [...]. Pour permettre la
négociation de ce papier et fournir la seconde signature qu’exigent les statuts de la
Banque d’Afrique occidentale, des banques françaises ou étrangères l’avalisent par
lettre séparée. L’obtention d’un crédit de campagne reste donc subordonnée à la
caution préalable de banques françaises ou étrangères dont la plupart ne possèdent
actuellement en Afrique aucun organisme de représentation ou de contrôle [...]. Ce
système ne permet pas la surveillance directe des crédits mis à la disposition du
négoce. »
9
Ces pratiques dangereuses sont aggravées par le fait que ces mêmes
maisons de commerce se livrent une concurrence permanente pour placer des crédits
de campagnes auprès des intermédiaires qui acheminent les récoltes d’arachides
depuis les lieux de production jusqu'à leurs comptoirs. Afin d’obtenir les plus gros
tonnages possibles d’oléagineux, elles avancent des sommes considérables qui ne
sont pas toujours remboursées à l’issue des récoltes et qui se traduisent, le plus
souvent, par des reports d’échéances sur la campagne à venir. En somme, depuis les
grandes banques européennes jusqu’aux producteurs africains, ces échanges
coloniaux reposent sur une cascade de crédits et sur des comportements très
spéculatifs.
2. L’économie ouest-africaine sinistrée par la récession des années 1930
C’est dans ce contexte qu’éclate la crise de 1929 ; l'onde de choc du krach boursier est
considérable : il faut insister sur la rapidité avec laquelle les effets du krach atteignent
8
Xavier Daumalin, « Marseille, l’Ouest africain et la crise de 1929. De l’économie de traite à
l’économie dirigée », in Marcel Courdurié & Jean-Louis Miège (dir.), Marseille colonial face
à la crise de 1929, Marseille, Chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence,
1991, pp. 167-244.
9
Archives nationales SOM, Institut colonial français, interventions d’Edmond Giscard
d’Estaing, séances des 8 et 19 novembre 1932.

4
le secteur des oléagineux et les échanges entre Marseille et l'Ouest africain. Dans ce
marché déjà très internationalisé où les banques jouent un rôle important, le
retournement de la conjoncture est précoce. Dès la fin du mois d'octobre 1929, la
baisse du cours des matières grasses est générale sur la place de Marseille ; entre
1929 et 1930, les arachides en coques de Rufisque et les palmistes du Dahomey
passent respectivement de 184 à 124 francs et de 221 à 169 francs le quintal ; et la
chute des cours se poursuit sans discontinuer jusqu'en 1934, quand les arachides et
les palmistes ne valent plus que 69 et 57 francs le quintal : en francs constants, les
prix de 1934 sont les plus bas jamais enregistrés depuis 1894 ! Pour autant, l’huilerie
marseillaise profite peu de cette baisse des cours dans la mesure où la diminution du
prix de vente de l’huile est à peu près aussi forte : 58 %, entre 1929 et 1934, contre 62
% pour les arachides.
En Afrique occidentale, la situation économique est plus grave. Dès juillet 1930, la
Banque française d'Afrique ferme ses guichets et cesse ses paiements, juste un mois
avant l'ouverture de la campagne d'arachides. ; trois mois plus tard, alors que la
récolte bat son plein, c'est au tour de la Banque commerciale africaine de subir le
même sort. Des rumeurs commencent même à circuler sur une éventuelle défaillance
de la principale banque de l'AOF, la Banque d'Afrique occidentale
10
. Le système de
crédit, poutre maîtresse et fragile de l'économie ouest africaine, est touché : « Les
embarras financier de la Banque française d’Afrique ont été, sinon la cause, du
moins le signal d’un brusque revirement dans la politique des banques qui jusque-là
prêtaient largement. À la veille du début de la traite on a assisté à une restriction
des crédits bancaires portant principalement sous la forme d’avances, connues sous
le nom de crédits de campagne. Ce resserrement brutal a entraîné un mouvement de
panique […]. Nous ne pouvons plus donner au producteur l’assurance qu’il vendra
ses récoltes à un prix qui paie son labeur […]. L’appât du gain, une des plus
puissants leviers de notre action colonisatrice, nous échappe. »
11
Les négociants sont
pris de court, la panique devient générale
12
. Sans ces crédits de campagne, seules les
maisons de commerce disposant de réserves financières suffisantes peuvent
continuer à acheter des marchandises ou des produits. Les autres maisons, c'est-à-
dire toutes celles qui depuis des années fondaient leur prospérité sur une course sans
fin entre la creusement de l’endettement et l’augmentation du chiffre d'affaires, sont
brusquement obligées de réduire leurs activités de façon drastique et de fermer
nombre de factoreries. Entre 1930 et 1931, le chiffre d'affaires de la CICA chute ainsi
de 50 % et la société accuse une perte de 5,6 millions de francs ; l'année suivante, le
déficit est encore de 5 millions ; après avoir un instant envisagé la liquidation de la
société, les administrateurs décident finalement d'envoyer l’un d’eux en Afrique pour
fermer les factoreries les moins rentables. L'exemple de la CICA n'est pas isolé : en
1931, la Nouvelle compagnie française de Kong dépose son bilan ; l'United Africa
Company annonce une perte de 1,2 million de livres (soit 140 millions de francs
environ), tandis que la SCOA affiche un déficit de 9,7 millions ; en 1932, c'est au tour
de Maurel frères et de Louis Vézia & Cie de subir des pertes tandis que la société
Assemat & Guiraud est mise en liquidation
13
. Certaines maisons sont contraintes de
10
Archives CFAO, 1930.
11
Archives nationales SOM, Union coloniale française, lettre de Jules Brévié au ministre des
Colonies, 16 janvier 1931.
12
Yves Meissadier, « La crise de l’arachide sénégalaise au début des années trente », Bulletin
de l’IFAN, n° 3-4, 1968, pp. 826-877.
13
Bulletin mensuel de l’Agence économique de l’AOF, 1930-1932.

5
réduire leurs fonds propres : en 1932, la SCOA diminue ainsi son capital social de 157 à
68 millions et les Etablissements Peyrissac de 50 à 25 millions de francs. À l'inverse,
la CFAO résiste mieux ; ses bénéfices diminuent bien de 60 % entre 1930 et 1931, mais
grâce à un mode de gestion prudent qui lui a permis de constituer d'importantes
réserves pendant que la plupart des autres entreprises s'endettaient, elle reste
bénéficiaire ; c'est même l’une des rares maisons à continuer à verser des dividendes
à ses actionnaires pendant toute la durée de la dépression.
La baisse des cours est néanmoins si importante et la restriction des affaires si sévère
que l'Afrique occidentale est bientôt plongée dans une des plus graves crises sociales
de son histoire. Certains producteurs africains, complètement ruinés, refusent de
continuer à cultiver des produits ne valant presque plus rien ; depuis des décennies
les Européens les avaient incités à délaisser les cultures vivrières au profit des
cultures d'exportation en leur faisant espérer des revenus plus importants ; pour
faciliter l’abandon des cultures vivrières, les négociants en étaient même venus à leur
vendre du riz indochinois bon marché importé via le port de Marseille. Or, en 1931, il
faut 500 kg d’arachides pour obtenir 100 kg de riz indochinois alors que le rapport
était de 1 pour 1, ou de 1 pour 2 seulement avant la crise ; de la même manière, en
1929, les paysans africains pouvaient acheter 35 kg de cotonnades pour la vente de
100 kg d'arachides ; le rapport n'est déjà plus que de 31/100 kg en 1931. L’enquête
réalisée au Sénégal en 1932 par l’huilier Émile Régis, achève de révéler aux
industriels marseillais l’ampleur de la crise sociale : « L’indigène souffre-t-il de cette
situation ? Sur ce point, les avis sont partagés. Selon les uns, c’est la famine, selon
les autres, l’abondance des cultures vivrières qui lui assurent une existence
suffisante. La vérité me paraît être que l’indigène souffre de cette crise, mais sa
misère est moins apparente qu’elle le serait dans un autre pays. Le prix normal
d’une journée de travail à Dakar ou à Kaolack est de 10 à 12 francs. Par suite de
l’abondance de l’offre, ce prix est tombé actuellement à 7 francs et même à 5 francs à
Kaolack. Le travailleur me paraît sous alimenté et, à l’intérieur, la misère de
certains foyers indigènes a été particulièrement marquée. »
14
Découragés par la détérioration des termes de l'échange et par la baisse de leur
pouvoir d'achat, les agriculteurs réduisent peu à peu les cultures destinées à
l'exportation : entre 1929 et 1932, les exportations d'arachides de l'Ouest africain
chutent ainsi de 620 000 à 428 000 tonnes. Sur ce total, Marseille n'en reçoit plus
que 109 000 tonnes. Le système colonial mis en place depuis le début du XIXe siècle
est complètement bloqué. Les tensions sociales s’exacerbent et, comme le redoute le
gouverneur général Brévié, elles risquent de déboucher à plus ou moins brève
échéance sur des revendications politiques remettant en cause la présence de la
France dans cette partie du monde : « Je ne saurais trop insister sur les
conséquences sociales et politiques éventuelles de la crise. L'attitude des indigènes,
jusqu'à présent, n'a pas varié. La propagande communiste qui s'est exercée depuis
quelques années n'a pas eu de prise sur la masse. Cette résistance se maintiendra-t-
elle devant l'amoindrissement du revenu de la production agricole ? Les colonies
anglaises traversent actuellement une période de tension critique. En Gold Coast, les
coopératives indigènes de vente du cacao se sont regroupées sous le nom de "Cocoa
Federation". Ce groupement organise des campagnes pour maintenir les cours du
cacao, reçoit l'appui des chefs indigènes et boycotte les maisons de commerce
lorsqu'elles refusent de payer le prix. Certes, les chefs indigènes nous sont dévoués,
14
Émile Régis, Situation économique du Sénégal en 1932, Marseille, 1932, pp. 9-10.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%