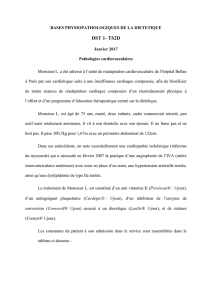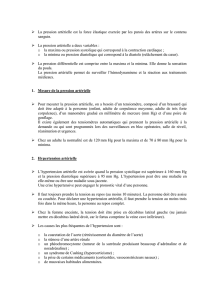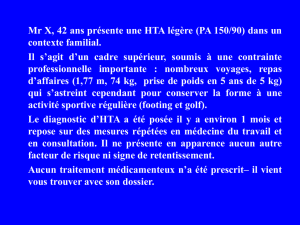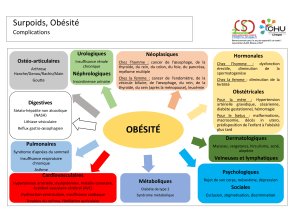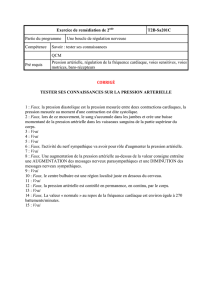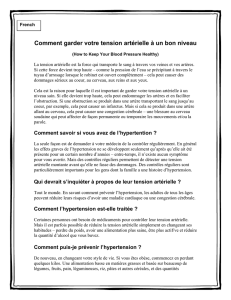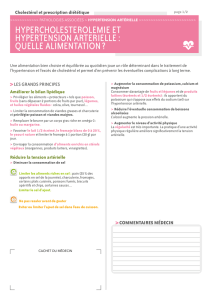Questionnaire

Au cœur de la vie
1
Mini-quiz
NOTE : pour fins de références, ce questionnaire a été bâti à partir de l’information publiée
dans le Journal canadien de cardiologie, volume 15 supplément G, édition de décembre 1999.
Les bonnes réponses sont indiquées en caractères gras et l’explication fournit la page de
références ainsi que des informations complémentaires. L’explication, qui ne doit pas
nécessairement apparaître sur les questionnaires, pourrait également vous permettre de
formuler d’autres questions.
Dans le cas où ces recommandations ont été modifiées, les dernières nouveautés sont
indiquées et la référence est Les recommandations canadiennes de 2001 sur
l’hypertension, qui viennent tout juste d’être publiées (janvier 2002).
Statistiques
1. Quelle proportion de la population québécoise présente au moins un des
facteurs de risque importants de maladies cardiovasculaires, soit tabagisme,
hypertension artérielle, hypercholestérolémie et sédentarité ?
40 % 68% 79%
Explication : tableau, p. 22G
79 % des Québécois présentent au moins un des facteurs de risque importants de MCV.
Les Enquêtes canadiennes de santé du coeur, identifient ainsi le pourcentage des
facteurs de risque dans la population âgée de 18 à 74 ans, entre 1986 et 1992 pour le
Québec :
Tabagisme : 32 %
Hypertension : 19 %
Hypercholestérolémie : 49 %
Sédentarité : 37 %
Autres facteurs de risque :
obésité : 28 %
et diabète : 5 %
2. Selon vous, quel facteur de risque de MCV est le plus présent dans la
population québécoise de 18 à 74 ans ?
tabagisme hypertension hypercholestérolémie
sédentarité
Explication : voir texte plus haut

Au cœur de la vie
2
3. Les maladies cardiovasculaires constituent la principale cause de mortalité au
Canada, responsables de plus de :
un décès sur trois la moitié des décès dix décès sur cent
Explication p. 7G
Les MCV constituent la principale cause de mortalité au Canada, entraînant plus de un
décès sur trois. En outre, elles sont source d’une forte morbidité et imposent un lourd
tribut socioéconomique aux individus et à la société. Par contre, les MCV sont en grande
partie des maladies évitables par la modification des principaux facteurs de risque.
4. Quel est le pourcentage de Canadiens et Canadiennes atteints d’hypertension
qui ne connaissent pas leur état ?
35 % 50 % 60 %
Explication : p. 57G
Les Canadian Heart Health Surveys révèlent qu’environ la moitié seulement des
Canadiens et Canadiennes atteints d’hypertension connaissent leur état et que la
tension artérielle est stabilisée chez seulement 16% d’entre eux.
5. Quelle est la principale cause de mortalité chez les femmes canadiennes ?
cancer du sein cancer du poumon maladie cardiovasculaire
Explication p. 32G
Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité chez les
Canadiennes, constituant 39% du nombre total de décès chez les femmes. Il semble
que les femmes soient à l’abri des complications de l’athérosclérose jusqu’à la
ménopause, période où l’on observe une augmentation de l’incidence des événements
cardiovasculaires. Mais les Canadiennes ne considèrent pas les MCV comme un sujet
de préoccupation important pour leur santé. Elles croient plutôt que le cancer, et surtout
le cancer du sein, constitue davantage une menace.
Diagnostic d’hypertension
6. Un client devrait être considéré comme hypertendu si sa tension artérielle est
égale ou supérieure à :
130 / 85 140 / 90 140 / 85
Explication : Aux États-Unis et au Royaume–Uni, les lignes directrices pour le
traitement de l’hypertension proposent une valeur de 140 / 85. Au Canada, la valeur de
140 / 90 a été retenue lors des plus récents travaux de la Société canadienne
d’hypertension artérielle et de ses neuf partenaires, soit la Coalition canadienne pour la
prévention et le contrôle de l’hypertension, la Société canadienne de cardiologie,
l’Association canadienne du diabète, l’Association des infirmières et infirmiers du
Canada, la Société canadienne de néphrologie, la Canadian Stroke Society, le Collège
des médecins de famille du Canada, Santé Canada et la Fondation des maladies du
cœur du Canada (1999). Cette valeur constitue donc la norme canadienne.

Au cœur de la vie
3
7. Si, à sa première visite, la tension artérielle d’un patient varie entre 140/90 et
180/105, combien doit-on prévoir de visites pour poser un diagnostic
d’hypertension ?
une visite toutes les deux semaines pendant trois mois
une visite aux 6 mois
au moins 4 visites, échelonnées sur les 6 prochains mois
Explication p. 59G
Si, à la première visite, la tension artérielle varie entre 140/90 et 180/105, il faudrait
prévoir au moins quatre autres rendez-vous, échelonné sur les six prochains mois pour
poser un diagnostic d’hypertension. Si, à la dernière visite diagnostique, la tension
artérielle est inférieure à 140/90 et si le patient ne présente pas de lésions dans des
organes cibles ni des facteurs de risque associés, il devrait être évalué une fois par
année seulement. Ce type de patient connaît un faible risque de MCV et ne devrait pas
être considéré comme hypertendu.
8. Une « urgence » en hypertension, demandant une référence immédiate à
l’hôpital est nécessaire lorsque la pression diastolique est de :
110 120 130
9. POUR BIEN MESURER LA TENSION ARTÉRIELLE…
le bord inférieur du brassard doit se situer à combien de centimètres au-
dessus du pli du coude ?
2 cm 3 cm 4 cm
avant la mesure de la tension artérielle, le patient doit être assis calmement,
le dos appuyé, les jambes non croisées, depuis ?
1 minute 3 minutes 5 minutes
le pli du coude du patient doit se trouver à la hauteur :
du cœur du début de la hanche
au cours de la même visite, la pression devrait être remesurée en position ?
debout assise couchée
après :
1 minute d’attente 2 minutes d’attente 5 minutes d’attente
avec un manomètre à mercure, il faut noter la tension artérielle à combien de
mm Hg près ?
1 mm Hg 2 mm Hg
et avec un appareil électronique, la tension artérielle est notée à environ :

Au cœur de la vie
4
1 mm Hg 2 mm Hg
idéalement, il faudrait prendre la tension artérielle au moins une fois :
aux 2 bras debout et assis à la jambe
la mesure de la tension artérielle en position assise sert à :
déterminer et surveiller le traitement
déterminer la présence d’hypotension orthostatique
Explications : p.59G
La technique recommandée pour la mesure de la tension artérielle y est décrite en
détail.
Les recommandations canadiennes de 2001 sur l’hypertension, qui viennent tout
juste d’être publiées (janvier 2002) précisent qu’ « on associe un pronostic normal
aux tensions diurnes inférieures à 135/85 mm Hg lorsque mesurées par automesure
ou par mesure ambulatoire. » ( p. 5)
10. Une tension artérielle égale ou supérieure à 135 / 83 mesurée à domicile est
considérée comme :
normale élevée
Explication p. 60G
Des valeurs de tension artérielles égales ou supérieures à 135/83 mesurées à domicile,
devraient être considérées comme élevées.
11. Cochez les examens usuels de laboratoire requis pour l’investigation de
l’hypertension.
Analyse des urines
Hémogramme
Bilan biochimique ( potassium, sodium, créatinine)
Glycémie à jeun
Cholestérol total, HDL, LDL et triglycérides
Électrocardiogramme à 12 dérivations
Échographie
Explication p. 59G et p.60G
Les examens listés en caractères gras sont les examens recommandés pour l’investiga-
tion de l’hypertension, à l’exception de l’échographie, qui n’est pas recommandée
systématiquement, mais plus spécifiquement chez les patients hypertendus que l’on
croit atteints d’un dysfonctionnement ventriculaire gauche ou d’une coronaropathie.

Au cœur de la vie
5
12. Un surplus 10 kg de la masse corporelle se traduit, en moyenne, par une
augmentation de :
la tension artérielle systolique de :
3 mm Hg 4 mm Hg 5 mm Hg
et de la tension artérielle diastolique de :
2 mm Hg 3 mm Hg 4 mm Hg
Explication : p. 70G
L’obésité entraîne une augmentation de la masse cardiaque et du volume sanguin.
Le débit systolique et le débit cardiaque augmentent de façon quasi proportionnelle
au surplus de poids. Un surplus de 10 kg de la masse corporelle se traduit en
moyenne, par une augmentation de 5 mm Hg de la tension artérielle systolique et de
3 mm Hg de la tension artérielle diastolique. On estime qu’une augmentation de la
tension artérielle de cet ordre entraîne une augmentation du risque de MCV
d’environ 15 %.
Les recommandations canadiennes de 2001 sur l’hypertension, qui viennent tout
juste d’être publiées (janvier 2002) précisent que pour réduire la tension artérielle,
des modifications au style de vie telles la perte de poids (d’au moins 4,5 kg) pour les
personnes ayant un surplus de poids, l’activité physique pratiquée régulièrement (au
rythme optimal de 45 à 60 minutes d’activité modérée (marche rapide) 4 à 5 fois par
semaine) et une consommation d’alcool à faible risque (0 à 2 consommations par
jour, moins de 14 consommations par semaine pour les hommes et moins de 9
consommations par semaine pour les femmes. Ces mesures, associés à un régime
alimentaire conforme au Guide alimentaire canadien – régime faible en gras saturés
et comportant beaucoup de fruits et légumes frais et de produits laitiers faibles en
gras – et à une limitation du sel et des aliments contenant trop de sel ajouté,
permettront d’abaisser la tension artérielle (p.7).
13. Chez les sujets présentant une hypertension limite, l’activité physique régulière
est associée à une diminution moyenne des tensions systolique et diastolique
de :
4 mm Hg 6 mm Hg 8 mm Hg
Explication : p. 90G
De nombreuses études épidémiologiques ont constaté une relation inverse entre
l’activité physique habituelle et la tension artérielle au repos. Il a été démontré dans des
expérimentations que l’activité physique régulière pouvait abaisser les tensions
systolique et diastolique d’environ 10 mm Hg chez les sujets faisant de l’hypertension
essentielle. L’activité physique régulière est associée à une diminution moyenne des
tensions systolique et diastolique de 3 mm Hg chez les sujets normotendus et de
6 mm Hg environ chez les sujets présentant une hypertension limite. Les données
semblent indiquer que la pratique régulière d’exercices modérés est suffisante pour
produire ces effets. Les personnes inactives physiquement ou en mauvaise forme
physique ont de 30 à 52 % plus de risques de présenter de l’hypertension au fil des ans
que les hommes et les femmes qui sont plus actifs ou plus en forme.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%