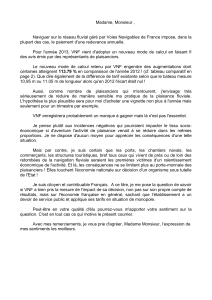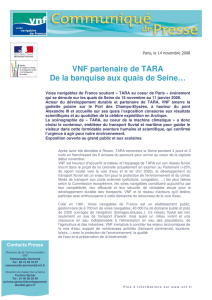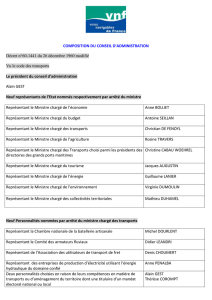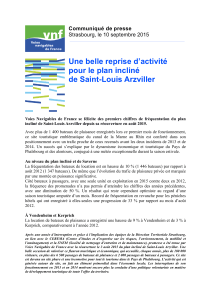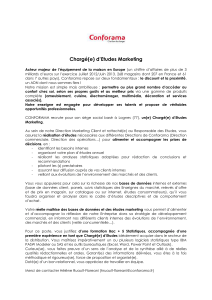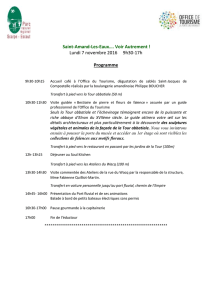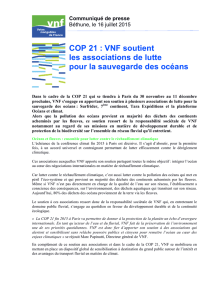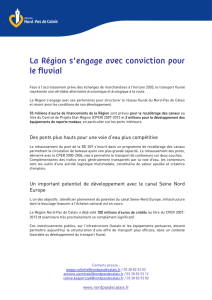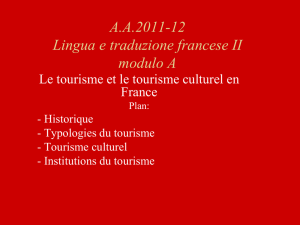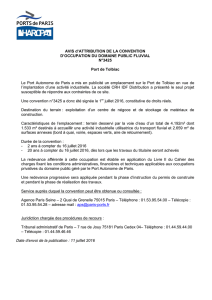Performances environnementales des pratiques

1
Vendredi 1er décembre
Performances environnementales des pratiques de transport et de logistique
I. Présentation d’Orée
Dimitri COULON, responsable des actions et du développement de
l’association
Créée en 1992, Orée a pour but de promouvoir de meilleures pratiques
environnementales. L’un de ses axes de travail porte sur les transports, qu’ils
adressent des personnes ou des marchandises. Ce dernier axe a emporté la
parution, le 16 octobre, d’un guide.
Orée, par ailleurs, apporte de l’information et communique sur les bonnes
pratiques. En 2005 ainsi, elle avait donné naissance à un guide portant sur les
relations entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants.
La rédaction du guide dédié aux performances environnementales des pratiques
de transport et de logistique a mobilisé plus de 200 intervenants. Il comporte
différentes rubriques dédiées :
à la description du panorama français ;
aux impacts, avantages et inconvénients des différents modes de transport
sur l’environnement ;
au panorama réglementaire et juridique et à la politique environnementale ;
à des propositions de solutions, illustrées par 17 retours d’expériences ;
aux références, à la sitographie et à la plate-forme Internet.
L’accroissement du nombre de kilomètres parcourus, essentiellement par route,
est avéré. Or, les transports sont les principaux responsables des émissions de
gaz à effet de serre ou de NO2. Sont également à évoquer les rejets liquides.
En 1990, le secteur des transports était le 3ème émetteur de gaz à effet de serre,
occupant malheureusement la tête du classement dès 2004. S’agissant des
autres émissions, il occupe également une place importante. Les nuisances
sonores, par ailleurs, ne sont pas à négliger, s’ajoutant aux problèmes de trafic
et de congestion des réseaux.
Du fait des éléments précités, il est fondamental de mettre en œuvre des actions
concrètes, lesquelles peuvent reposer sur :
la pression réglementaire ;
la pression concurrentielle ;
la pression économique ;
la nécessaire anticipation des risques.
II. Retour d’expérience de VNF
Anne ESTINGOY
VNF est un établissement public en charge de l’exploitation et de l’aménagement
des voies navigables de France. Il tend notamment à mettre en œuvre une
politique de développement des transports fluviaux, lesquels sont respectueux de
l’environnement.

2
L’axe Marseille – Lyon et la Seine sont des voies navigables ouvertes aux grands
gabarits. Les bassins du Rhône et de la Seine, cependant, ne sont pas raccordés
au réseau européen. Cela étant, d’importants progrès ont été réalisés en 10 ans.
La navigation sur les voies à grands gabarits est autorisée 7 jours sur 7, 24
heures sur 24 et 350 jours par an. Pour rompre avec des idées reçues, la
majeure partie du trafic est aujourd’hui prise en charge par des bateaux fluviaux
et des bateaux fluvio-maritimes.
Les avantages des modes de transport par eau sont à relever du fait :
d’une consommation énergétique quatre fois moindre que celle afférente à la
route ;
d’un rejet de CO2 quatre fois moins important que celui occasionné par la
route.
Si ces deux éléments permettent l’atteinte des directives de Kyoto, il n’en
demeure pas moins que le mode de transport fluvial ne permet pas la desserte
de l’ensemble du pays.
Par ailleurs, le transport fluvial présente d’autres intérêts :
de faibles aléas de trafic ;
une bonne régularité ;
un raccourcissement des procédures douanières ;
la garantie d’une grande sécurité.
Quoi qu’il en soit, la régularité compense des temps de trajet plus longs que s’ils
étaient effectués par la route.
La croissance des transports fluviaux est avérée. Le trafic de conteneurs, ainsi,
suit une croissance exponentielle, les axes fluviaux permettant de pénétrer les
territoires efficacement. En la matière, les filières les plus dynamiques adressent
notamment :
les produits chimiques ;
les céréales ;
les granulats.
En outre, la voie fluviale est adaptée tant aux distances de transport moyennes
qu’aux distances plus courtes. L’installation d’un terminal à Fosse sur Mer,
l’approfondissement de la Saône et l’encouragement des silos situés au bord des
voies d’eau ont contribué à ce que les céréales deviennent le principal produit
transporté par voie fluviale.
VNF, enfin, a conclu des partenariats avec les ports et avec les collectivités
territoriales. En effet, le transport fluvial exige la mise en œuvre d’outils de
transbordement, soit publics, soit mis à disposition par les entreprises
intéressées. Les embranchements particuliers, ainsi, représentent le tiers du
trafic généré sur le bassin, étant soutenus par VNF et les régions.
Quoi qu’il en soit, le mode fluvial apporte une réponse aux besoins de nombre
d’entreprises. Il est, avec le fer, une véritable alternative à la route.

3
III. Exemple de Conforama
Patrick WEYMEELS
Conforama effectue des achats dans nombre de pays européens, les acheminant
essentiellement par bateau vers l’une de ses quatre plates-formes logistiques,
lesquelles sont situées près des grands fleuves, français et européens. Ainsi, 90
% des conteneurs de Conforama sont transportés par voie fluviale.
Dimitri COULON
Selon vous, quels sont les principaux freins au développement du transport
fluvial ?
Patrick WEYMEELS
Ce mode de transport est cohérent avec l’emplacement de nos plates-formes.
Contrairement aux idées reçues, il n’est pas générateur de délais prohibitifs.
Cependant, il nous est nécessaire, pour desservir nos magasins, de recourir à la
route. Telle est probablement sa principale limite. Enfin, Conforama essaie
également de recourir au ferroutage. Cependant, le coût de ce type de transport
est largement supérieur à celui des transports par voie fluviale et par voie
routière.
Anne ESTINGOY
Le transport fluvial ne peut être utilisé seul. En tant que tel, il est moins onéreux
que la route. Cependant, les transferts de rupture de charges et les
acheminements par camions en accroissent le coût.
Pour pallier cela, VNF essaie de faire en sorte que les zones d’activité situées en
bord de fleuve soient réservées aux entreprises désireuses de recourir au
transport fluvial. De même, la Ville de Lyon a la chance de disposer d’un port en
son cœur : sur un plan économique et environnemental, il constitue une réelle
chance.
Enfin, le transport fluvial présente deux limites principales.
Il ne permet pas la desserte de l’ensemble du territoire.
Les pouvoirs publics s’en désintéressent quelque peu.
Dimitri COULON
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur notre stand ou consulter
notre site Internet : www.oree.org.
1
/
3
100%