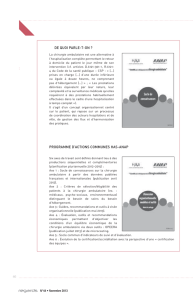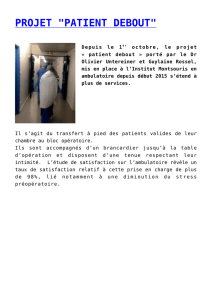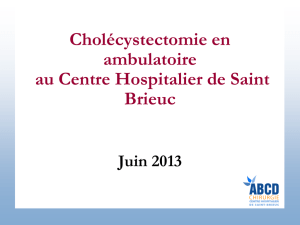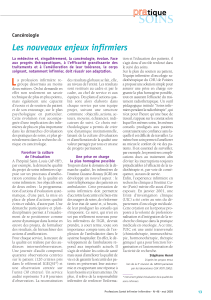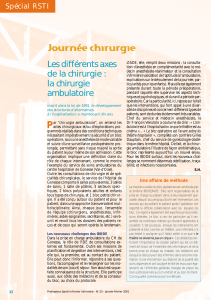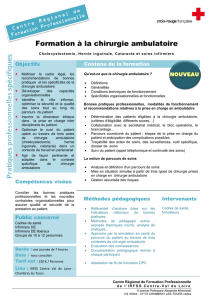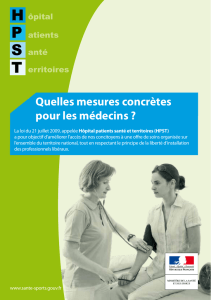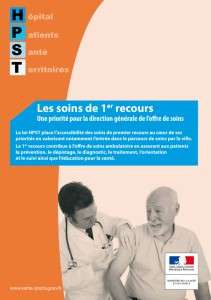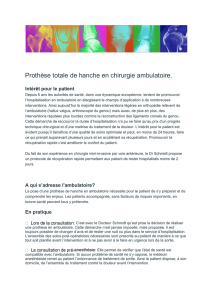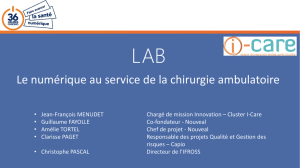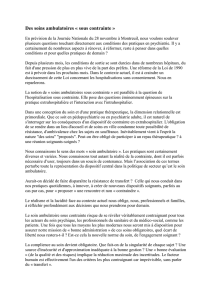Chirurgie ambulatoire, chirurgie de demain

Chirurgie ambulatoire, chirurgie de demain.
Structurer la coordination Hôpital-Ville
La France accuse un retard important en matière de prise en charge ambulatoire des actes
chirurgicaux. Nul doute pourtant qu’elle rejoindra la plupart des pays du Nord et de l’Ouest,
car elle constitue la voie inexorable à court et moyen terme pour répondre aux enjeux tant
sanitaires qu’économiques, tout en améliorant la qualité des soins rendus aux patients.
La chirurgie ambulatoire est en effet amenée à assurer, à moyen terme, la plus grande
partie des actes chirurgicaux, seulement 10% des patients présentent des contre-
indications absolues. Aujourd’hui, sur 7,2 millions d’actes chirurgicaux pratiqués en France
chaque année, 1,8 millions le sont dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.
Les enjeux financiers sont colossaux : les économies pour l’Assurance maladie atteindraient
500 millions €.
Par une dédramatisation du geste chirurgical, un meilleur confort à domicile, cette chirurgie
répond à la satisfaction des patients avec un taux de 90%, largement supérieur à ceux
observés en hospitalisation traditionnelle (enquête Cnam). Les bénéfices pour le patient
sont également sanitaires : des risques très réduits d’infections nosocomiales : 6 fois moins
d'infections nosocomiales en chirurgie ambulatoire, une mortalité à 7 jours réduite par
deux, et plus de deux fois de risques d'une réhospitalisation.
La chirurgie ambulatoire apporte une réponse commune à des problématiques partagées
par de nombreux pays, à savoir un accroissement de la demande et des listes d’attente, le
vieillissement de la population, la nécessité de maîtriser les dépenses de soins et le
développement de nouvelles techniques chirurgicales.
Et pourtant, lorsqu’une mission est consacrée à l’hôpital, la commission Larcher, la CA fait
œuvre de grande absente.
Comment dans ce contexte expliquer le retard français ?
Quels sont les freins qui ralentissent aujourd’hui le développement de la chirurgie
ambulatoire et les moyens de les lever :
Quelle(s) politique(s) incitative(s) pourrait être mise en œuvre ?
Pourquoi n'y a-t-il pas encore de démarche contractualisée avec la médecine de ville qui
devra être impliquée dans le retour à domicile, les soins post opératoires et le suivi, la
surveillance ou l’adaptation du protocole antalgique ?

Les freins au développement de la chirurgie ambulatoire
sont essentiellement culturels
Guy Bazin, président fondateur de l’Association française de chirurgie ambulatoire, voit 2 raisons
principales au retard de la France sur ce dossier : dues aux acteurs et aux institutionnels.
« La chirurgie ambulatoire perturbe considérablement les acteurs médicaux qui perdent le
pouvoir. Deuxièmement, l’État n’a pas compris tout de suite la façon dont on pouvait
l’organiser et a voulu préserver la main mise sur l’ensemble de l’organisation. Or, la CA ne
peut se développer dans une logique administrative de régulation mais dans une logique
économique. Il y a eu un conflit d’intérêts ou de pouvoirs qui a surement bloqué l’ensemble.
Je pense aujourd’hui qu’on a compris cela et le futur décret de chirurgie met la priorité sur
l’ambulatoire. Il ne sera plus accordé d’autorisation à une activité de chirurgie si
l’établissement ne pratique pas la chirurgie ambulatoire. »
Une vision partagée dans ses grandes lignes par Gilles Bontemps, chargé de mission auprès
des négociations à la Cnam, directeur de l’observatoire national de la chirurgie ambulatoire à la
Cnam. « Notre culture française n’est pas basée sur le patient au cœur du dispositif et c’est
pour bien pour moi le principal frein culturel et organisationnel. Le pouvoir à l’hôpital n’est
pas financier mais d’abord culturel et organisationnel. Il faudra accompagner les acteurs
pour faire évoluer ce système, les infirmiers peuvent être des moteurs car ils sont déjà dans
cette logique. »

Un rôle infirmier : marginal ou déterminant
Les infirmiers libéraux peuvent être moteurs du développement par leur rôle de
« prescripteur »
- un rôle d’information, de communication
« Les infirmiers libéraux peuvent apporter des informations, dédramatiser le geste
chirurgical. En tant qu’infirmier, vous êtes la personne la plus proche des personnes qui
vont être opérées », constate Gilles Bontemps, ajoutant que « les infirmiers peuvent faire
émerger une demande des patients à l’ambulatoire. »
- un rôle de présélection du patient en pré opératoire
Guy Bazin estime qu’ « En tant qu’infirmière libérale, vous êtes infirmière de première ligne
et vous connaissez parfaitement bien l’état psychosocial du patient. » Les infirmières
libérales ont un rôle majeur dans la définition et la sélection de ces patients éligibles à
l’ambulatoire. C’est, selon lui, à ce niveau que l’infirmière libérale et le médecin généraliste
interviennent, car « qui mieux que vous connaissez le patient et son environnement. »
En théorie... aucun besoin spécifique généré par la chirurgie ambulatoire, voire
même une restriction de certains actes de soins
Dans le paysage de la chirurgie ambulatoire, « les paramédicaux sont des spectateurs
obligés », décrit Alain Zirn, chirurgien (chirurgie générale et viscérale) à l’unité ambulatoire du
centre hospitalier de Noyon (Oise), pionnier en secteur hospitalier public. « Les soins post-
opératoires sont exactement les mêmes que ceux de la chirurgie traditionnelle, rien de plus
rien de moins. Si la douleur est bien prise en charge au départ, aucun rôle n’est dévolu aux
paramédicaux pour l’instant. Votre rôle incitatif est marginal sauf le bouche à oreille vis à
vis des patients. »
Au centre hospitalier de Noyon (60), au sein duquel le docteur Zirn officie, « pour l’instant
les actes de chirurgie ambulatoire ne réclament aucune spécificité libérale en post
opératoire, voire même conduisent à une diminution des actes infirmiers. Sur d’autres
actes, la prise en charge infirmière pourrait être différente. »
Guy Bazin confirme ce positionnement, estimant que l’infirmière libérale n’est absolument
pas concernée par les sorties de chirurgie ambulatoire, sauf dans les cas très particuliers
d’échecs de cette chirurgie. « Lorsque le patient arrive au domicile, s’il y a un problème, ce
n’est pas à l’infirmière de première ligne à s’en occuper. S’il y a problème, c’est un défaut de
prise en charge de la structure ambulatoire qui n’a pas prévu toute la thérapeutique
nécessaire. »

En réalité… des infirmiers qui pallient les défaillances du système
« Effectivement, on peut mettre des pansements qui tombent au bout de 8 jours. Mais nous
voyons des patients qui ont perdu un peu d’autonomie. Ils n’ont pas bien lu tous les
documents qui leur étaient destinés. Et, parfois, quand nous arrivons chez eux, nous,
infirmiers libéraux, c’est la catastrophe. Il y a une économie à faire si on prévoit ce suivi, que
nous allions au moins une fois chez le patient. »
A l’image de cette réaction, dans la salle, les témoignages des congressistes fusent et ne
manquent pas pour faire remonter toutes les défaillances constatées tous les jours et le rôle
des infirmiers pour y pallier.
Ainsi, Marie Odile guillon, infirmière libérale dans l’Oise, témoigne : « Nous avons constaté
à Compiègne des problèmes sur les retours à domicile, et nous avons créé une association
RSS 60 relais santé soins 60 pour prendre en charge les personnes qui rentrent à domicile. »
« Par le réseau aussi, les libéraux pallient aux défaillances du système, et ce sans
financement», ajoute Stéfane Fauran.
De la même manière qu’en théorie, les critères d’inclusion des patients dans
l’hospitalisation à domicile sont clairs et précis, la réalité ne correspond pas aux textes et
aux principes en vigueur et la crainte des infirmiers est que la solution « structure » soit
recherchée et prônée au détriment de l’offre libérale. Exemple ce témoignage dans la salle
d’une infirmière vendéenne qui relate la facturation d’un Hallux Valgus en Had. Ce n’est pas
par hasard si les Québécois ont définitivement enterré l’hospitalisation à domicile : « on
s’est vite rendu compte que ça coutait très cher et que cela ne servait à rien. Soit vous êtes
hospitalisés, soit vous pouvez retourner chez vous», a signalé la présidente de l’Ordre des
infirmières et des infirmiers du Québec.

Des infirmiers libéraux qui rendent possible
la sortie hospitalière des patients
« On ne peut pas envisager le développement de la chirurgie ambulatoire
sans prendre en charge le développement de la prise en charge de la douleur
post opératoire » : Stéfane Fauran, réseau SOS Douleur domicile
En chirurgie ambulatoire ou traditionnelle, c’est la présence du réseau territorial
d’infirmiers libéraux qui rend possible la sortie des patients à leur domicile dans de bonnes
conditions et permettant la réduction des durées de séjour.
Dans le cadre spécifique de la chirurgie ambulatoire, les infirmiers peuvent avoir un rôle
crucial dans son développement en rendant possible l’extension des actes réalisés vers des
actes plus lourds.
Illustration : l’expérience du réseau charentais SOS Douleur Domicile. Il a permis de réduire
la durée des hospitalisations, tout en supprimant les douleurs postopératoires. En 4 ans, ce réseau
a assuré 16 000 journées de maintien à domicile avec les cathéter périnerveux.
« Tous les acteurs sont convaincus par notre expérience, et nous sommes la seule expérience
au monde à avoir autant de données », explique Stéfane Fauran.
Le réseau repose sur une méthode innovante appliquée aux patients : poser un cathéter péri-
nerveux, utilisé habituellement en milieu hospitalier, permettant de recourir à des anesthésiques
locaux pour soulager toutes les douleurs. Le réseau s’est créé suite à l’impossibilité pour l’unité
de chirurgie vasculaire en Charentes de soulager leurs patients et de les laisser sortir.
« Nous répondons avant tout à la demande du patient qui souhaite qu’on puisse soulager sa
douleur. »
60% des infirmières du département ont été formées à la technique des cathéter
périnerveux et aujourd’hui les données PMSI attestent, au plus grand étonnement des
administratifs, que les durée d’hospitalisation sont inférieures de 20% aux références.
Les infirmiers libéraux du réseau prennent en charge des patients en post opératoire
immédiat après la Chirurgie ambulatoire sur Angoulême, des Hallux Valgus à J zéro à
domicile avec un cathéter périnerveux et la chirurgie ambualtoire fait partie intégrante de
l’activité du réseau.
L’objectif qui reste poursuivi par Stéfane Fauran est de faire reconnaître ces actes à la
nomenclature, ce qui ne viendra pas tant que la Haute autorité de santé n’aura pas validé
des protocoles avec les cathé périnerveux.
10% des actes de chirurgie ambulatoire pourraient potentiellement nécessiter des soins
post opératoires spécifiques dans le cadre de protocoles antalgiques. Cela concernerait tout
de même près d’1 million d’actes. « Dès lors que nous allons étendre les indications de la
chirurgie ambulatoire à des indications plus lourdes, je pense que l’expérience du réseau
SOS Douleur domicile pourrait être très intéressante. Car elle permet de remettre le patient
au cœur du système et re travailler la frontière entre l’hôpital et la ville. On voit bien au
 6
6
1
/
6
100%