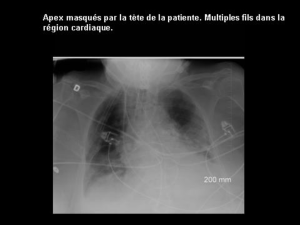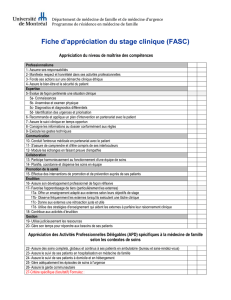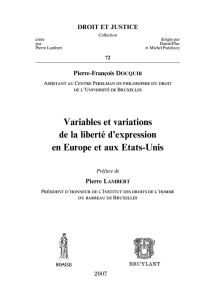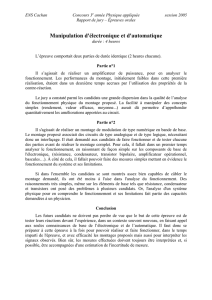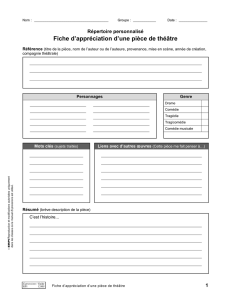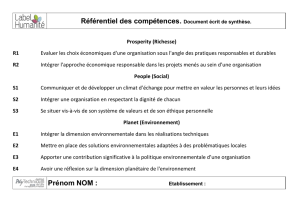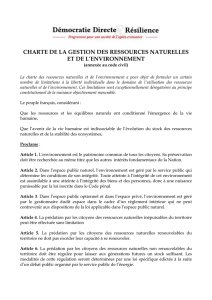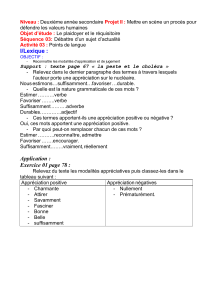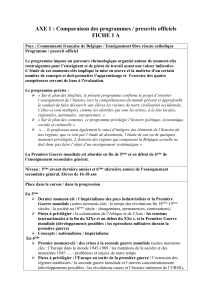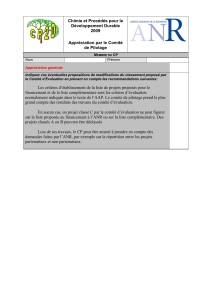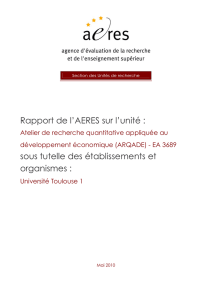Capacité de travail exigible

Capacité de travail exigible
Guide pour l’évaluation
de la capacité de travail
exigible par suite
d’accident ou de maladie
Swiss Insurance Medicine (SIM)
Secrétariat de la SIM
c/o Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
Gertrudstrasse 15
Case postale
8401 Winterthour
Tél. 058 934 78 77
info@swiss-insurance-medicine.ch
www.swiss-insurance-medicine.ch
Service des renseignements de la médecine des assurances de la Suva
Fluhmattstrasse 1
6002 Lucerne
Tél. 041 419 52 39 (8h00 –17h00)
www.suva.ch
Academy of Swiss Insurance Medicine (asim) Universitätsspital Basel
Petersgraben 4
4031 Bâle
Tél. 061 265 55 68
www.asim.unibas.ch
Offi ce fédéral des assurances sociales OFAS
Domaine AI
Effi ngerstrasse 20, 3003 Berne
Tél. 031 322 90 99
sekretariat.iv@bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch
Publié par Swiss Insurance Medicine (SIM), Communauté d’intérêts
suisse de la médecine des assurances; 2e édition (2013)
ISSN-978-3-003-01169-4
Renseignements
Référence
2980.f
Édition avril 2013

32
Table des matières
3
Qu’entend-on par capacité de travail exigible? 5
Rôle du médecin 7
Types d’appréciation 9
Travail à plein temps avec limitations de certains efforts 9
Travail à plein temps avec des pauses supplémentaires et / ou un
rendement inférieur 9
Temps de travail réduit et rendement normal 10
Temps de travail réduit et rendement inférieur 10
Circonstances spécifiques 11
Menace d’atteinte à la santé ou d’aggravation de l’état de santé 11
Augmentation du risque d’accident (pour soi-même ou pour autrui) 11
Augmentation du risque pour de dégâts matériels 11
Performances et productivité trop faibles par rapport aux
exigences du travail 12
Limitations temporelles 12
Grossesse / Maternité 12
Contacts avec d’autres personnes 12
Travail en horaire tournant / travail de nuit 12
Travail avec contrainte de temps / travail à la chaîne 13
Exposition à des agents physiques on chimiques 13
Effets des limitations fonctionnelles somatiques 14
Epaule 14
Coude et avant-bras 14
Poignet et main 14
Hanche 15
Genou 15
Cheville et pied 15
Prothèses articulaires 15
Dos 16
Vertiges 17
Epilepsie 17
Douleurs chroniques 18
Paralysies 18
Troubles des fonctions cérébrales 18
Diabète 18
Maladies pulmonaires 19

54
Maladies cardiaques 19
Maladies de l’appareil circulatoire 20
Polyarthrite rhumatoïde (polyarthrite chronique) 20
Maladies gastro-intestinales 21
Incontinence urinaire ou fécale 21
Cancers 21
Effets des troubles psychiques 21
Troubles de l’humeur 22
Anxiété 23
Troubles de la personnalité 24
Schizophrénie et autres troubles délirants 24
Troubles obsessionnels compulsifs 25
Réactions aux stress majeurs 25
Troubles dissociatifs et somatoformes 25
Dépendance aux substances psychoactives 26
Développement de symptômes somatiques pour des
raisons psychiques 26
Formulaires 27
Sources 27
Renseignements 28
Aussi longtemps qu’un patient, à la suite d’un accident ou à cause d’une
maladie, est incapable de travailler pendant six mois au plus et que l’on
peut logiquement prévoir une reprise du travail habituel, la tâche du
médecin se limite à apprécier l’importance de l’incapacité de travail. La
brochure «Incapacité de travail: lignes directrices pour l’évaluation de
l’incapacité de travail à la suite d’un accident ou de maladie» éditée par
la SIM donne les indications nécessaires à ce sujet. Ce n’est que dans
le cas d’une durée supérieure d’incapacité de travail que l’assureur est
tenu de se renseigner pour savoir si l’on peut exiger du patient qu’il
accomplisse un travail dans un autre domaine d’activité. La présente
brochure traite de l’évaluation médicale de cette exigibilité de l’activité
professionnelle.
Il n’existe pas de défi nition légale de l’exigibilité dans le droit des assu-
rances sociales suisse. Selon l’opinion généralement admise, il s’agit
de savoir si l’on peut attendre un comportement déterminé d’une per-
sonne, même s’il entraîne des désagréments et exige certains sacri-
fi ces. Légalement, l’assuré a l’obligation de contribuer à la diminution
du dommage. Cela signifi e que, en vue de sa réinsertion profession-
nelle, il doit contribuer à ce que l’on peut exiger de lui. L’exigibilité doit
également être comprise comme l’expression d’un effort de volonté
attendu et nécessaire pour surmonter certaines diffi cultés éventuelles
comme des douleurs, un stress psychique, une modifi cation raison-
nable des habitudes de vie, un déclin social, une perte de gain ou
une diminution du temps de loisir. Les conditions imposées à l’assuré
doivent être compatibles avec son état de santé (atteinte à la santé)
et correspondre à ses capacités et aptitudes. Par ailleurs, elles ne doivent
pas entraîner de modifi cations fondamentales du mode de vie. A partir
du moment où l’exigibilité d’une activité professionnelle adaptée aux
troubles est établie, les mesures de réinsertion peuvent être mises en
place. Il peut arriver que l’importance de l’atteinte à la santé due à
l’accident ou à la maladie ne permette pas à l’assuré d’obtenir un gain
aussi élevé qu’auparavant. Une telle perte de gain peut justifi er une
invalidité.
Le concept de l’exigibilité permet au législateur et aux juristes de limiter
et de concrétiser les prestations au titre du droit des assurances
sociales. À cet égard, les intérêts de la collectivité des assurés – qui
supporte la charge fi nancière – et ceux des assurés concernés doivent
être soigneusement pesés. Sur le plan formel, l’exigibilité d’un travail
est appréciée par les personnes chargées d’appliquer la loi
Qu’entend-on par capacité de
travail exigible?

76
– autrement dit par le responsable sinistres ou le juriste d’une compa-
gnie d’assurances. Ceux-ci se fondent sur l’évaluation médicale des
fonctions et des capacités résiduelles à la suite d’un accident ou
de maladie. Il se fondent également sur la description des postes de
travail (recueillie au moyen de questionnaires et enregistrés dans
des bases de données ou collectée sur place par des collaborateurs
du service externe des sociétés d’assurances ou des spécialistes
lors de l’examen ergonomique des postes de travail).
Ce guide contient des conseils pour la description des capacités
fonctionnelles et des aptitudes des personnes présentant des atteintes
à la santé. Il est conçu comme un vade-mecum pour les médecins
qui commencent à effectuer de telles appréciations en pratique clinique.
Il ne peut cependant ni remplacer une formation spécialisée en exper-
tise ni permettre d’apprécier à leur juste valeur toutes les situations
imaginables. Il ne traite pas de l’appréciation de l’aptitude profession-
nelle ou de l’évaluation standardisée des capacités fonctionnelles telles
qu’elles sont effectuées par des organismes spécialisés. Il n’aborde
pas non plus l’appréciation de l’aptitude à la conduite d’un véhicule.
La Classifi cation internationale du fonctionnement, du handicap et
de la santé (CIF) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est
aujourd’hui devenue un outil important pour la description du fonction-
nement des personnes présentant une atteinte à la santé ou dans
une situation de handicap, en particulier pour la réinsertion profession-
nelle. Si ce système de classifi cation est déjà répandu en médecine
de réadaptation, son emploi n’est toutefois pas encore établi dans les
soins de base, dans le case management, parmi les conseillers
d’orientation professionnelle, chez les employeurs ou les assureurs.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas nous référer
à cette classifi cation dans la présente brochure.
Les médecins sont régulièrement chargés par les compagnies d’assu-
rances d’évaluer les capacités fonctionnelles d’un patient et son aptitude
à exercer certaines activités. lls jouent à cet égard un rôle important,
car leurs décisions et leurs recommandations ont des répercussions
majeures sur le processus de guérison, la réinsertion professionnelle et
les coûts.
Pour déterminer si une activité professionnelle spécifi que
peut être exigée d’une personne, il faut en premier lieu caractériser l’état
de santé objectif du point de vue médical. Il faut estimer si l’état de santé
de l’assuré satisfait, du point de vue physique et psychique, aux condi-
tions exigées à l’accomplissement d’une activité professionnelle spéci-
fi que. Il appartient au médecin de déterminer les fonctions et capacités
résiduelles ainsi que les défi cits et handicaps par suite d’accident ou
de maladie. Par cette évaluation, le médecin remplit une fonction
d’expert et de conseil. Il doit se borner à établir des profi ls de fonctions
et de capacités; dans son avis médical, il ne doit en aucun cas se pro-
noncer sur l’incapacité de gain, l’invalidité ou les questions de rente.
Les appréciations médicales ont valeur d’expertise. Non seulement le
mandant, mais également de nombreuses autres parties et personnes
spécialisées peuvent y avoir recours dans le cadre d’une procédure en
droit des assurances.
L’appréciation médicale repose en général sur l’examen clinique et la docu-
mentation
appropriée de l’état de santé: étude des pièces, entretien
clinique, examen approfondi de l’assuré (en consignant soigneusement
les observations effectuées) et, le cas échéant, demande de renseigne-
ments auprès de tierces personnes. Le médecin établit la liste des
diagnostics, éventuellement complétée par les diagnostics différentiels.
Avant de rendre une appréciation fi nale, il convient de vérifi er si toutes
les mesures thérapeutiques ont été prises en vue d’une amélioration
signifi cative de l’état de santé. D’autre part, il importe d’apprécier, outre
l’état de santé, la motivation, l’engagement dans le travail, les bénéfi ces
secondaires de l’incapacité de travail ou de la maladie ainsi que d’autres
facteurs non liés à l’atteinte à la santé. Il faut également tenir compte
de l’appréciation subjective de la capacité de travail. En l’occurrence, on
doit prêter attention non seulement au contenu, mais également au mode
de présentation qui en est fait: plus les dires sont concrets et consis-
tants,
plus l’autoévaluation doit être considérée comme fi able. Il faut éga-
lement
documenter le déroulement actuel d’une journée avec les diffé-
rentes activités accomplies et compléter ces renseignements, le cas
Rôle du médecin

98
échéant, avec des informations externes (recueillies notamment auprès
de l’employeur, de collègues de travail, du médecin traitant, des spécia-
listes concernés ou des proches). On veillera également à se procurer les
rapports d’éventuels tests de performances ou de bilans professionnels.
En se fondant sur l’ensemble des fonctions et des capacités constatées
et en tenant également compte des autres facteurs, le médecin peut
donner une appréciation sur le profi l des capacités.
Un profi l positif des capacités représente ce qu’une personne est en
mesure de faire, notamment:
• exercer des activités principalement en position assise
• exercer des activités principalement en station debout
• exercer des activités principalement en marchant
• exercer des activités avec des positions alternées
• travailler avec les mains au-dessus du niveau du thorax,
des épaules ou de la tête
• travailler baissé ou penché en avant assis / debout
• travailler avec rotation du tronc à droite / gauche assis / debout
• travailler en position accroupie
• travailler à genoux
• monter et travailler sur des échelles / échafaudages
• monter et descendre des escaliers (de manière répétée ou occasionnelle)
• soulever et porter des charges (près / loin du corps, à la hauteur de la
taille ou du thorax, poids de…kg, avec la main droite, gauche, les
deux mains, de manière répétée ou occasionnelle)
• actionner des machines dangereuses
• exécuter des travaux nécessitant une forte concentration
• supporter d’être exposé au bruit
• travailler dans des conditions de luminosité gênante
• être en contact fréquent ou permanent avec d’autres personnes,
notamment avec la clientèle
• horaires de travail (organisation temporelle)
• intensité («rendement») de travail
À l’inverse, un profi l négatif des capacités indique les activités qu’une
personne n’est plus en mesure d’exercer.
L’appréciation des capacités et des limitations fonctionnelles observées
lors d’atteintes à la santé spécifi ques (par exemple gonarthrose médiale
avec réduction de la mobilité) est en général plus simple que l’apprécia-
tion d’atteintes non spécifi ques (par exemple douleurs lombaires non
spécifi ques). Des tests fonctionnels spéciaux (par exemple évaluation de
la capacité fonctionnelle liée à l’activité professionnelle, ECF) peuvent
être utiles dans certains cas particuliers.
Lors de l’appréciation, les éventuelles discordances entre l’autoévaluation
du patient et l’évaluation du médecin spécialiste doivent être évoquées.
Lorsque le médecin constate chez un patient une limitation des capa-
cités, différentes possibilités d’appréciation s’offrent à lui. On trouvera
ci-après quelques modèles typiques d’appréciation. L’ordre de présen-
tation refl ète un ordre de préférence, c’est-à-dire que chaque type,
sur la base de considérations sociales et de médecine des assurances,
doit autant que possible être préféré au type qui suit.
Travail à plein temps avec limitation de certains efforts
Il faut indiquer les limites de charges / sollicitations, éventuellement
formuler des recommandations de mesures d’organisation du travail et
d’utilisation
de moyens auxiliaires (moyens de levage par exemple). Il
convient
également de signaler les activités adaptées au handicap qui,
dans l’entreprise, ne correspondent pas au travail d’origine. Des
recommandations de changement de poste de travail ou de tâches au
sein d’une organisation («job rotation») peuvent être émises afi n d’éviter
des charges / sollicitations trop spécifi ques. Il importe de mentionner
des seuils critiques de levage de poids et de fréquence et/ou de durée
des sollicitations.
Travail à plein temps avec des pauses supplémentaires et / ou
un rendement inférieur
Il peut s’agir de pauses brèves, mais plus fréquentes, de pauses plus
longues ou d’un rythme général de travail ralenti. Les charges / sol-
licitations critiques (par exemple manipuler certaines charges ou prendre
certaines positions) sont tolérées, mais pas avec le rythme, la fré-
quence ou la durée usuels. La fréquence des mouvements, des posi-
tions et des sollicitations / charges pendant une journée peut être
catégorisée comme suit:
Types d’appréciation
Catégorie Cadre temporel Capacité de charge relative
dans le domaine d’activité concerné
rarement jusqu’à ½ h pour 8 h/j 1 – 5 %
parfois ½ h – 3h pour 8 h/j 6 – 33 %
souvent 3h – 5 ½ h pour 8 h/j 34 – 66 %
très souvent 5 ½ h – 8 h pour 8 h/j 67 – 100 %
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%