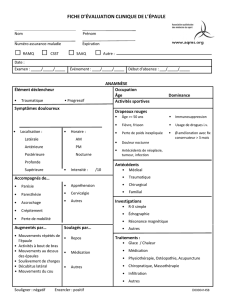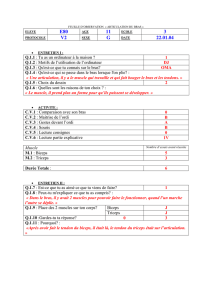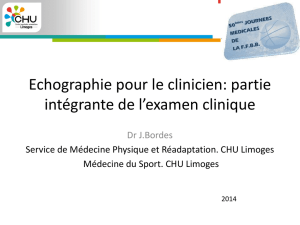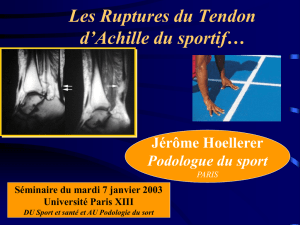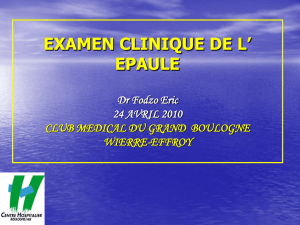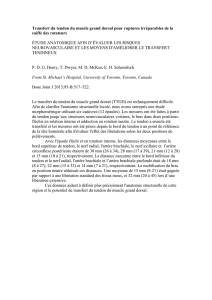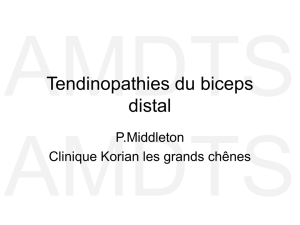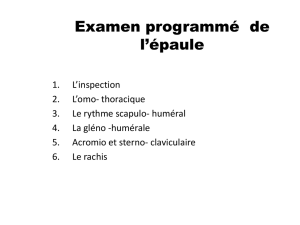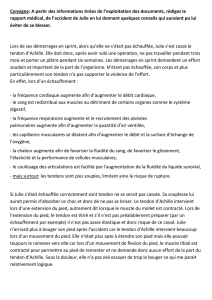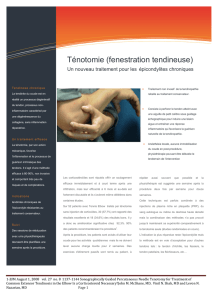Biceps - Rupture basse - Notre technique de réparation endoscopique

Article original
Réparation endoscopique des avulsions du biceps distal :
une nouvelle technique. À propos de 25 cas
Endoscopic repair of distal Biceps brachii tendon avulsion: A new technique. About 25 cases
P. Duffiet
a,
*, D. Fontès
b
a
Service de chirurgie orthopédique, centre hospitalier de Versailles, 177, rue de Versailles, 78150 Le-Chesnay, France
b
Espace médical Vauban, pôle main, épaule et sport, 2, avenue de Ségur, 75007 Paris, France
Reçu le 17 novembre 2008 ; reçu sous la forme révisée 9 janvier 2009 ; accepté le 2 mars 2009
Résumé
Introduction. –Les désinsertions fraîches du tendon distal du biceps brachii nécessitent une réinsertion chirurgicale précoce. Les techniques
chirurgicales classiques à ciel ouvert exposent à un taux important de complications locales, notamment de lésions vasculonerveuses et de
synostoses de la membrane interosseuse.
Matériel et méthodes. –Nous avons développé une technique mini-invasive sous contrôle endoscopique, simple et reproductible, permettant une
réparation anatomique des lésions fraîches avec une fixation par ancre métallique. Cette technique a été réalisée sur une série de 23 patients opérés
consécutifs, d’un âge moyen de 46 ans, dont 11 sportifs de haut niveau, revus rétrospectivement avec un recul moyen de 26 mois.
Résultats. –Parmi ces 23 patients, 22 étaient satisfaits ou très satisfaits, et 20 ont retrouvé un niveau d’activité sportive et professionnelle au même
niveau à six mois. Nous avons constaté un enraidissement moyen de 2,98en flexion et en extension, de 8,68en pronation et de 58en supination. Il y
eut une seule complication neurologique sévère ayant nécessité une réintervention. Trois complications mineures ont été reportées : deux cas de
calcifications ectopiques sans conséquences cliniques et un cas de parésie transitoire du nerf radial.
Conclusion. –En regard des options thérapeutiques actuellement décrites dans la littérature, notre technique paraît donc être une méthode simple,
reproductible et sûre permettant la réinsertion des ruptures fraîches du tendon distal du biceps brachii.
#2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Tendon biceps distal ; Arthroscopie ; Sportifs
Abstract
Introduction. –Acute avulsion of the distal biceps brachii tendon requires urgent surgical reattachment. The usual open surgical techniques carry
significant risks of local complications, mostly neurovascular injuries but also interosseous membrane synostosis.
Material and methods. –We have developed a mini-invasive method with endoscopic control, that is simple and reproducible, allowing
anatomical repair of acute lesions using a suture anchor. This new technique was used in 23 consecutive patients (among them, 11 professional
sportsmen), with a median age of 46 years, and a median postoperative follow-up of 26 months.
Results. –In these 23 patients, 22 had satisfactory or very satisfactory outcomes, and 20 recovered their previous level at sport and professional
activities after 6 months. There was a mean loss of 2,98in flexion and extension, of 8,68in pronation and 58in supination. Only one severe
neurological complication requiring revision surgery was noted. Three other minor complications were reported: two cases of heterotopic
ossification, and one transient radial nerve palsy.
Conclusion. –Compared to the techniques previously described in the scientific literature, our technique seems to be a simple, reproducible and
secure method to repair recent avulsions of the distal biceps brachii tendon.
#2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Distal tendon; Arthroscopy; Sportsmen
Chirurgie de la main 28 (2009) 146–152
* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : pascalduffi[email protected] (P. Duffiet).
1297-3203/$ –see front matter #2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.main.2009.03.003

1. Introduction
Les ruptures du tendon distal du biceps brachii sont rares,
elles ne représentent que 3 % des ruptures tendineuses au
niveau du biceps pour une incidence de 1,2 cas pour 100 000
annuelle [1]. Elles surviennent principalement sur le membre
dominant chez les hommes dans la quatrième décade, les
facteurs de risque reconnus sont le tabagisme et la pratique de
sports ou d’activités de force sollicitant les membres supérieurs
[2].
Les résultats du traitement conservateur sont peu satisfai-
sants sur la fonction du coude et sont à l’origine d’une
diminution de la force en supination et en flexion [3,4]. Il est
donc admis qu’une prise en charge chirurgicale précoce doit
être systématiquement envisagée. Différentes techniques sont
possibles, la plus ancienne étant une ténodèse non anatomique
du tendon bicipital distal sur le tendon du muscle brachial
antérieur. Plus récemment introduites, les techniques de
réinsertion anatomique du tendon bicipital sur la tubérosité
bicipitale du radius offrent de meilleurs résultats sur la force et
l’endurance. De multiples techniques à ciel ouvert ont été
décrites. Deux éléments sont variables selon les techniques : les
voies d’abord et le mode de fixation, sans qu’il n’y ait de
supériorité démontrée entre chacune des techniques, mais avec
des taux de complications per- et postopératoires non
négligeables [3–6].
Afin de limiter ce risque de complications, Sharma et
MacKay [7] ont décrit pour la première fois dans la littérature,
une technique endoscopique de réparation du tendon distal du
biceps brachii utilisant une fixation par endobouton sur deux
cas.
Nous présentons une nouvelle technique endoscopique
originale utilisant une fixation anatomique du tendon par ancre.
Nous décrirons successivement la technique opératoire et ses
avantages spécifiques, ainsi que les résultats sur notre série
rétrospective sur 23 patients opérés consécutivement dont deux
cas bilatéraux et dont dix sont des sportifs professionnels ou de
haut niveau.
2. Matériel et méthodes
2.1. Patients
Nous avons réalisé une série continue, rétrospective, non
contrôlée, mono-opératrice, incluant tous les patients opérés
d’une rupture complète du tendon distal du muscle biceps
brachii récente datant de moins de trois semaines dans notre
centre par cette nouvelle technique.
De septembre 2000 à décembre 2005, 23 patients consé-
cutifs (25 réparations) ont subi une réparation chirurgicale du
tendon distal du biceps, tous étaient des hommes, l’âge moyen
était de 45 ans (30–58). Quatorze patients (61 %) présentaient
une atteinte du membre supérieur dominant, sept (30,5 %) du
membre non dominant et deux ont présenté une atteinte
bilatérale. Trois patients (quatre cas de réparations) étaient des
joueurs internationaux de rugby, six patients pratiquaient un
entraînement de lever de poids à haut niveau et un était guide de
haute montagne. Le délai moyen entre le traumatisme et la
chirurgie était de 14 jours (5–21).
Le mécanisme du traumatisme était la pratique du sport dans
sept cas (28 %), un effort de traction dans 11 cas (44 %), un
effort de soulèvement dans deux cas (8 %) et dans cinq cas les
causes sont manquantes.
2.2. Technique opératoire
L’intervention a été réalisée en ambulatoire, sous anesthésie
locorégionale. Le patient était installé en décubitus dorsal,
membre supérieur sur table à bras, coude en extension, avant-
bras en supination. Un garrot pneumatique était installé à la
racine du membre opéré. L’opérateur était installé du côté
médial (ulnaire) du membre opéré et la colonne d’arthroscopie
face à lui.
Une incision de deux centimètres a été réalisée au pli du
coude au niveau de la « zone de sécurité » (Fig. 1A, B) qui se
situe à la partie proximale de la convergence des tendons
distaux du biceps brachial. Cette zone est à distance des
structures neurovasculaires avoisinantes (nerf cutané latéral de
l’avant-bras, nerf médian, nerf radial, artère ulnaire). La gaine
tendineuse a été repérée et incisée. Celle-ci était le siège d’un
hématome qui a été évacué, puis la gaine était rincée au sérum
afin d’éviter la survenue de calcifications postopératoires. Le
nerf cutané latéral de l’avant-bras a été alors repéré et récliné à
ce niveau où il peut être en contact avec la gaine bicipitale [8].
L’extrémité du tendon rétracté en proximal a été attrapée à
l’intérieur de sa gaine à l’aide d’une pince préhensive type
Köcher puis extériorisée (Fig. 2A). Le moignon du tendon a été
régularisé. Une canule arthroscopique a été ensuite introduite
dans la gaine du tendon de proximal en distal jusqu’à la
tubérosité bicipitale du radius afin de protéger les structures
périphériques. Un arthroscope standard, de diamètre 4,5 mm
angulé à 308sans irrigation, a été alors inséré au travers de cette
canule après avoir placé l’avant-bras en supination et flexion de
20 à 308(Fig. 2B). On a contrôlé par vision directe l’absence
d’interposition de tissu et la bonne position de la zone de
réinsertion sur la tubérosité radiale (Fig. 3A). Une ancre de type
Mitek
1
RC Anchor
*
métallique a été insérée dans la tubérosité
(Fig. 3B) permettant de suturer et d’appliquer le tendon
bicipital distal directement contre l’os (Fig. 3C). L’avant-bras a
été alors mis en supination maximale au moment du serrage des
nœuds. En cas de dilacération ou de fragilité importante du
tendon, une deuxième ancre était ajoutée afin de renforcer la
suture. Le site opératoire a été finalement refermé par deux
plans de fils résorbables avec un drainage aspiratif qui a été
retiré quelques heures après l’intervention.
Dans les suites opératoires, une attelle brachio-antibrachio-
palmaire était réalisée, permettant d’immobiliser le coude à 908
de flexion et en supination de l’avant-bras. Une radiographie
standard de coude face et profil a été réalisée en postopératoire
immédiat afin de contrôler la bonne position de l’ancre sur la
tubérosité radiale (Fig. 4C et D). Un traitement anti-
inflammatoire non stéroïdien de cinq jours était associé. Une
rééducation douce et indolore était progressivement débutée à
partir de la troisième semaine postopératoire afin de récupérer
P. Duffiet, D. Fontès / Chirurgie de la main 28 (2009) 146–152 147

la mobilité complète du coude. Les exercices contre résistance
furent autorisés à partir de la sixième semaine.
2.3. Évaluation clinique
Tous les patients ont été revus en consultation après trois
semaines, six semaines, trois mois, un an puis tous les ans afin
de suivre leur progression. Au cours de chaque examen, une
évaluation subjective de la satisfaction sur la fonction du
membre opéré a été réalisée, ainsi qu’un examen clinique
évaluant : les mobilités en flexion/extension et en pronation/
supination des deux coudes à l’aide d’un goniomètre standard,
la force en flexion du biceps brachii coude en flexion à 908et
avant-bras en position neutre à l’aide d’un dynamomètre
manuel sur trois mesures successives. Les deux patients
présentant une atteinte bilatérale ont été exclus de la
comparaison côté opéré/côté non opéré.
3. Résultats
Notre série a un recul moyen de 26 mois (extrêmes 19–60).
Aucun cas de rupture itérative n’a été rencontré. Tous les
patients sauf un se considèrent comme satisfaits de leurs
résultats postopératoires. Le seul patient non satisfait présentait
une paralysie postopératoire du nerf médian. Parmi les
23 patients, 22 sont retournés à leur niveau d’activité pré-
lésionnel avec le même niveau dans 20 cas et un niveau
légèrement inférieur dans deux cas. Sur les 25 coudes opérés,
17 ont récupéré une extension complète. Comparativement au
côté sain, la perte moyenne de l’extension constatée était de
2,98et la perte moyenne de la flexion était de 2,98(Fig. 5). Pour
la pronation et la supination, les pertes moyennes étaient
respectivement de 8,6 et 58(Fig. 6). Seul un patient présente
une mobilité en prono-supination supérieure du côté opéré par
rapport au côté controlatéral. Celui-ci présentait un antécédent
de fracture de la tête radiale du côté controlatéral à l’origine
d’une raideur en prono-supination.
En ce qui concerne la récupération de la force (Fig. 7),
13 patients (56 %) ont retrouvé un niveau de force sur tests
isocinétiques (réalisés sur dynamomètre Cybex
1
) équivalent
ou supérieur au niveau controlatéral (ratio force du côté opéré
sur force côté sain supérieur à 95 %), sept patients (31 %) un
niveau de force légèrement diminué mais satisfaisant (ratio
compris entre 75 et 95 %) et trois patients (13 %) un niveau de
force significativement diminué (ratio inférieur à 75 %). Parmi
les 11 patients sportifs de haut niveau, six présentent un très bon
résultat sur la force et sept un bon résultat, avec dans tous les cas
un retour à la fonction et au niveau sportif précédent.
Quatre complications ont été notées, parmi lesquels un cas
de parésie transitoire du nerf radial spontanément résolutive,
deux cas de calcifications ectopiques sans altération signifi-
cative de l’examen clinique et un cas de paralysie du nerf
médian survenue à la quatrième semaine postopératoire. Ce
patient présentait un antécédent de paralysie transitoire du nerf
Fig. 2. Repérage et ouverture de la gaine du biceps. A. Extériorisation et préparation du tendon bicipital. B. Introduction de la canule arthroscopique en direction de
la tubérosité bicipitale du radius.
Fig. 1. Voie d’abord de la gaine du tendon distal du biceps au pli du coude. A. Définition de la « zone de sureté » localisée au niveau de la convergence des tendons
distaux du biceps brachial. B. Repères cutanés préopératoires.
P. Duffiet, D. Fontès/ Chirurgie de la main 28 (2009) 146–152148

interosseux antérieur de résolution spontanée. Après confirma-
tion électromyographique de l’atteinte du nerf médian, il a été
décidé de réaliser une exploration chirurgicale secondaire,
celle-ci a révélé une cicatrice hypertrophique au niveau de
l’expansion aponévrotique épicondylienne médiale qui fut
excisée, à l’origine d’une compression locale.
4. Discussion
La prise en charge des ruptures récentes du tendon distal du
biceps brachii a progressivement évolué. À ce jour, la
réinsertion chirurgicale anatomique sur tendon bicipital sur
la tubérosité radiale est devenue la référence car elle offre de
meilleurs résultats sur la récupération de la fonction, de la force
et de la mobilité du coude par rapport au traitement
conservateur ou aux réinsertions non anatomiques, au prix
d’un taux de complications non négligeable [3–5,9]. En effet,
les résultats du traitement conservateur sont peu satisfaisants
sur la fonction du coude, et sont à l’origine d’une diminution de
la force en supination de 21 à 55 %, de la force en flexion de 8 à
36 %, ainsi qu’une diminution significative de l’endurance à
l’effort sur les tests isocinétiques (>60 %) [3,4].
Parmi les nombreuses techniques de réinsertion du tendon
distal du biceps brachii, aucun consensus n’a été établi sur la
meilleure technique à utiliser du fait de leurs complications
spécifiques. Différentes techniques sont possibles, la plus
ancienne étant une ténodèse du tendon bicipital distal sur le
tendon du muscle brachial antérieur. Cette technique non
Fig. 3. Réinsertion du tendon bicipital. A. Repérage de la tubérosité bicipitale du radius. B. Mise en place de l’ancre au sommet de la tubérosité. C. Laçage du tendon
bicipital.
Fig. 4. A et B. Radiographies postopératoires confirmant la bonne position de l’ancre dans la tubérosité bicipitale du radius.
P. Duffiet, D. Fontès / Chirurgie de la main 28 (2009) 146–152 149

anatomique donne des résultats assez médiocres dans les
ruptures fraîches comme le montre la série de Catonné [5] avec
une perte significative de la force en flexion et en supination de
30 à 50 %. Elle ne garde actuellement d’indication que dans les
ruptures anciennes (au-delà de six semaines) avec rétraction
importante du biceps empêchant sa réinsertion sur la tubérosité
radiale. Actuellement, les techniques les plus courantes sont les
réinsertions anatomiques du tendon bicipital sur la tubérosité
bicipitale du radius qui offrent de meilleurs résultats sur la force
et l’endurance. De multiples techniques à ciel ouvert ont été
décrites. Deux éléments sont variables selon les techniques : les
voies d’abord et le mode de fixation, sans qu’il y ait de
supériorité démontrée entre chacune des techniques.
Les réinsertions du tendon bicipital peuvent être réalisées
par sutures trans-osseuses ou de façon plus moderne par ancres
ou endobouton. Ces méthodes de fixation sont mécaniquement
équivalentes sans différence significative établie quant au
risque d’arrachement secondaire, mais avec une tendance à la
supériorité de l’endobouton et de certaines ancres [4]. Parmi les
voies d’abord, on distingue deux techniques qui ne sont pas
dénuées de complications. La technique la plus ancienne
consiste à aborder la tubérosité bicipitale du radius par voie
antérieure de Henry isolée. Cette technique nécessite un abord
large au pli du coude, ainsi qu’une dissection longue et
dangereuse des éléments vasculonerveux passant dans les
gouttières bicipitales latérale et médiale, avec des taux de
complications variables allant de 10 à 44 % selon les séries [3].
L’autre technique, par double abord, décrite initialement par
Boyd et Anderson [9] puis modifiée par Bourne et Morrey [1],
comporte moins de risques sur les éléments nobles, mais expose
à une risque de synostose de la membrane interosseuse radio-
ulnaire dans 5 à 14 % des cas, avec pour retentissement un
enraidissement douloureux de la prono-supination (Tableau 1).
L’utilisation de techniques mini-invasives a donc naturel-
lement été imaginée afin de limiter les risques d’ossifications
ectopiques, de synostoses, de lésions vasculonerveuses, et de
diminuer le préjudice esthétique d’abords uniques ou multiples
extensifs. Plus récemment, Sharma et MacKay [7] ont décrit
pour la première fois dans la littérature, une technique
endoscopique de réparation du tendon distal du biceps brachii
utilisant une fixation par endobouton sur deux cas.
Notre technique a pour principe de limiter les risques
vasculonerveux en réalisant toute l’intervention au sein de la
gaine du tendon bicipital qui protège les éléments nobles tout en
permettant une visualisation directe du site de réinsertion
tendineuse, sans nécessiter de dissection extensive de la
tubérosité radiale source de complications nerveuses sur le nerf
radial dans les abords à ciel ouvert [8].
L’innovation et l’utilisation de nouveaux dispositifs de
fixation de plus en plus performants tels que les ancres et les
Fig. 5. Mesure de l’arc de mobilité en flexion–extension du côté opéré
comparé au côté sain.
Fig. 6. Mesure de l’arc de mobilité en prono-supination du côté opéré comparé
au côté sain.
Fig. 7. Ratio de force sur test isocinétique du côté opéré par rapport au côté
sain.
P. Duffiet, D. Fontès/ Chirurgie de la main 28 (2009) 146–152150
 6
6
 7
7
1
/
7
100%