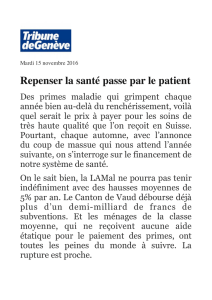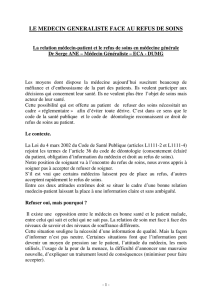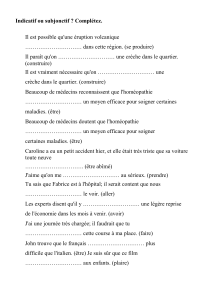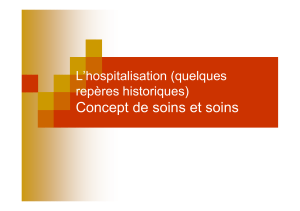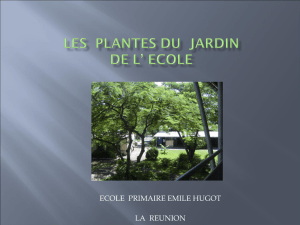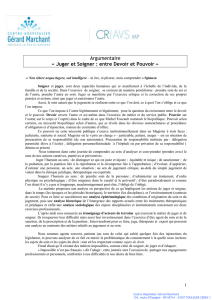soigner, c`est l`expérience de se comprendre soi

Cécilia ROHRBACH
Infirmière
anthropologue, Doctorat en
sociologie et anthropologie de l’Université de Lausanne,
«SOIGNER, C’EST L’EXPÉRIENCE DE SE COMPRENDRE
SOI-MÊME PAR LE DÉTOUR DE L’AUTRE» ’
«
Celui qui nage à contre-courant
Connaît la force que celui-ci contient
»
Woodrow Wilson
RÉSUMÉ
Les expériences pédagogiques réalisées à l’institut de Formation en Soins Infirmiers de Thonon-Les-Bains favorisent
l’émergence des connaissances des soins grâce à la méthode pratiquée. L’observateur fait partie intégrante de son
observation, car soigner ne se construit pas en «suisse
»
2,
mais avec un groupe culturel éloigné. L’observation et le
partage obtenu dans un tel groupe permettent de quitter momentanément I’hopital et sa culture et prendre de la dis-
tance pour considérer les soins comme une ontologie dans une perspective culturelle.
Mon propos est d’argumenter la nécessité d’approfondir le lien entre soins et culture. Un bref parcours historique est
décrit à travers la présence constante de l’hôpital et du système médical dans la formation et la pratique de soins
infirmiers. Ensuite, j’introduis ma démarche basée sur les soins et l’anthropologie et l’orientation philosophique qui
l’accompagne. Le résumé du travail d’une étudiante évoque un groupe culturel
«
exotique
»
3
et une description
succincte de la manière dont elle a tenu compte du fait que l’observateur fait partie de son observation.
Soigner d’une manière culturellement significative est pour moi un droit humain universel que je reconnais et que
je défends à travers mes activités de recherche et mes interventions professionnelles et pédagogiques dans les
milieux professionnels des soins et de la santé.
Mots-clés : Soigner
-
Observation
-
Participation
-
Ontologie
-
Culture
-
Éloignement.
1. Voir C. Rohrbach, 1997a.
2. J’utilise cette formulation pour indiquer le même contenu que l’expression :
«
Boire en Suisse
»
qui signifie boire tout seul, en pays Romand.
3. «Exotique
n
veut dire dans ce contexte, inconnu de l’observatrice.
81
Recherche en soins infirmiers
ND
56
-
Mars 1999

ARIATION
«SOIGNER C’EST L’EXPÉRIENCE DE SE COMPRENDRE
SOI-MÊME PAR LE DÉTOUR DE L’AUTRE»
Les raisons de l’éloignement
L’hôpital est une présence pesante dans la formation et
dans la pratique de soins infirmiers depuis le siècle passé.
L’hôpital monopolise le contenu de l’étude de soigner
dans les différentes formations et dans la quotidienneté
de la pratique. Sans nier les efforts considérables des
centres de formation en soins infirmiers, le système médi-
cal et sa technologie imprègnent aujourd’hui les soins.
L’hôpital est le lieu privilégié de la pratique infirmière et
de la formation professionnelle, l’hôpital est en fait la cul-
ture d’origine du monde infirmier. C’est l’hospitalier et
l’extrahospitalier qui prescrivent normes, valeurs,
croyances, habitudes, thérapeutiques, médicaments, atti-
tudes, etc., caractérisant la
«
culture
»
de soins infirmiers.
La formation en soins infirmiers modernes marque la pro-
fession depuis le siècle passé et jusqu’à nos jours. Le pre-
mier programme laïque de formation en soins infirmiers
est celui de l’école de la Source à Lausanne (Jaccard,
1949, p. 358, et La Source, 1859-1959, cité par
Nadot,
1992 : 334) en 1859 :
«
A côté de l’enseignement cli-
nique qui se pratiquait dans le service hospitalier par le
corps médical, la soeur directrice et la sœur institutrice
traduiront : pour l’une, les valeurs professionnelles en
leçons de morale élémentaire et pour l’autre, les
pré-requis à l’enseignement médico-chirurgical en cours
d’anatomie
»
(Nadot,
1992 : 329 et 330). Le programme
est donc basé sur le modèle médical. Voici quelles sont
les racines I’hospitalières et médicales de soins infirmiers
professionnels modernes. Les soins prodigués à domicile
suivent le modèle hospitalier centré sur les tâches, les
actes et plus tard le processus des soins, les anamnèses,
l’application des théories prescrites.
Une telle invasion dans le monde infirmier, justifie
amplement de sortir les soins de l’hôpital pour les com-
parer à ceux des autres groupes culturels. Cette compa-
raison ouvre aux soins un
«
regard autre
»
que je déve-
lopperai plus loin? (Rohrbach, 1992).
N’oublions pas que le système hospitalier en vigueur
dans la plupart des pays post-industriels est très oné-
reux. C’est d’ailleurs le système de
«
santé
»
américain
qui est le plus coûteux au monde (voir Spector, 1996 :
93-l 16) et je considère avoir une responsabilité profes-
sionnelle à ce sujet.
La place des soins
La naissance des soins remonte à l’apparition de la vie,
les soins sont donc anciens. Les soins naissent avec
l’être humain et la signification de soigner est très diver-
sifiée à l’intérieur du monde. Pourquoi soignons-nous
uniquement d’après notre culture? N’est-ce pas une
attitude ethnocentrique de notre part?
La réflexion des soins a pourtant beaucoup évolué
dans les pays anglophones et soigner compte plusieurs
démarches, plusieurs philosophies et plusieurs écoles
dont celle de Leininger :
«
Soigner c’est les soins infir-
miers, soigner c’est protéger, soigner c’est le cœur et
l’âme de soins infirmiers
»
(1991 : 40).
Les soins sont indispensables à la vie dès l’aube de I’hu-
manité et Marie-Françoise Collière l’a remarquablement
illustré dans son ouvrage, Promouvoir la vie (1982), tout
autant que l’a fait Madeleine Leininger (1970). Soigner
est enraciné dans la culture, mais en tant qu’étude, soi-
gner est pratiquement inaperçu dans la plupart des for-
mations parce qu’une telle étude est récente et
demande l’expérience de méthodes nouvelles.
Une transformation considérable jaillit à partir du
moment où l’étude des soins peut se faire avec un
regard
«
du dedans
»
(Merleau-Ponty, 1964 : 24), avec
des méthodes qualitatives qui autorisent un autre
regard. Les soins et soigner s’apprennent à travers des
cours, des exercices, des lectures, etc., mais si on sou-
haite les étudier, vivre et partager du temps avec des
groupes culturels variés est un outil d’apprentissage
précieux pour apprendre d’eux et comprendre par
l’étude leurs coutumes, leurs modes de vie, leurs tradi-
tions variées et ensuite les soigner et savoir anticiper
les soins à leur donner.
La recherche en soins infirmiers est récente, surtout en
Europe et dans le monde francophone, et la recherche
est plus facilement pratiquée avec une orientation posi-
tiviste. La transformation que la méthodologie qualita-
tive
4
peut emmener dans l’étude de soigner est la rup-
ture d’un obstacle qui barricade souvent la
connaissance des soins.
L’étude de soigner en tant que phénomène, prend de
plus en plus de place aux Etats-Unis, poussée par
l’étude du féminisme (voir
Neil,
R.M. et Watts, R.
1991, Cordon, S. Benner,
P.
et Noddings, N. 1996,
1996,
Lejninger,
1970, 1978, 1985, 1991, 1995). Nos
collègues américaines transforment soigner (caring) en
discipline, stimulées par le privilège de la liberté aca-
démique qu’elles ont conquise.
4. La question de méthodologie demanderait une explication plus
complète que je ne peux pas faire ici. Les méthodes, toutefois, ne sont
ni bonnes, ni mauvaises, il s’agit de faire le bon choix. Soigner n’a pas
été étudié avec les méthodes qui conviennent à un phénomène que
l’on connaît si peu. Les collègues américaines l’ont bien montré.
82
Recherche en soins infirmiers
N”
56
-
Mars 1999

«SOIGNER C’EST L’EXPÉRIENCE DE SE COMPRENDRE
SOI-MÊME PAR LE DÉTOUR DE L’AUTRE»
L’étude d’une ontologie des soins, c’est-à-dire d’envisa-
ger les soins comme une manière d’être, prend plu-
sieurs directions
5
à partir de 1970, mais une même
intention : Étudier, comprendre, approfondir, comparer,
développer la recherche avec des méthodes phénomé-
nologiques ou qualitatives
6.
Ce pas-de-géant : Étudier le phénomène soigner à I’uni-
versité, aligne cette discipline
a
la même hauteur que
les autres disciplines académiques. Soigner, prendre
soin, entretenir la vie sont décrits dans le quotidien et
les connaissances acquises rendent les
«
soins
»
attrac-
tifs à concevoir, à réfléchir et à pratiquer.
La place de la culture
Madeleine Leininger constate que les valeurs hospita-
lières, la technologie, les soins professionnels sont
insuffisants pour soigner les gens d’autres cultures.
Grâce à sa formation et à l’expérience acquise par son
travail de terrain chez le Gadsup de la
Nouvelle-
Guinée lors de ses études de doctorat en anthropolo-
gie, Leininger créera le domaine de soins infirmiers
transculturels et l’école du
«
caring ». Leininger est pro-
phète concernant le mélange des soins et de I’anthro-
pologie (voir Leininger, 1970). Elle témoigne dans ses
écrits de la patience qu’il lui a fallu, car ses idées
paraissaient
«
bizarres
»
à ses collègues. Sans se laisser
intimider, elle fait son doctorat en anthropologie et
devient la première infirmière anthropologue dans le
monde.
La culture, le concept clé de l’anthropologie, est
aujourd’hui intégrée aux soins culturels. La culture
interroge notre façon uni-culturelle de soigner, ainsi
que la culture hospitalière et médicale sur lesquelles
nos soins sont basés. En même temps la culture ouvre
la planète pour étudier les soins des autres peuples, les
soins traditionnels, ces soins qui nous ouvrent au
monde et qui permettent un
«
éclairage en retour
»
(Berthoud, 1992 : 11-l 3) sur notre pratique, sur notre
agir, sur notre philosophie.
5. Que je n’examinerai pas ici.
6. Voir Leininger, 1985, pour les méthodes phénoménologiques et
qualitatives.
Recherche et choix philosophiques
La technique et les actes ont été valorisés dans le
modèle hospitalier et hospitalocentriste. Cette focalisa-
tion sur l’institution hospitalière et sur le modèle médi-
cal marque la philosophie de la profession. Cette phi-
losophie centrée sur le modèle hospitalier est
aujourd’hui perceptible dans les valeurs, les concep-
tions des soins actuelles, les choix des programmes, les
efforts pédagogiques pour démédicaliser, pour ensei-
gner les soins individualisés et pour humaniser
I’hôpi-
tal. Tenter de mettre à sa juste place une influence
techno-médicale qui a aussi donné prestige et recon-
naissance aux soignants, mais qui monopolise hier
comme aujourd’hui la scène de la santé et de la mala-
die, c’est nager à contre-courant quelques fois à I’inté-
rieur même de la profession.
Soigner est fondamental à tout être humain pour vivre,
c’est un regard du dedans et un regard du dehors, soi-
gner c’est l’expérience de se comprendre soi-même
par le détour de l’autre (Rohrbach,
199713
et 1977a).
Soigner c’est une présence, un idéal, soigner c’est
aider l’autre à grandir (Mayeroff, 1971 : 6-l 5).
Soigner c’est les soins infirmiers, soigner c’est protéger,
soigner c’est la manière d’être de l’infirmière à l’égard
de l’autre et aider les gens, soigner, c’est le cœur et
l’âme des soins infirmiers (Leininger, 1991). Cette onto-
logie concerne chaque être humain et Heidegger est
un des principaux inspirateurs des courants actuels du
soigner, car une partie de l’oeuvre de Heidegger
aborde ce phénomène
(Macann,
1993 : 56-109) et
pour Heidegger prendre soin est l’expression qui
caractérise l’être dans le monde.
»
Ces réflexions universelles sont une base de la concep-
tion de «soigner les autres ». Les traditions propres à
chaque culture demandent une approche spécifique. II
est de ce fait souhaitable de sortir les soins de
l’hôpital.
II s’agit d’apprendre aux étudiants à observer soigner à
l’origine, soit avec le groupe culturel lui-même. C’est
une expérience indispensable pour l’avenir de la pro-
fession et je propose son introduction dans le cadre des
programmes de formation, selon les postulats
ci-
après :
a) Le premier se réfère aux droits de I’Homme.
b)
Le deuxième se réfère à la nécessité du
«
regard du
dehors et du dedans
»
des soins.
c) Le troisième se réfère à la prise en considération de
la qualité des soins culturels.
83
Recherche en soins infirmiers
N”
56 Mars 1999

d)
Le quatrième se réfère au fait que soigner les êtres
humains de manière congruente à leur culture
nécessite une formation (Leininger, 1991).
Les principes philosophiques plus spécifiques qui gui-
dent cette démarche sont :
l
«
Le respect de l’égalité des cultures.
l
«
La reconnaissance de leurs différences
»
(voir
Berthoud, 1992 et Rohrbach, 1997a).
Ces valeurs philosophiques guident la réflexion de I’ex-
périence pédagogique proposée et préparent les étu-
diants à l’étude des soins dans une perspective cultu-
relle, tenant compte de l’universalité et de la diversité
dans le monde et en accord avec une orientation de
recherche (voir Rohrbach, 1997a).
Expérience pédagogique : Soins et culture
La nécessité et l’avantage du détour pour l’étude des
soins, résident dans l’expérience riche en connaissance
de l’autre et de soi-même et dans l’ouverture qui habi-
tuellement se produit par rapport à soigner. Le détour
que je propose éloigne de l’hôpital tandis qu’il rap-
proche de la connaissance de l’autre et d’un regard neuf.
C’est décisif et inestimable de découvrir l’autre dans son
groupe d’appartenance tout en identifiant la vision du
monde de ce groupe. Cette introduction à la méthode
d’ethnosoins (Leininger 1991 : 69-117) est une expé-
rience stimulante dans une carrière professionnelle, une
formation de cadres ou des études universitaires.
Les soins professionnels originaires de l’hôpital sont
connus et pratiqués depuis un peu plus d’un siècle. Les
soins quotidiens et traditionnels
7
qui réparent depuis
des générations sont pratiquement ignorés dans nos
milieux hospitaliers. Les soins traditionnels sont pour-
tant le fondement même de soigner et leur étude se fait
dans les différents groupes culturels du monde et de
chaque société.
Le groupe de 46 étudiants de première année
8
a suivi
une introduction théorique de trois jours discontinus,
une observation de 2 jours et une mise en commun par
petits groupes de dix. Voici quelques choix faits par les
étudiants : un couvent des sœurs catholiques, un cou-
7. Je me suis inspirée de cette terminologie : soins professionnels et
soins folk, génériques, ou traditionnels des travaux de Leininger. Elle
Voit l’union de ces deux types des soins comme étant les soins cul-
turellement appropriés. II y a également la terminologie de Collière
qui nomme les soins coutumiers.
8. Institut de Formation en Soins Infirmiers de Thonon-Les Bains.
vent bouddhiste, les squatters, les témoins de Jéhovah,
les individus transsexuels, les dealers, un foyer de maga-
sin chinois, un mendiant, une famille paysanne, les res-
tos du cœur, le cirque, les éleveurs des chiens, etc.
La découverte par observation directe pendant ces
deux journées consécutives
9
permet de récolter des
informations inestimables en créant des liens avec ces
gens. Le groupe choisit, devient abordable et compré-
hensible, les préjugés se révisent, les craintes dimi-
nuent, soigner se transforme en l’écrivant, en le décri-
vant et en le partageant avec les autres. Les données de
première main et leur utilité pour les soins profession-
nels sont évidentes et cela apparaît dans la capacité
des étudiants à décrire comment ils soigneraient ces
individus si variés s’ils arrivaient à l’hôpital.
Leininger dans sa théorie des soins culturels, décrit les
soins de la manière suivante :
Les soins culturels à préserver ou à continuer impli-
quent de reconnaître les traditions, les croyances, les
habitudes qui ne gênent pas les soins professionnels’o,
mais au contraire qui favorisent le bien-être et la santé.
Par exemple, comprendre la signification des prières
du groupe, les valeurs de la famille étendue, les modes
de vie pour les valoriser et contribuer à leur maintien.
Les soins culturels à accommoder
et/ou
à négocier,
demandent des connaissances sur le mode de vie du
groupe et sur la signification de demandes faites dans
les services. II y a un travail à faire de la part de
I’infir-
mière pour accepter certaines demandes : comme une
famille musulmane qui demande à faire la toilette mor-
tuaire d’un membre de sa famille décédé, comme le
souhait d’un patient africain visité par un groupe de
familiers, souhait souvent problématique. Dans ces
deux cas, c’est à l’infirmière et au service de trouver
une solution satisfaisante pour les familles. Plus les ser-
vices et les collaborateurs hospitaliers acquièrent des
connaissances sur les traditions, les coutumes, leur
signification, plus la compréhension et le respect envers
les patients et leurs demandes augmentent et le service
est prêt à faire des concessions. La qualité des soins
d’un hôpital augmente si les patients venus d’autres cul-
tures sont respectés et satisfaits et si on réalise que la
qualité des soins est aussi culturelle. Des soins culturel-
lement significatifs sont une ressource nouvelle par rap-
port à la qualité des soins qui se pratique habituelle-
ment à l’hôpital et qui est mono ou uni-culturelle.
9. Une prolongation à 3 journées cette année.
10. Les soins professionnels sont ceux qui sont appris lors d’une for-
mation de base et qui se pratiquent à l’hôpital, les soins génériques
ou folk sont ceux que chaque groupe culturel pratique selon ses
croyances ou traditions (Leininger, 1991 : 38).
84
Recherche en soins infirmiers
N”
56 Mars 1999

«SOIGNER C’EST L’EXPÉRIENCE DE SE COMPRENDRE
SOI-MÊME PAR LE DÉTOUR DE L’AUTRE»
Les soins culturels à restructurer ou à réorienter consis-
tent à modifier ce qui est nocif au bien être ou à la
santé de la personne. Changer est difficile dans toute
culture. Dans certaines cultures, le changement se fait
plutôt lentement et dans d’autres, comme la nôtre, cela
se fait généralement plus rapidement. Ici, l’infirmière
tente de transformer certaines coutumes ou habitudes
avec la famille ou avec ceux qui sont concernés : les
régimes, la scolarité. des enfants, la prise de médica-
ments, la propreté, I’acculturation des familles de
requérants d’asile, etc. La collaboration, la réciprocité
et la connaissance du contexte culturel sont indispen-
sables pour mener à terme un tel projet.
Les étudiants précisent pour terminer comment ils
accueilleraient un individu du groupe étudié à l’hôpital
après ce qu’il ont appris lors de ces deux journée. Les
soins culturels ne sont pas individuels, ils s’étudient
dans un groupe parce qu’une culture s’élabore depuis
plusieurs générations et concerne une communauté.
Une culture est appartenance, elle donne une signifi-
cation à ce qui entoure. Les soins ne sont pas origi-
naires de l’hôpital, ils naissent d’une expérience intime
avec la mère, avec nous
-
mêmes, avec la famille, avec
la vie, avec les liens qui se tissent entre les êtres
humains. Nos expériences préalables des soins jouent
un rôle dans la propre pratique des soins (Roach,
1992 : 14-I 7). C’est dans une culture que se forment.
les traditions, les croyances qui se transmettent et
celles qui s’acquièrent, celles qui se perpétuent ou se
transforment au contact d’autres. Essayer de pénétrer
l’épaisseur de la culture nécessite une humilité certaine
pour créer un échange égalitaire et apprendre de
l’autre. S’accompagner du milieu du groupe facilite la
compréhension de l’autre, accompagné, de beaucoup
de curiosité. Étudier un groupe
«
exotique
»
encourage
la décentration et la découverte des soins en apprenant
les modes de vie de l’autre, en abordant la conception
de vie de son groupe culturel et sa signification.
Cette approche oblige à questionner les conceptions
personnelles, à observer d’autres valeurs, à découvrir
des croyances à entrer dans le domaine de la significa-
tion, à écrire et à partager l’expérience en élaborant :
soigner. Cette approche
«
déroule
»
les soins
«
dissi-
mulés
»
dans les synthèses caractéristiques, à nos
documents des soins : tel le processus de soins :
«
Le patient sera capable de faire sa toilette de manière
indépendante, à la fin de la semaine ».
«
La patiente
sera capable d’exprimer sa souffrance lors de I’entre-
tien de relation d’aide », etc. Que dit-on sur les soins
dans ces phrases. Soigner n’est pas la souffrance et ce
que le patient exprime, on ne le sait pas.
Sortir les soins de l’hôpital est une expérience qui
introduit à la compréhension du domaine des soins
culturels, mais cela ne veut pas dire que les soins pro-
fessionnels sont de côté, ils sont en veilleuse parce
qu’il ont été jusqu’ici très envahissants, ils prennent
une autre place. Pourtant, tout au long de cette expé-
rience, un va-et-vient se fait entre les soins profession-
nels et les soins traditionnels. Parce que je tiens à un
principe d’apprentissage indispensable, ce principe est
que pour accéder à l’inconnu, on passe d’abord et
nécessairement par le connu (voir Rohrbach, 1997a).
u
Rencontre avec des jeunes rapeurs
g
C’est le titre du travail présenté par une étudiante et qui
commence ainsi :
«
Dans le cadre du stage proposé., je fais le choix d’ob-
server une population qui m’est ‘familière’, tout en res-
tant exotique, puisque je la méconnais. Pour une pre-
mière prise de contact avec les jeunes d’un quartier de
grands immeubles, je suis allée à leur rencontre sur
leur lieu de vie, dans leur quartier. S’il est un lieu où
l’on peut constater aisément le malaise d’une certaine
jeunesse, c’est bien la proximité des grands ensembles.
Assis sur un muret, quelques jeunes tentent d’oublier
leur désoeuvrement
».
Ce qui me frappe en premier lieu, c’est l’impression
d’avoir affaire à un groupe. Au travers d’un type vesti-
mentaire qui les caractérise, je reconnais bien I’uni-
forme du rapeur, tel qu’il est véhiculé dans les médias
et la publicité : casquettes à l’envers, bonnets de rap-
peur, pantalons très larges, baskets non lacés. je leur
donne environ 18 ans. Quelques visages me sont fami-
liers pour avoir eu l’occasion de les croiser en d’autres
lieux. je saisis cette opportunité pour expliquer le
but
de ma démarche et éveiller en eux une certaine curio-
sité qui va me permettre de les côtoyer durant les deux
jours à venir. J’utilise des mots simples, des phrases
courtes et je leur propose de lire mon futur rapport.
Chance ou intuition? J’ai gagné leur confiance, et ren-
dez-vous est pris pour le lendemain à
lOh30.
Heure
considérée comme raisonnable au regard de leur emploi
du temps! Si à ce stade de la rencontre, j’ai un senti-
ment, il leur est plutôt favorable
»
(Escribano, 1997 : 1).
L’auteur du travail présente chaque jeune pour faire
part du comment ils conçoivent le monde, car c’est de
ces données que soigner va découler. Ainsi un jeune
dira :
«
On se lève pour rien faire, descendre, échapper
au regard des parents, trouver 2, 3 copains, trouver du
hasch, piquer quelque chose.
»
«Pour nous com-
prendre, faut se mettre dans notre peau
»
(ibid. p. 2).
85
Recherche en soins infirmiers
No
56
-
Mars 1999
 6
6
 7
7
1
/
7
100%