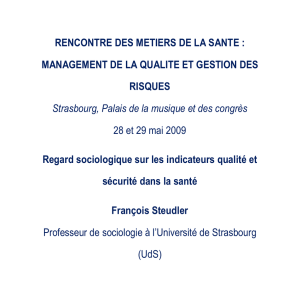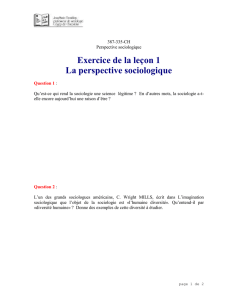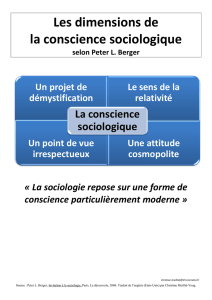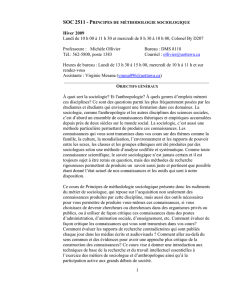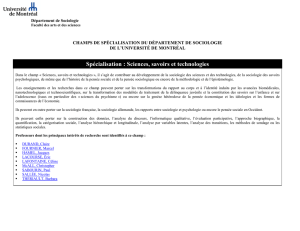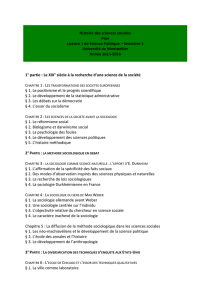analyse de textes socio 06-07

SOCIOLOGIE VISUELLE
Année académique 2013-2014
Daniel Vander Gucht (danielv[email protected] - vdg.lettrevolee.com)
La sociologie, en tant qu’entreprise de connaissance et de maîtrise scientifique du monde social, est
l’héritière de la démographie (soit le nombre – dès lors que les premières grandes études socio -
graphiques à l’ère industrielle étaient démographiques et qu’elles ont été progressivement
remplacées par des enquêtes statistiques et des sondages d’opinion) et de la philosophie (soit le logos
– Auguste Comte était lui-même un mathématicien nourri de la philosophie morale des Lumières et
de la doctrine socialiste de Saint-Simon dont il fut le secrétaire). La science sociologique s’est donc
bâtie en n’accordant crédit qu’au nombre et au logos alors que la base méthodologique des sciences
humaines est constituée par l’observation et la description objective de la réalité sociale et que la
naissance de la sociologie coïncide à peu près avec celle de la photographie (en 1839, Auguste
Comte invente le mot « sociologie » tandis que Louis Daguerre présente le daguerréotype à
l’Académie française des sciences) qui constitue la technique d’enregistrement et d’archivage la plus
appropriée qui soit à ces fins. On peut supposer que les sociologues devaient sans doute estimer que
la réalité qu’ils étudiaient était immédiatement à disposition sous leurs yeux, et que cette réalité était
par ailleurs tout aussi familière à leurs lecteurs, le recours à l’image photographique n’était pas
nécessaire car la photographie fut très peu exploitée par les sociologues. On en trouve pourtant un
certain nombre (notamment de Jacob Riis ou de Lewis Hine) dans les premiers tomes de l’American
Journal of Sociology entre 1896 et 1916, avant que la photo ne disparaisse au profit exclusif de
tableaux statistiques.
Rappelons que, dès la fin du 19esiècle avec Jacob Riis (1849-1914), réformateur social qui choisit
d’illustrer ses conférences par des photographies pour leur impact sur le public (How the other half
lives, 1890) puis Lewis Hine (1874-1940), sociologue de formation devenu photographe, ou encore
Dorothea Lange (1895-1965), Margaret Bourke-White (1904-1971) et Walker Evans (1903-1975)
qui documentèrent tous trois la Grande dépression (crise de 1929) pour le compte de la Farm
Security Administration (programme du New Deal de Roosevelt, 1937-1943), la photographie
sociale joua un rôle déterminant dans les réformes sociales aux États-Unis en témoignant des
terribles conditions de vie et de travail des indigents et des immigrants, des ouvriers et des paysans,
des sans abris ou de l’exploitation du travail des enfants. Et, en Europe, dans un tout autre contexte,
le photographe allemand August Sander (1876-1964) inaugure la photographie documentaire en
proposant des portraits de types sociaux dès les années 1930.
Il faut par ailleurs constater qu’aux premiers temps de la sociologie, la photographie fut utilisée, mais
de manière très parcimonieuse et seulement à titre illustratif, pour rendre compte de certaines réalités
sociales moins bien connues de la bonne société et des classes moyennes dont étaient issus la plupart
des sociologues et leur public : c’est ainsi que Maurice Halbwachs s’en va photographier les taudis
de Paris en 1908, que Nels Anderson accompagne son livre sur les vagabonds (The Hobo, 1923) de
quelques photographies qui ne sont du reste pas commentées ni analysées dans le texte — tout
comme les photographies prises par Pierre Bourdieu en Algérie à l’occasion de ses premiers travaux
de jeune sociologue, par ailleurs conscrit de l’armée française durant cette période trouble et
douloureuse de la guerre d’Indépendance. Ce relatif discrédit de l’image dans la sociologie
1

universitaire est manifeste si l’on examine l’attitude de Bourdieu dont il aura quasiment fallu
attendre sa disparition, quelque 40 ans plus tard, pour que soient exhumées ces photos. On notera
que Bourdieu redoute par-dessus tout d’être pris pour un photographe et prend bien soin de préciser
que, pour lui, ces photos demeurent marginales et anecdotiques et n’ont eu en tout état de cause
aucune incidence sur ses recherches savantes. Cette défiance vis-à-vis de l’image (et de l’image qu’il
se fait de ceux qui font des images – les photographes et les cinéastes en l’occurrence) resurgit dans
le film de Pierre Carles, La sociologie est un sport de combat, lorsque Jean-Luc Godard l’invite à
collaborer sur un projet que Bourdieu remballe comme une simple facétie d’artiste à laquelle il fait
mine de ne rien comprendre. Et l’on ne peut s’empêcher de penser que celui qui fut le pourfendeur
de la télévision, accusée de brider la force de la pensée discursive à la suite de ses propres prestations
télévisées qui n’ont manifestement pas comblé ses attentes, redoutait peut-être cette fois la
concurrence de la caméra d’un cinéaste qui avait à plusieurs reprises manifesté des velléités
sociologiques (dans la plupart de ses films et très explicitement dans Masculin-féminin et dans 2 ou
3 choses que je sais d’elle). Le sentiment que Bourdieu concevait le rapport de la sociologie à
l’image sur le mode de la rivalité est encore conforté par le fait que, curieusement, ses préventions
à l’égard du cinéma ne l’empêchèrent pas de se livrer à la caméra docile de Pierre Carles qui lui
confectionna une parfaite hagiographie sans aspérités et sans danger.
Sans doute faut-il y voir un effet de ce que Bourdieu lui-même appelait un « habitus académique »
très français engoncé dans une tradition philosophique qui a toujours privilégié le document écrit,
qui célèbre le logos, la parole, et continue à juger les images trompeuses et superficielles, depuis
Platon en passant par Pascal et Rousseau et jusqu’aux critiques de tout poil de la « société du
spectacle » qui assimilent toute production d’images à une forme de manipulation médiatique (de
Guy Debord à Jean Baudrillard, Paul Virilio et autres prophètes apocalyptiques). Rappelons au
passage que Bourdieu était philosophe de formation. En effet, le rapport à l’image est tout autre chez
Howard Becker, formé dans la tradition sociologique de l’école de Chicago et qui milite depuis les
années 1970 pour l’usage de la photographie dans les sciences sociales (même si lui-même n’a guère
mis usé de la photographie dans ses propres travaux) et a activement contribué à la création de
l’International Visual Sociology Association (sans doute le fait qu’il soit lui-même musicien et que
sa compagne soit photographe n’y sont-ils pas pour rien). (Ceci étant, celui des deux qui aura le plus
utilisé la photographie dans ses travaux n’est pas forcément celui qu’on croit.)
C’est peut-être aussi pour se démarquer de la pratique du journalisme d’investigation et du
documentaire social qui servirent de modèle à la sociologie empirique, à l’instigation de Robert E.
Park (1864-1944), le fondateur de la première école de Chicago, que la sociologie prit ses distances
avec l’image, jugée sans doute en partie trop triviale, anecdotique et peu scientifique par les adeptes
de ce que le sociologue américain Wright-Mills appelait les sûpremes théories fonctionnalistes ou
structuralistes déconnectées de l’observation de la vie sociale ordinaire. Park exerça la profession de
journaliste avant d’entreprendre des études de psychologie et de philosophie qui le mènera en
Europe, notamment à Berlin où il fut l’élève de Georg Simmel qui lui transmettra sa fascination pour
le développement urbain et la figure de l’étranger. Il a donc derrière lui une longue carrière de
journaliste reporter lorsqu’en 1913, à 49 ans, il est engagé à l’Université de Chicago par William
Isaac Thomas (co-auteur avec Florian Znaniecki du Paysan polonais en Europe et en Amérique,
étude sociographique sur l’immigration polonaise). Une véritable école se constitue autour de Park
avec l’écologie humaine pour problématique commune et le tissu urbain pour champ de recherches
2

ou laboratoire commun, sans rupture avec le passé journalistique de Park. Pour lui, en effet, le
sociologue est « une espèce de super-reporter » dont le travail doit « nous permettre de comprendre
ce que nous lisons dans le journal ». À l’instar de son ancien professeur berlinois, Georg Simmel,
Park est fasciné par la vie urbaine, dont Chicago offrait un exemple particulièrement saisissant à
l’époque, par son rythme de croissance rapide, ses immigrants de toutes nationalités et ses truands –
dont le fameux Al Capone. Il lance ses étudiants « sur le terrain », afin qu’ils récoltent par entretiens,
observations, relevés cartographiques, des matériaux de première main. Cette méthode de collecte
d’informations, le fieldwork, est sans doute une des caractéristiques principales de l’école de
Chicago. L’université de Chicago possède ainsi, depuis les années 1920, le département le plus
dynamique et innovateur en sociologie : on y étudie, sur le terrain, la sociologie urbaine et, de
manière générale, on y attache une importance toute particulière aux manières de dire et de faire.
Park demeure par ailleurs fidèle à son passé militant (il fut le secrétaire de Booker Washington et de
son association de défense et de promotion des Noirs du Sud des États-Unis) et conjugue, tout
comme William Isaac Thomas, sa conception d’une sociologie de terrain avec un souci de témoigner
et de comprendre en regardant et en donnant à voir.
Ce qui ne fut pas le cas des anthropologues qui, dès le début, recoururent plus systématiquement à
ces appareils d’enregistrement, sans doute du fait que la réalité observée était plus éloignée, à tout
point de vue, pour l’observateur qui pouvait ainsi continuer à étudier son objet à son retour et
partager ses découvertes avec ses collègues, ses étudiants et ses lecteurs (Boas, Malinowski, Bateson
et Mead…). L’anthropologue entretient, du reste, un rapport plus naturel à l’endroit des documents
audiovisuels et plus décrispé à l’égard du narratif, comme l’atteste la pratique généralisée des
journaux tenus par les ethnologues voyageurs. Ainsi, dès 1925, Marcel Mauss introduisait dans ses
leçons d’ethnologie l’idée que le procédé photographique permet de collecter des données visuelles
et de mémoriser de multiples détails relatifs aux faits observés. Gregory Bateson manifestera pour
sa part, dans les dernières pages de La Cérémonie du Naven, paru en 1936, son souhait d’élaborer
des techniques adéquates de description et d’analyse de postures humaines, de gestes, de
l’intonation, du rire, etc. Il entreprendra ce programme dès l’année suivante, en partant à Bali avec
son épouse, l’anthropologue Margaret Mead, en 1937. C’est au cours de ces deux années de terrain
dans un petit village des montagnes de Bali que Bateson va mettre au point ces « techniques
adéquates de description et d’analyse » du comportement non verbal. Tandis que Margaret Mead
interroge, bavarde, prend note, Bateson filme et photographie. Il va ainsi prendre environ 25 000
photos au Leica et 7 000 m de pellicules à la caméra 16 mm ! La date et l’heure de chaque prise de
vue sont soigneusement notées afin de correspondre aux notes écrites de Mead. Bateson et Mead
retournent à New York en 1939. Ils choisissent et commentent 759 photographies qui constituent le
corps de Balinese Character : A Photographic Analysis, qui paraît en 1942. Il faudra attendre 1960
pour que le sociologue Edgar Morin propose à Jean Rouch de collaborer sur un film qui porterait cette
fois sur le société française de l’époque à partir d’un semblant de sondage d’opinion sur le thème du
bonheur, ce qui donnera naissance à Chronique d’un été qui marque en quelque sorte la naissance du
film sociologique. Mais lorsqu’en 1976, un sociologue, et non des moindres, Erving Goffman, publie
une étude intitulée « Gender Advertisements » qui traite des représentations sexuées dans la publicité
en s’appuyant sur l’analyse de 500 images, c’est encore dans une revue d’anthropologie qu’elle
paraîtra (Studies in the Anthropology of Visual Communication). Ceci explique du reste l’avance
considérable prise par l’anthropologie visuelle (qui a ses lettres de noblesse au sein même de la
discipline avec des ethnologues-photographes tels que Margaret Mead et Gregory Bateson, ou
3

cinéastes tels que Jean Rouch ou Luc de Heusch – même si Jean Rouch, tout comme Robert Flaherty
(1884-1951), le père du film documentaire, auteur du fameux Nanook l’Esquimau (1922) et adepte
du cinéma direct que pratiquera aussi Rouch qui en fera la méthode de l’anthropologie visuelle,
n’étaient à la base ni ethnologues ni cinéastes mais des ingénieurs en mission d’exploration – sur la
sociologie visuelle.
La création d’une chaire de sociologie visuelle à l’université demeure pourtant une rareté, sinon une
curiosité, dans le monde académique francophone qui a longtemps été indifférent, voire réfractaire
à l’usage des images dans le travail sociologique. Quelques initiatives isolées et sporadiques ont vu
le jour en France, entre 1987 et 1989, au sein d’un laboratoire du CNRS avant de sombrer corps et
biens mais la tenue du colloque international du comité de recherche en sociologie de l’art de
l’AISLF que j’ai organisé avec le réseau français Opus sur le thème du « sociologue et ses images »
à l’Institut de sociologie de l’ULB en octobre 2010 corrobore le regain d’intérêt pour la sociologie
visuelle dont témoigne la multitude de groupes de travail et de colloques consacrés à la sociologie
visuelle et filmique dans le monde francophone. La sociologie visuelle est en plein essor depuis une
vingtaine d’années et tend à rattraper le retard pris par rapport à l’anthropologie visuelle dont elle
est proche parente avec l’apparition, certes timide et clairsemée, de trop rares départements, de
laboratoires et de masters en sociologie visuelle – comme le masterpro « Image et société » orchestré
par le Centre Pierre Naville de l’Université d’Évry ou l’unité de sociologie visuelle du département
de sociologie à l’Université de Genève pour le monde francophone.
En Belgique, l’UCL propose un séminaire de socio-anthropologie audio-visuelle qui initie les
étudiants aux techniques audio-visuelles tandis que l’ULB propose depuis quelques années ce cours
de sociologie visuelle, que devrait venir compléter bientôt un cours d’anthropologie visuelle, mais
nous disposons pas pour l’heure des moyens techniques et financiers permettant de mettre à la
disposition des étudiants des enseignants et du matériel de prise de vue et de montage vidéo pour les
initier au documentaire et au film. À Bruxelles, seuls l’association SoundImageCulture (financée par
la Communauté flamande) ou le Centre vidéo bruxellois disposent d’équipes et de matériel
susceptibles d’assurer une telle formation. L’Université d’Anvers propose, pour sa part, une filière et
un groupe de recherche en « Visual Studies et Media Culture » et un séminaire payant de 10 jours
en été (les frais d’inscription s’élèvent quand même à 800 euros). Et certains sociologues n’hésitent
plus à franchir le pas en devenant eux-mêmes les producteurs de films sociologiques (comme
Monique Haicault du LEST/CNRS, pionnière dès les années 1980, ou Joyce Sebag et Jean-Pierre
Durand au Centre Pierre Naville), voire à passer avec armes et bagages du côté du cinéma. Cette
double pratique n’est du reste pas neuve puisque Luc de Heusch, éminent professeur d’anthropologie
structurale de notre université, était par ailleurs l’auteur de remarquables films sur l’art mais aussi
d’ethno-fiction cinématographique comme Les Gestes du repas (1958), qui décrit non sans humour,
le rapport de ses compatriotes avec les repas, toutes classes sociales confondues.
Dans le monde anglo-saxon, la sociologie visuelle est mieux implantée dans les départements de
sociologie et de communication et l’on y compte un bon nombre de départements de Visual Studies.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, comme le font remarquer les spécialistes anglo-saxons eux-mêmes,
la sociologie visuelle y reste malgré tout « marginalisée », écrit John Grady (« Becoming a Visual
Sociologist », Sociological Imagination, n° 38, 2001/ 1-2, p. 83), voire « complètement rejetée » par
la sociologie normale (ou paradigmatique, au sens de Kuhn), déclare Douglas Harper (« Visual
4

Sociology: Expanding Sociological Vision », loc. cit., p. 58), et le fait que la revue de l’Association
internationale de sociologie visuelle / International Visual Sociology Association (IVSA) ait été
débaptisée Visual Sociology pour s’appeler désormais Visual Studies est un signe clair du risque que
court la sociologie visuelle d’être happée puis digérée par les sciences de la communication au sens
large du terme.
Subsiste donc aujourd’hui une certaine confusion entre la sociologie visuelle, le reportage
photographique et le cinéma documentaire, comme le souligne le site universitaire français Melissa,
de l’École normale supérieure de Cachan, qui a organisé un concours de sociologie visuelle parrainé
par Bruno Latour : « L’image photographique est aujourd’hui encore peu utilisée comme matériau
de la recherche en sociologie. Certes, il est devenu très facile de prendre des photographies sur un
terrain de recherche et même de les publier. Mais rares sont encore les travaux qui donnent à l’image
un rôle argumentatif aussi important que celui conféré par exemple à un tableau de données ou à une
analyse d’entretien. La photographie est souvent cantonnée dans le rôle de simple illustration d’un
propos construit hors d’elle et sans elle. Pourtant, l’image photographique recèle des possibilités
argumentatives très importantes. Celles-ci ont été particulièrement exploitées dans la tradition du
documentaire social et du photojournalisme. Du fait du développement de ces formes de production
d’images photographiques, des thèmes proprement sociologiques comme la question de la
colonisation du monde vécu par la technique, les sous-cultures urbaines, l’immigration et le jeu sur
les identités qu’elle implique, la standardisation du travail humain, etc. sont devenus familiers dans
notre expérience visuelle. La démarche de la sociologie visuelle consiste donc à se placer au point
de jonction des deux traditions que sont, d’un côté, la sociologie et, de l’autre, la documentation
photographique. Il s’agit de proposer des usages sociologiques de l’image photographique, c’est-à-
dire un mode d’argumentation fondé sur l’image. (http://www.melissa.ens-cachan.fr/
rubrique.php3?id_rubrique=145) »
Cette proximité de méthode et d’objet entre sociologie visuelle et documentaire pose pourtant
question au sociologue, attaché à la fameuse « rupture épistémologique » censée garantir l’objectivité,
et partant la qualité scientifique de ses investigations. Le respect de la spécificité et de l’intégrité de
la démarche sociologique par rapport à la production de documentaires sociaux n’est toutefois pas une
exigence ridicule et cette question mérite qu’on s’y attache avant d’assimiler hâtivement la sociologie
visuelle à une forme de journalisme social. D’autant que la sociologie visuelle se trouve le plus
souvent reléguée dans les départements de communication et de cinéma, du simple fait qu’elle en
passe par un médium et une méthode visuelle qui n’a toujours pas sa place dans la plupart des
départements de sociologie. Suffit-il pour autant d’aborder des sujets sociaux, de montrer des tranches
de vie à la manière de l’émission « Strip-tease » ou de tourner des films « réalistes » avec des acteurs
non-professionnels pour leur garantir une vérité et une qualité sociologiques ? Bien sûr que non. La
question que se pose alors le sociologue qui se pique de travailler avec le médium de la photo ou du
film est la suivante : dans quelle mesure et à quelles conditions peut-on penser sociologiquement en
image et par l’image, sans se cantonner au simple commentaire journalistique ni réduire l’image à une
simple illustration de thèses sociologiques élaborées en amont suivant des règles classiques ? En
d’autres termes, y aurait-il moyen de dégager quelque chose comme des « règles de la méthode
sociologique » propres à la sociologie visuelle de manière à pouvoir ériger celle-ci en discipline à part
entière, ou faut-il plus modestement considérer que la sociologie visuelle ne serait qu’une panoplie
d’usages de l’image en sociologie qui nécessite quelques précautions particulières ?
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%