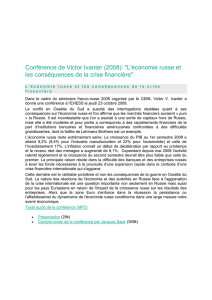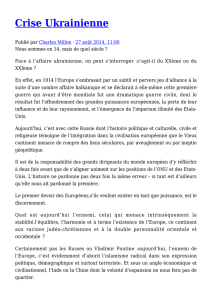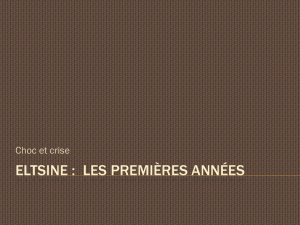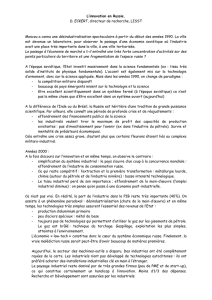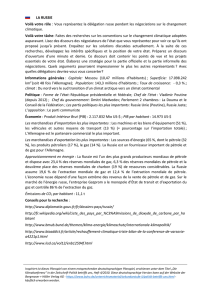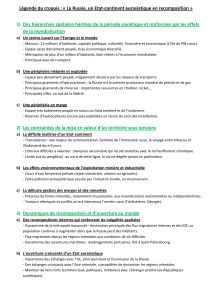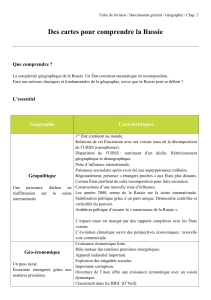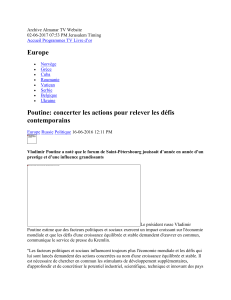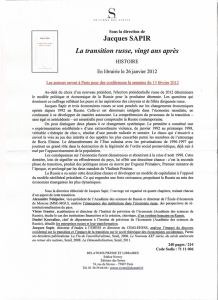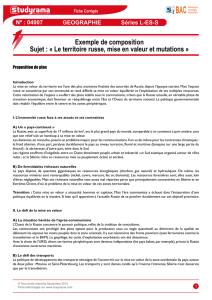La Russie de 1991 à nos jours

© Charles Larue – Les Yeux du Monde – 2015
Page 1/13
La Russie de 1991 à nos jours
Contenu :
Introduction : L’indépendance de la Fédération de Russie ..................................................................... 1
I- La Russie d’Eltsine : des débuts difficiles ............................................................................................. 2
A) L’échec de la thérapie de choc et du virage libéral ........................................................................ 2
B) Un repli sur ses propres conflits internes ....................................................................................... 3
C) Un niveau de vie en baisse manifeste ............................................................................................. 4
II- Sous Poutine, vers un nouveau départ ?............................................................................................. 5
A) Une expansion économique remarquable ..................................................................................... 5
B) Un retour sur la scène internationale, mais tensions persistantes au sein de l’ex-URSS ............... 6
C) Un Etat-providence limité et une démocratie remise en cause : la Russie, Etat non-occidental ... 7
III- Un retour en force sur la scène internationale .................................................................................. 8
A) Une politique d’expansion à nouveau clairement visible ............................................................... 8
B) Un nouveau statut sur la scène internationale et la construction d’un bloc eurasiatique ............. 9
C) L’économie russe, d’une crise à l’autre......................................................................................... 10
Conclusion : Une situation économique toujours instable, un retour en force sur l’échiquier mondial
............................................................................................................................................................... 11
A retenir ................................................................................................................................................. 11
Personnages clés : ............................................................................................................................. 11
Chronologie synthétique : ................................................................................................................. 12
Pour approfondir… ................................................................................................................................ 12
A) Le semibankirchtchina ou les « sept banquiers » ......................................................................... 12
B) Gazprom ........................................................................................................................................ 13
Introduction : L’indépendance de la Fédération de Russie
Malgré les réformes engagées à la fin des années 1980 par Gorbatchev, l’URSS connaît de
profondes difficultés économiques au tournant des années 1990. Globalement, la situation
économique de l’URSS continue de s’aggraver au travers de lourds déficits, d’un
endettement croissant vis-à-vis de l’extérieur et de la hausse de l’inflation. D’autre part,
l’URSS connaît en son sein des dissensions de plus en plus manifestes sur le plan politique :
en 1990, toutes les Républiques, y compris la Russie, proclament leur souveraineté. En effet,
la Russie est elle aussi hostile au système fédéral car ce sont en réalité deux hommes qui
s’affrontent, Boris Eltsine pour la Russie et Mikhaïl Gorbatchev pour l’URSS.

© Charles Larue – Les Yeux du Monde – 2015
Page 2/13
Eltsine, élu Président du Soviet suprême de la République socialiste fédérative soviétique de
Russie le 29 mai 1990, proclame le lendemain de son élection que la Russie sera
indépendante avant 100 jours. Beaucoup de Russes sont favorables à l’indépendance et
estiment que les autres Républiques vivent au crochet de la Russie. Gorbatchev souhaite
quant à lui contrer ces velléités sécessionnistes, et forme le projet d’une nouvelle
constitution soviétique qui offrirait plus d’autonomie pour les Républiques. Il mène alors une
course contre la montre face à la montée de ces revendications indépendantistes, mais
l’opposition conservatrice réalise un putsch le 19 août 1991 pour empêcher la signature de
ce nouveau traité d’Union. Gorbatchev, déclaré inapte à tenir son poste, est remplacé par
Guennadi Ianaïev, un conservateur qui était devenu vice-président grâce à lui.
Cependant, Boris Eltsine, élu Président de Russie le 12 juin 1991, s’oppose à ce putsch et
apparaît comme un sauveur. Les putschistes abandonnent leur action et Eltsine sort en
grand vainqueur de cet épisode, tandis que Gorbatchev est affaibli politiquement. Dès lors,
le Parti Communiste de l’Union Soviétique est rapidement dissout et, le 8 décembre, la
Russie, l’Ukraine et la Biélorussie signent le traité de Minsk qui crée la Communauté des
Etats Indépendants (CEI), proclamant également l’obsolescence de l’URSS. En décembre
1991, Gorbatchev démissionne lors d’un discours le 25 décembre et l’URSS est officiellement
dissoute.
I- La Russie d’Eltsine : des débuts difficiles
A) L’échec de la thérapie de choc et du virage libéral
Boris Eltsine, plutôt que de sauver le système économique hérité de l’URSS, décide de le
détruire, son but étant de mettre en place des réformes dures mais rapides : « la thérapie de
choc ». Aidés d’économistes, tels qu’Egor Gaïdar, il entreprend rapidement le passage à
l’économie de marché, inspiré de la fameuse « école de Chicago », ce qui permet à la Russie
de rejoindre les grandes instances internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds
Monétaire International (FMI) en 1992. Les réformes prévoient alors, avec l’aide du FMI, la
libéralisation des prix et des importations tout en contenant l’inflation, une politique
monétaire stricte, l’élimination du déficit budgétaire et la privatisation des entreprises
d’Etat, mesures à l’origine d’une contestation importante. Un environnement économique
propice est également mis en place, via des lois sur la faillite (1993) ou l’adoption d’un Code
civil (1995-1996), mais leur application reste difficile.
Afin de privatiser l’appareil de production, les citoyens russes se voient remettre un coupon
qu’ils peuvent utiliser pour acheter une part d’entreprise ou tout simplement vendre. Entre
1992 et 1994, plus de 15 000 entreprises sont ainsi privatisées auprès de quarante millions
de Russes, malgré le fait que la rapidité de ce processus ait empêché beaucoup d’entre eux
de comprendre et de participer. Les entreprises les plus importantes, notamment dans les
secteurs miniers et énergétiques, ne sont quant à elles pas concernées. Mais en 1995, les
problèmes économiques de l’Etat le poussent à accepter un prêt des grandes banques russes
en échange du contrôle de ces grandes entreprises. Ce pacte permet l’émergence des « sept
banquiers » (voir « Pour approfondir… »), un groupe d’oligarques contrôlant la quasi-totalité
de l’économie et de la vie médiatique russe. Elle permet en outre à Boris Eltsine de s’assurer
le soutien des oligarques russes face à Guennadi Ziouganov, candidat communiste à la

© Charles Larue – Les Yeux du Monde – 2015
Page 3/13
présidentielle de 1996, première élection démocratique dans l’histoire russe post-soviétique.
Si ce dernier est largement en tête dans les sondages, Eltsine profite de l’aide économique
extérieure pour sa campagne et s’assure le soutien des médias et des autres candidats lors
du second tour pour l’emporter avec 53% des votes. Néanmoins, aujourd’hui encore, l’issue
de cette élection est controversée, des fraudes massives étant suspectées ou, dans certains
cas, avérées.
Durant la décennie, de nombreux problèmes économiques secouent la Russie. Tout d’abord,
le Rouble, monnaie héritée de l’URSS : si celle-ci ne peut être qu’imprimée par la Banque
centrale de Russie, les autres Etats de l’ancienne URSS peuvent continuer à délivrer des
crédits. La Russie n’a donc pas complètement le contrôle de sa monnaie, jusqu’à la création
du Rouble russe en juillet 1993. Dans le même temps, le troc, courant durant la période
soviétique, se développe particulièrement, empêchant les entreprises de payer leurs salariés
et l’Etat de collecter l’impôt. L’impôt, justement, consiste en une multitude de taxes qui,
additionnées entre elles, peuvent dépasser 100% des revenus des entreprises, d’où des
fraudes importantes, tandis que la plupart des particuliers refusent de payer un impôt sur les
revenus. Cette difficulté à faire entrer l’impôt rend alors difficile l’accomplissement des
obligations budgétaires russes. Ainsi, en 1998, un an après la crise asiatique, la Russie entre à
son tour en crise : le 17 août, le Premier ministre Sergueï Kirienko dévalue le Rouble de 34%
tout en demandant un moratoire pour payer ses dettes étrangères. Le Rouble est alors
considéré comme surévalué et la dette trop importante, notamment à court-terme.
Rapidement, l’économie russe sombre, la bourse russe décline de 90% entre 1997 et l’été
1998, et le chômage explose.
B) Un repli sur ses propres conflits internes
Contrairement à l’URSS, superpuissance au même titre que les Etats-Unis jusqu’à la fin des
années 1980, la Russie n’a pas, dans les années 1990, les moyens de rivaliser au plan
géopolitique sur la scène internationale. Certes, elle récupère le siège permanent de l’URSS
au Conseil de Sécurité de l’ONU ainsi que la majeure partie des infrastructures et
équipements militaires hérités de l’Union Soviétique. Mais ceux-ci sont vieillissants et ne
peuvent être remplacés du fait des difficultés économiques de l’Etat. La préoccupation
première de la Russie réside plutôt en l’établissement et la sécurisation de son propre
territoire, issu de l’éclatement de l’Union Soviétique. Mais la réalisation de son unité
territoriale est rendue difficile par les velléités indépendantistes de certains peuples, en
particulier dans la région du Caucase. Ainsi, un conflit en Ossétie du Nord entre Ingouches et
Ossètes éclate en 1992. En parallèle, de l’autre côté de la frontière, l’Ossétie du Sud déclare
son indépendance vis-à-vis de la Géorgie, tout en souhaitant se réunifier avec l’Ossétie du
Nord, située en Russie. La Première guerre d’Ossétie du Sud commence ainsi en 1991,
voyant s’affronter la Géorgie aux Ossètes du Sud, appuyés par l’Ossétie du Nord et la Russie.
En juin 1992, la Géorgie et la Russie signent finalement un traité rappelant l’intangibilité des
frontières de l’Etat de Géorgie. Une autre région sécessionniste, l’Abkhazie, pose par ailleurs
problème à la Géorgie : une guerre de six jours, la Guerre d’Abkhazie, éclate d’ailleurs en
1998. L’Arménie et l’Azerbaïdjan se disputent dès 1992 autour de la province du Haut-
Karabagh. En 1992, un différend entre l’Ukraine et la Russie apparait aussi concernant la
Crimée, finalement reconnue comme étant ukrainienne en 1997 par le Kremlin en échange
d’un bail accordé à l’armée russe concernant la base navale de Sébastopol. Cette instabilité

© Charles Larue – Les Yeux du Monde – 2015
Page 4/13
aux portes de la Russie met régulièrement Moscou en alerte. En outre, la Russie fait face à la
défiance des pays membres du GUAM, une organisation formalisée en 2001 et qui réunit la
Géorgie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldavie. Ces pays cherchent à se soustraire à
l’influence de Moscou et à se rapprocher de l’Occident (OTAN et Union Européenne).
Surtout, dès 1991, la Tchétchénie, petit territoire situé dans le Caucase, déclare son
indépendance par la voix de son leader, Djokhar Doudaïev. Ne parvenant pas à faire fléchir
ces volontés sécessionnistes, Boris Eltsine décide par surprise l’envoi de 30 000 soldats dans
la région tchétchène en décembre 1994. Cette intervention, la première de cette importance
pour la Fédération de Russie, doit être une démonstration de force pour cette nouvelle
Russie dont la Tchétchénie semble alors n’être qu’un petit caillou dans sa chaussure.
Pourtant, cette opération s’avère extrêmement piégeuse et tourne à l’échec militaire pour
Moscou qui fait face à l’abnégation sans borne des Tchétchènes. Après avoir fait des dizaines
de milliers de morts, essentiellement des civils, et n’ayant pu prendre durablement le
contrôle de Grozny, la Russie, vaincue, négocie un cessez-le-feu et retire ses troupes : mais
aucune indépendance n’est alors prévue. En 1999, des séparatistes tchétchènes envahissent
le Daguestan, région appartenant à la Fédération de Russie située entre la Tchétchénie et la
Mer Caspienne. Moscou est au même moment confrontée à une vague d’attentats à
l’origine de centaines de morts et attribuée aux indépendantistes tchétchènes. En
représailles, le Kremlin s’engage dans un nouveau conflit armé en Tchétchénie face aux
indépendantistes, guidés par Aslan Maskhadov, ce qui aboutit à la restauration du contrôle
russe sur le territoire en 2000, sans pour autant mettre fin aux actes de guérillas de la part
des moudjahidines caucasiens.
C) Un niveau de vie en baisse manifeste
Durant les années 1990, le niveau de vie des Russes recule fortement. Le chamboulement
social dû à la « thérapie de choc » a des conséquences directes sur la société, entrainant
notamment la hausse du chômage (inexistant sous l’ère soviétique), mais aussi de nombreux
suicides, la multiplication des cas d’alcoolisme, des violences, etc. En outre, le système de
santé n’est plus en mesure d’assurer la qualité de service d’autrefois. Les structures et
équipements vieillissent et deviennent obsolètes, la production de traitements devient
insuffisante. Des maladies telles que l’hépatite B, la tuberculose ou même le VIH gagnent en
importance. Le taux de mortalité, qui dépasse même les 16‰ à partir de 2002, est le double
de celui des Etats-Unis ou de la France. En conséquence, l’espérance de vie décline passant
de 69,5 ans en 1988 à 64,5 six ans plus tard, son niveau le plus bas. En 2005, l’espérance de
vie d’un homme tombe même en-dessous de 59 ans. Ainsi, cette espérance de vie connaît
un écart de plus de dix ans entre hommes et femmes dans les années 1990, un des écarts les
plus importants au monde.
Dans le même temps, le taux de natalité décline de plus de moitié (passant de 17,2‰ en
1987 à 8,3‰ en 1999) en raison du malaise profond né de la fin du communisme et de la
morosité dans lequel le pays se trouve. Le nombre de naissances en Russie est par ailleurs
divisé par deux entre 1987 et 1999, atteignant 1,2 million de naissances à l’aube du XXIème
siècle. Le nombre de décès atteint quant à lui un pic en 1994, avec 2,2 millions d’âmes
perdues. Si l’immigration aide dans un premier temps à infléchir l’évolution négative de la
démographie, cela ne dure qu’un temps puisque le retour des Russes au pays intervient

© Charles Larue – Les Yeux du Monde – 2015
Page 5/13
surtout les premières années après la chute du bloc soviétique. En outre, ces évolutions
entrainent le vieillissement de la population russe. Au final, symbole du déclin russe, la
population décline chaque année entre 1996 et 2009, passant cette année-là sous les 142
millions. Avec les problèmes économiques des années 1990, de nombreux services publics,
tels que la santé ou l’éducation, font face à une baisse de moyens significative. Au
changement de millénaire, le pays compte environ 30% de sa population en-dessous du seuil
de pauvreté. Et avec un Indice de Développement Humain (IDH) descendu à 0,675 en 1995,
la Russie connaît un réel déclin et ne peut être considéré comme un pays développé.
Face à son échec sur le plan économique et une société en pleine crise, Boris Eltsine renonce
à son poste le 31 décembre 1999 : pour renouveler une classe dirigeante vieillissante, il
nomme Vladimir Poutine (déjà devenu Premier Ministre en août 1999) pour le remplacer
jusqu’aux élections de mars 2000 au cours desquelles ce dernier sera élu avec l’appui de
Boris Eltsine et 53% des votes dès le premier tour.
II- Sous Poutine, vers un nouveau départ ?
A) Une expansion économique remarquable
Ancien haut dignitaire du KGB, Vladimir Poutine est pourtant peu connu jusqu’en 1999. Sa
fulgurante ascension, associée à ses relations étroites avec les oligarques, lui permet de
mettre la main sur le Kremlin. Vladimir Poutine met en œuvre une politique de nationalisme
économique qui marque un retour de l’Etat au premier plan, tout en dérégulant l’économie
afin de réduire la bureaucratie. On peut alors définir l’économie russe comme un capitalisme
d’Etat autoritaire et oligopolistique.
Suite à la crise de 1998, la Russie demande l’aide du FMI car elle est victime de la chute du
prix du baril qui est d’environ 40% en 1998. L’appauvrissement de la population est
catastrophique mais la situation semble s’améliorer à partir de 1999. La Russie voit sa
croissance repartir avec des taux de croissance de 6,5% et 10% respectivement en 1999 et
2000. Entre 1999 et 2007, le taux moyen de croissance annuelle en Russie est de l’ordre de
7%. Cela est lié au commerce extérieur russe qui s’améliore puisque la balance commerciale
devient excédentaire, portée par la chute du nouveau rouble qui favorise les exportations et
limite les importations qui deviennent plus chères. La santé des entreprises russes
s’améliore, tandis que la hausse des prix du pétrole et du gaz à partir de 2002 permet
d’enregistrer des excédents commerciaux et de réduire la dette publique, d’autant que
Poutine simplifie la fiscalité en instaurant à partir de 2001 un taux unique qui est de 13% afin
d’éviter l’évasion fiscale. De même, Poutine impose un impôt à taux unique sur les
entreprises de 24%, contre 35% auparavant.
On estime que la Russie possède, au milieu des années 2000, une classe moyenne qui
représente 20% de la population. En 2007, la Russie retrouve le PIB par habitant qu’elle avait
en 1991. Elle a par ailleurs profité d’une croissance solide pour réduire sa dette publique.
Vladimir Poutine tire de ces bons résultats économiques, qui se répercutent par une
augmentation du niveau de vie de la population, une popularité grandissante. Mais le pays
reste très dépendant des cours du pétrole et du gaz, et la chute de ceux-ci en 2008 font
plonger le rouble et freinent l’économie russe, encore trop peu diversifiée. En effet,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%