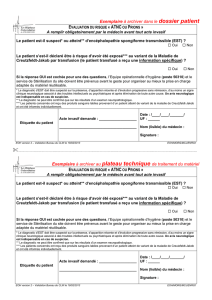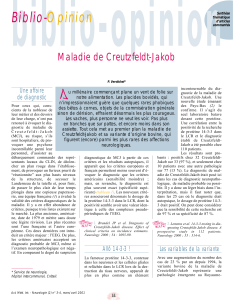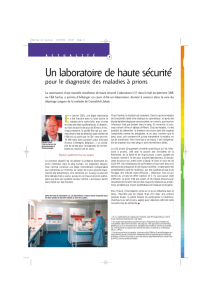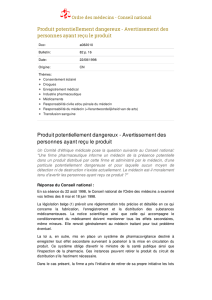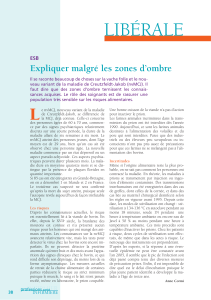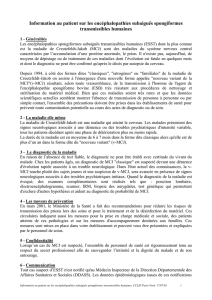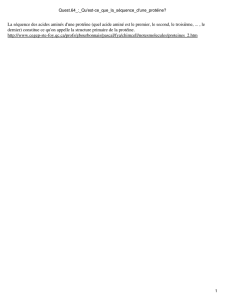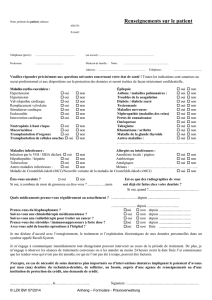Diagnostic et transmission des maladies à prions

curriculum
Forum Med Suisse 2011 ;11(41):713–717 713
Diagnostic et transmission des maladies à prions
Simon Junga, Matthias Sturzeneggera, Christian Schärerb, Ingeborg Fischerc, Ekkehardt Altpeterd
a Service de neurologie, Hôpital de l’Ile, Hôpital universitaire et Université de Berne, Berne
b Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, Services d’inspection, Berne
c Hôpital universitaire de Zurich, Département de neuropathologie, Zurich
d Ofce fédéral de la santé publique, section Surveillance et évaluation épidémiologiques, Berne
Contexte
Les maladies à prions ou encéphalopathies spongiformes
transmissibles (EST) sont des maladies provoquées
par des prions (particules protéiques infectieuses), non
curables et toujours fatales. Chez l’homme, elles se
p résentent sous trois formes: familiale, sporadique et
acquise.
Les formes familiales sont la maladie de Creutzfeldt-
Jakob familiale (fMCJ), l’insomnie fatale familiale (IFF)
et le syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker
(GSS).
La forme la plus fréquente est la forme sporadique de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob (sMCJ).
La nouvelle variante (vMCJ) et la forme iatrogène de
MCJ (iMCJ) comptent parmi les maladies à prions ac-
quises. La transmission des prions se fait de l’homme
ou de l’animal à l’homme dans la iMCJ, et de bœufs at-
teints d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à
l’homme, par voie intestinale, dans la vMCJ. En raison
de la transmissibilité, la déclaration des cas cliniques
suspects est obligatoire, an que des mesures de pro-
tection de la population puissent être prises. Le diag-
nostic précoce est donc important pour la personne tou-
chée et ses proches, mais il présente aussi un intérêt
général.
Evolution clinique
MCJ sporadique, iatrogène et familiale
Avec 1 à 2 cas par an pour 1 million d’habitants, la
sMCJ est la forme la plus fréquente. Elle survient prin-
cipalement chez les personnes d’un certain âge (65 ans
en moyenne) et se distingue des autres démences par
une évolution rapide (durée: 4,5 à 7 mois). Même si
toutes les zones cérébrales peuvent nalement être tou-
chées et que par conséquent les symptômes possibles
sont très variés, ceux-ci sont plus ou moins fréquents et
dépendent du stade de la maladie (voir tab. 1 p). Les
différences génotypiques sur le codon 129 de la pro-
téine prionique entraînent une variabilité supplémen-
taire. La iMCJ (hormis les cas de vMCJ) et la fMCJ ne se
distinguent pas de la sMCJ pour ce qui est de la clinique
et de l’évolution.
Variante de la MCJ
A la différence de la sMCJ, la vMCJ est une forme rare,
qui se manifeste surtout chez les jeunes adultes (28 ans
en moyenne). L’ évolution, un peu plus longue (14 mois),
commence typiquement par des symptômes psychia-
triques (dépression, angoisses, apathie, délire, etc.) ou
des troubles de la sensibilité (généralement sous forme
de dysesthésies douloureuses des extrémités). Le tableau
se rapproche de celui de la sMCJ au bout de quelques
mois.
Examens complémentaires
Electroencéphalogramme (EEG)
L’ EEG conrme le diagnostic de sMCJ quand il montre
des complexes d’ondes périodiques biphasiques ou tri-
phasiques [1], bien que cette preuve ne soit pas spéci-
que [2]. Dans la vMCJ, l’EEG ne présente le plus sou-
vent que des modications générales non spéciques.
Liquide céphalo-rachidien
Les paramètres de routine (nombre de cellules, pro-
téines, glucose) sont habituellement normaux. L’ éléva-
tion des protéines 14-3-3, tau et S100b ainsi que de
l’énolase neurone-spécique est caractéristique de la
sMCJ [3, 4], mais elle n’est pas non plus spécique; elle
reète avant tout la lyse neuronale. Dans un travail ac-
tuel sur la valeur des analyses du LCR dans la sMCJ, la
sensibilité était de 86% pour la protéine 14-3-3, de 81%
pour la protéine tau et de 65% pour la protéine S100b
[4]. En tant que marqueur plus singulier, la protéine 14-
3-3 présente donc la sensibilité la plus élevée, sensibi-
Quintessence
P Les encéphalopathies spongiformes transmissibles constituent un
groupe hétérogène de maladies ayant pour corrélat pathologique com-
mun les prions.
P En Suisse, la maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique est la forme la
plus fréquente; la nouvelle variante n’a encore jamais été observée.
P Les prions sont transmissibles, principalement par les produits san-
guins, les transplants tissulaires et le matériel chirurgical.
P Le diagnostic de suspicion d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob est
posé, chez un sujet vivant, à partir du tableau clinique typique d’une part
et de l’IRM cérébrale, de l’analyse du liquide céphalo-rachidien et de
l’EEG d’autre part.
P La déclaration obligatoire des cas cliniques suspects permet de
prendre des mesures pour protéger la population et de vérier leur ef-
cacité. Les principales mesures sont le contrôle et le rappel des produits
sanguins ainsi que l’évaluation des techniques de stérilisation.

curriculum
Forum Med Suisse 2011 ;11(41):713–717 714
lité qui semble augmenter au fur et à mesure que la ma-
ladie évolue. Mais la spécicité est plus haute pour la
protéine tau (74 vs 84%). La valeur prédictive p ositive
est plus élevée quand soit la protéine 14-3-3 et la
S100b, soit la protéine tau et la S100b sont élevées si-
multanément que quand seule la protéine 14-3-3 est
élevée. La négativité à la fois de la protéine S100b et de
la protéine 14-3-3 peut constituer un argument contre
la présence d’une sMCJ, mais ne peut pas non plus être
considérée comme un critère d’exclusion absolu. Des
résultats faiblement négatifs sont moins signicatifs.
Dans la série de Chohan et al., moins de la moitié des
patients ayant des résultats faiblement positifs pré-
sentaient réellement une sMCJ [4]. La répétition des
analyses au cours de la maladie s’impose donc dans de
tels cas.
Dans la vMCJD, l’IFF et la GSS, ainsi que dans la sMCJ
avec des symptômes atypiques, la sensibilité de cette
élévation des protéines est nettement plus faible.
Imagerie par résonance magnétique (IRM)
Typiquement, l’IRM cérébrale montre, en cas de sMCJ,
des hypersignaux au niveau des ganglions de la base
(notamment le noyau caudé et le putamen) et/ou des
faisceaux de la substance grise dans la séquence pon-
dérée en T2, la séquence FLAIR (uid-attenuated in-
version recovery) et la séquence pondérée en diffusion
(DWI) [5]. Les signes les plus précoces se trouvent dans
la séquence DWI (g. 1 x). A un stade évolué, la
m aladie s’accompagne d’une atrophie cérébrale géné-
ralisée.
Dans la vMCJ, à la différence de la sMCJ, ces hyper-
signaux s’observent surtout au niveau du thalamus
p ostérieur («signe du pulvinar»).
Diagnostic
A l’heure actuelle, le seul moyen de poser un diagnostic
plus sûr, en dehors de l’examen post mortem, est la
biopsie cérébrale, bien qu’un résultat négatif n’exclue
pas l’hypothèse de MCJ (risque d’erreur d’échantillon-
nage). Chez un patient vivant, le diagnostic de MCJ
vraisemblable ou possible repose sur l’association de
l’anamnèse, de la clinique et des examens complémen-
taires. Cette approche multimodale est décisive, car au-
cun examen complémentaire n’est sufsamment signi-
catif à lui seul pour poser un diagnostic; de manière
générale, c’est la clinique qui est au premier plan. Le
tableau 2 p récapitule la sensibilité et la spécicité des
examens complémentaires déterminées par différentes
études.
Un autre élément à prendre en compte est la génétique
de la protéine prionique, car la sensibilité des examens
complémentaires varie selon le sous-type de polymor-
phisme du codon 129 [6].
Diagnostic neuropathologique
Le diagnostic de maladie de Creutzfeldt-Jakob peut être
conrmé par l’histologie, l’immunohistochimie et les
ana lyses par immunotransfert (western-blot) de tissu
cérébral prélevé par biopsie ou post mortem.
La triade histologique caractéristique comprend la spon-
giose, la perte neuronale et la gliose réactive (g. 2 x).
Critères diagnostiques de la sMCJ
Actuellement, les critères diagnostiques retenus par
l ’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la sMCJ
[7] ne comportent pas encore les résultats de l’IRM (voir
tab. 3 p, consultable uniquement en ligne). Mais une
commission internationale a proposé récemment leur
ajout parmi les critères actuels [8]. Des hypersignaux
Ta bleau 1. Maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique. Fréquence
des symptômes cliniques au début de la maladie et à un stade
avancé (tiré de [13]).
Au début A un stade avancé
Ta bleau 2. Sensibilité et spécicité des examens complé-
mentaires dans la sMCJ selon différentes études. Intervalle
indiqué entre parenthèses (tiré de [12]).
Te st Sensibilité (%) Spécicité (%)
Figure 1
(A) (B)
AB

curriculum
Forum Med Suisse 2011 ;11(41):713–717 715
dans la séquence pondérée en diffusion ou la séquence
FLAIR au niveau soit du noyau caudé et du putamen soit
d’au moins deux aires corticales (temporales, pariétales
ou occipitales) sont considérés comme caractéristiques
de la sMCJ. La prise en compte de l’IRM dans les critères
diagnostiques peut faire passer la sensibilité de 91,9 à
98,8%, sans pour autant inuer sur la spécicité (71,2 vs
70,8%). Dans ce travail, l’IRM seule présentait une sen-
sibilité de 83% pour une spécicité de 83% [8]. Les va-
leurs correspondantes étaient 86 et 68% pour la protéine
14-3-3, et 44 et 92% pour l’EEG.
Critères diagnostiques de la vMCJ
Les critères diagnostiques de la vMCJ dénis par l’OMS
gurent au tableau 3.
Diagnostic différentiel
La question du diagnostic différentiel de la sMCJ et
de la vMCJ se pose principalement avec les encé-
phalopathies métaboliques, toxiques (surtout alcool:
syndrome de Wernicke-Korsakoff), infectieuses et in-
ammatoires (y compris artériopathiques et paranéo-
plasiques), mais aussi avec les maladies neurodégéné-
ratives (notamment maladie d’Alzheimer, démence à
corps de Lewy, maladie de Parkinson, dégénérescence
cortico-basale, démences fronto-temporales, démences
vasculaires, chorée de Huntington et atrophie plurisys-
témique).
Maladie de Creutzfeldt-Jakob iatrogène
et transmissibilité
Des cas de transmission iatrogènes ont été décrits chez
l’homme aussi bien pour la sMCJ que pour la vMCJ.
Théoriquement, la transmission est possible aussi pour
l’IFF, la GSS et la fMCJ.
D’après les analyses in vivo et in vitro réalisées
jusqu’ici, toutes les voies de contamination semblent
possibles pour les prions, à l’exception de la voie respi-
ratoire et de la voie sexuelle.
Ta bleau 3. Critères de l’OMS pour le diagnostic de la sMCJ [7]
et de la vMCJ [14].
sMCJ
3 sMCJ probable:
3 sMCJ possible:
vMCJ
3vMCJ probable:
3vMCJ possible:
Figure 2
Ax
Bx
C
ABC

curriculum
Forum Med Suisse 2011 ;11(41):713–717 716
Dans la plupart des cas décrits, la transmission a été
rapportée à des greffes de dure-mère ou à l’utilisation
d’extraits d’hypophyse humaine (hormone de crois-
sance et gonadotrophine); dans d’autres cas, il s’agissait
de greffes de cornée, de transfusions de sang et de
l’usage d’électrodes EEG stéréotaxiques [9]. Aucune
conclusion dénitive n’est possible pour le risque de
transmission par des instruments chirurgicaux. Les cas
comme ceux des deux patients ayant contracté une MCJ
en Suisse en 1977 après l’implantation d’électrodes
EEG précédemment implantées chez un patient atteint
de sMCJ font penser que le risque est élevé (les élec-
trodes avaient été stérilisées avec un mélange à 70%
d’alcool et de formaldéhyde; après 18 mois encore, l’une
d’entre elles a inoculé une MCJ à un chimpanzé) [10].
Toutefois, des travaux plus récents font douter du risque
d’infection élevé lié à du matériel chirurgical [11].
Jusqu’ici, la transmission hématogène n’a été observée
que pour la vMCJ, mais elle est théoriquement possible
aussi pour la sMCJ. L’ analyse des cas de vMCJ a mon-
tré que la contamination par des transfusions du sang
d’un patient contaminé peut avoir eu lieu au moins
trois ans avant la manifestation clinique de la maladie
[9]. Le temps d’incubation d’une vMCJ est moitié moins
long lors d’une contamination par voie sanguine que
pour une infection par la voie intestinale ordinaire [12].
En résumé, le risque de transmission iatrogène d’une
MCJ est surtout lié aux produits sanguins, aux trans-
plantations et aux opérations. Pour minimiser ce risque,
il est important de prendre des mesures préventives
telles que choisir soigneusement les donneurs de sang
et de transplants, contrôler les procédés de fabrication
des produits sanguins et améliorer les techniques de
stérilisation pour les interventions chirurgicales.
La situation en Suisse (au 27 janvier 2011)
En Suisse, tout cas clinique suspect doit être déclaré
(site de l’Ofce fédéral de la santé publique, OFSP) de fa-
çon qu’il soit possible de prendre des mesures, par ex.,
pour établir si la personne a donné son sang dans le
passé: si c’est le cas, une procédure de recherche (look-
back) est lancée et les produits sanguins issus de ce
donneur sont contrôlés. Si le patient n’est pas suspect
de vMCJ, le fabricant doit, pour les produits stables,
évaluer les risques an de décider s’il laisse le lot sur le
marché. En cas de suspicion de vMCJ, il est tenu de re-
tirer tous les lots concernés. Si la personne a subi une
intervention chirurgicale, le service du médecin canto-
nal doit vérier les techniques de stérilisation. La re-
cherche d’une activité passée de donneur de sang et des
produits sanguins est organisée comme suit: l’OFSP in-
forme Swissmedic, l’Institut suisse des produits théra-
peutiques. Celui-ci informe le Service de transfusion
sanguine (CRS), qui représente le Centre national de ré-
férence pour les infections transmises par le sang et
ses dérivés (CNR). Le CRS Berne coordonne, au sein du
centre de transfusion, la recherche des éventuels dons
de sang du patient, rappelle les produits sanguins
concernés et informe Swissmedic des mesures prises.
Les fabricants de produits sanguins stables, de leur
côté, évaluent les risques et prennent les mesures qui
s’imposent.
Durant la période 2008 à 2010, 69 cas suspects de MCJ
ont été déclarés. La recherche de dons de sang a été faite
via le CNR pour 58 d’entre eux (g. 3 x) et celle des pro-
duits sanguins lancée dans 9 cas (16%). Les recherches
e ffectuées en 2008 et 2009 ont permis de constater
une activité de donneur
chez 6 patients, avec
104 dons concernés
entre 1989 et 2006. Au
total, la procédure a
permis d’identier 57 conserves de sang qui avaient été
livrées en vue de transfusions à d’autres patients ou uti-
lisées pour la transformation industrielle en produits
sanguins. La collecte des données pour 2010 n’est pas
encore terminée. Dans la période étudiée, aucun lot de
produits sanguins stables n’a dû être retiré du marché
suisse pour les raisons citées ci-dessus.
Le diagnostic clinique et/ou autopsique de MCJ a été
posé dans 43 cas. Pour 95% d’entre eux (41/43), il
s’agissait d’une forme sporadique. Durant la période
étudiée, la cause suspectée a été une transfusion de
sang dans un cas et une intervention chirurgicale dans
27 cas; aucune forme iatrogène avec une preuve nette
de la chaîne de transmission n’a été observée et aucun
cas de vMCJ, d’IFF ou de GSS n’a été enregistré en
Suisse.
Le Centre national de référence pour les maladies à
prions, l’Institut de neuropathologie de l’Université de
Zurich, effectue les analyses neuropathologiques sur
mandat de l’OFSP. Il est recommandé de lui coner les
autopsies ou au moins de lui envoyer les biopsies céré-
brales.
Résumé et commentaire
Les maladies à prions sont des maladies rares, non
curables et potentiellement transmissibles. Le diagnos-
tic de suspicion peut être posé, chez le sujet vivant, par
Figure 3
En Suisse, tout cas clinique
suspect doit être déclaré

curriculum
Forum Med Suisse 2011 ;11(41):713–717 717
des méthodes non invasives, à savoir la clinique et des
examens complémentaires, les résultats de ces derniers
devant faire l’objet d’une interprétation critique en lien
avec le tableau clinique et l’évolution. Pour réduire le
risque de transmission, il est important de prendre des
mesures respectant le principe de précaution, par ex.,
choisir soigneusement les donneurs de sang et de
transplants et garantir la traçabilité, ainsi que valider
les procédés de fabrication des produits sanguins et les
techniques de stérilisation. De ce fait, tout cas suspect
doit être déclaré. Les mesures prises à la suite d’une
d éclaration pour protéger la population concernent
n otamment, outre les interdictions et les prescriptions
dans le domaine de l’hygiène hospitalière, l’identica-
tion et le retrait éventuel des produits sanguins. Ces
mesures étant coûteuses en temps et en argent, l’OFSP
a besoin de diagnostics exacts et des déclarations des
médecins.
Correspondance:
Dr Simon Jung
Oberarzt Neurologie
Inselspital
Freiburgstrasse 1
CH-3010 Bern
Références recommandées
– Aguzzi A, O’Connor T. Protein aggregation diseases: Pathogenicity
and therapeutic perspectives. Nat Rev Drug Discov. 2010;9:237–48.
– Aguzzi A, Sigurdson C, Heikenwaelder M. Molecular mechanisms of
prion pathogenesis. Annu Rev Pathol. 2008;3:11–40.
– Ofce fédéral de la santé publique (OFSP), www.bag.admin.ch/k_m_
meldesystem/00733/00814/index.html?lang=fr.
– Brown P. Transmissible spongiform encephalopathy in the 21st century:
Neuroscience for the clinical neurologist. Neurology. 2008;70:713–22.
– Zerr I, Kallenberg K, Summers DM, Romero C, Taratuto A, et al.
Updated clinical diagnostic criteria for sporadic Creutzfeldt-Jakob
d isease. Brain. 2009;132:2659–68.
Vous trouverez la liste complète et numérotée des références dans la
version en ligne de cet article sous www.medicalforum.ch.
CME www.smf-cme.ch
1. Laquelle des afrmations suivantes est correcte?
A En Europe occidentale, les maladies à prions sont les
causes de démence les plus fréquentes après la ma-
ladie d’Alzheimer.
B La présence de la protéine 14-3-3 dans le liquide
céphalo-rachidien permet d’établir avec certitude le
diagnostic de maladie de Creutzfeldt-Jakob.
C Il faut obligatoirement déclarer toute suspicion cli-
nique d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob.
D Les prions sont des virus.
E La nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob observée en Suisse est la maladie à prions.
2. Parmi les vignettes cliniques suivantes, laquelle pré-
sente le plus haut degré de suspicion clinique d’une ma-
ladie de Creutzfeldt-Jakob?
A Patient de 82 ans présentant des troubles de la mé-
moire lentement progressifs depuis 5 ans.
B Patiente de 40 ans, fébrile, présentant des troubles de
la mémoire qui se sont installés en quelques heures.
C Patient de 65 ans, victime de chutes fréquentes et at-
teint de dysarthrie depuis 2 ans, sans trouble majeur
de la mémoire.
D Patiente de 62 ans présentant un trouble de la mé-
moire en nette progression depuis 2 mois, un trem-
blement d’action à prédominance droite, une apraxie
du membre supérieur droit, un trouble de la vue et
des symptômes pyramidaux.
E Patiente de 55 ans présentant un syndrome extrapy-
ramidal droit lentement progressif, une hypotension
orthostatique et un stridor inspiratoire, en l’absence
de limitations cognitives.
 6
6
1
/
6
100%