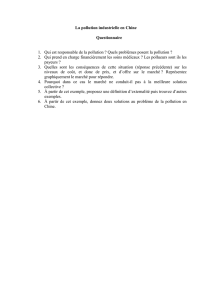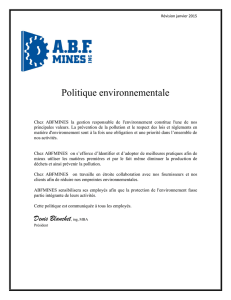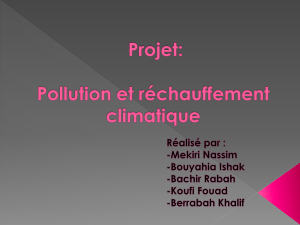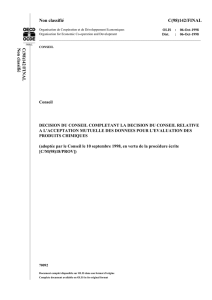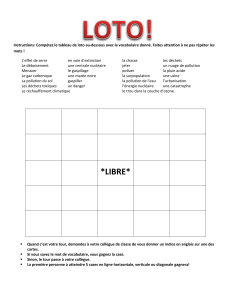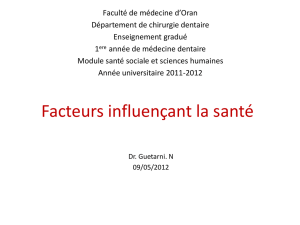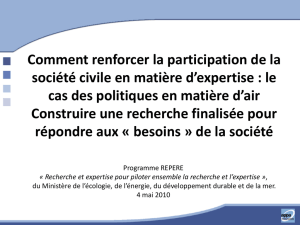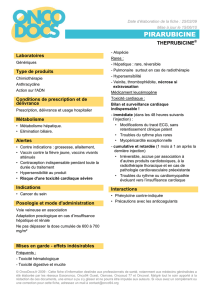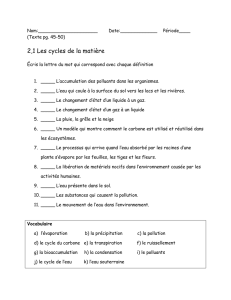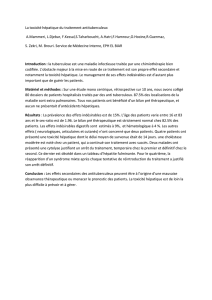Le cours de pollution des eaux ME1

1
CHAPITRE VI l’EAu : source de risques chimiques et biologiques
INTRODUCTION
La pollution chimique de l’eau peut être chronique, accidentelle ou diffuse. Elle a des origines
diverses dues à l’insuffisance de certaines STEP, l’absence de réseau d’assainissement dans certaines
zones, le lessivage des sols, des chaussées et des toits pas les pluies et le rejet d’effluents par les
industries.
I LES ELEMENTS MINERAUX MAJEURS
Souvent désignés sous le nom de sels minéraux, ils sont rencontrés en quantité notable dans
toutes les eaux. Leur toxicité est généralement très réduite mais il peuvent jouer un rôle écologique
important.
Elément minéral
Origine
Rôle biologique
Effet sur l’eau potable ou
sur l’homme
Limites en eau
potable
Calcium
Naturelle (dissolution
des roches)
Constitution des
squelettes et des
coquilles
Equilibre calco-carbonique
Phénomène de dureté et de
corrosion
Aucune
Magnésium
Naturelle (dissolution
des roches)
Industrielle (brasseries,
traitement de surface
…)
Respiration,
photosynthèse,
squelette de
certains
organismes
Saveur amère et effet
laxatif à forte
concentration
50 mg/L
Chlorures
Naturelle (dissolution
des roches), humaine
ou industrielle
Association Cl- et
Na+ sous forme de
NaCl donc facteur
écologique
important (facteur
de sélection)
Goût saumâtre et effet
laxatif
200mg/L
Sodium
Naturelle (dissolution
des roches), humaine
ou industrielle
150 mg/L
Sulfates
Naturelle (dissolution
des roches), agricole et
industrielle (papeteries,
…)
Composition
d’acides aminés
Goût, corrosion, diarrhées
infantiles à forte
concentration.
250 mg/L
Fer
Naturelle (dissolution
des roches),
industrielle et
domestique (lessivage
des dépôts d’ordures)
Photosynthèse,
respiration
Goût métallique et couleur
rouge
(Possibilité goût et odeur
de poisson pourri)
0,2 mg/L
Manganèse
Naturelle (dissolution
des roches),
industrielle
Goût et coloration noire
des eaux
50 mg/L
Ammonium
Pluies et neige, origine
biologique (réduction
des nitrates),
industrielle et agricole
Sel nutritif de
certains
organismes
Goût (formation des
chloramines)
0,5 mg/L
Nitrites
Naturelle, industrielle
(Chimie, colorants,
salaisons, …)
Sel nutritif de
certains
organismes
Hypotension et
méthémoglobinémie
0,1 mg/L
Nitrates
Naturelle (oxydation
biologique,
minéralisation de la
matière organique),
agricole, domestique
Sel nutritif de
certains
organismes
Méthémoglobinémie
50 mg/L
Phosphates
Naturelle et humaine
(contamination fécale,
détergents, engrais, …)
Sel nutritif, agent
de l’eutrophisation
Participation aux goûts et
odeurs, coloration,
turbidité et prolifération
des germes
5 mg/L en P2O5
Potassium
Naturelle (lessivage
roches)
Rôle métabolique
Toxicité par radioactivité
d’un isotope
12 mg/L
II LES DIFFERENTES SOURCES DE POLLUTION
Il en existe trois sortes :
les pollutions ponctuelles comme la pollution domestique avec les eaux usées urbaines, les
fosses septiques, les décharges de déchets et la pollution industrielle,
les pollutions diffuses comme la pollution atmosphérique,

2
la pollution agricole avec les déjections animales (engrais organiques) qui peuvent être en
plus sources de pollution ponctuelle, les engrais chimiques ou minéraux, sources de pollution diffuse.
III LES TOXIQUES MINERAUX ET LES OLIGO-ELEMENTS
Les oligo-éléments et les éléments traces sont toujours présents dans l’eau, dans des quantités
très faibles. Leur présence est généralement indispensable au développement des êtres vivants et leur
absence peut entraîner des carences. Ces éléments sont soumis à des normes pour leurs différentes
utilisations.
Le tableau suivant évoquent ces éléments traces et leur incidence sur les eaux potables :
Elément trace
Origine
Effet sur l’eau potable ou sur l’homme
Limites en eau
potable
Plomb (Pb)
Naturelle et humaine
(industries chimiques,
eaux de ruissellement)
Toxicité aiguë
Bioconcentration, saturnisme
50µg/L
Mercure (Hg)
Naturelle et humaine
Bioconcentration et bioaccumulation
Effets tératologiques et foetotoxiques
1µg/L
Cadmium (Cd)
Naturelle, industrielle et
agricole
Toxicité aiguë et bioaccumulation
Troubles rénaux, altérations osseuses
5 µg/L
Aluminium
Naturelle et industrielle
Peu d’effets toxiques Problèmes lors des
dialyses
200 µg/L
Baryum
Naturelle, industrielle et
agricole
Poison de la cellule musculaire, effets
génitaux et périnataux, lésions hépatiques
et rénales
Antimoine (Sb)
Industrielle
Toxicité aiguë
10 µg/L
Argent (Ag)
Industrielle
Toxicité aiguë et chronique
10 µg/L
Nickel (Ni)
Industrielle
Toxicité aiguë et effets cancérogènes
50 µg/L
Sélénium (Se)
Naturelle et industrielle
Troubles gastro-intestinaux
10 µg/L
Arsenic (As)
Naturelle et industrielle
Toxicité aiguë et bioconcentration
50 µg/L
Zinc (Zn)
Industrielle et agricole
Toxicité aiguë et bioconcentration
5 mg/L
Chrome (Cr)
Industrielle
Irritation cutanée, pouvoir oncogène et
mutagène
50 µg/L
Cuivre (Cu)
Naturelle et industrielle
Toxicité chronique
1 mg/L
Fluor (F)
Naturelle, industrielle et
domestique
Chute des dents, hypercalcification des os
1,5 mg/L
Bore (B)
Domestique
Irritations gastro-intestinales, effets
dermiques, rénaux et anémies.
Niveau guide :
1 mg/L
Cyanures (CN)
Industrielle
Toxicité aiguë, subaiguë ou chronique
50 µg/L
1) Notion de toxicité
A partir d’une certaine concentration, certains éléments contenus dans l’eau deviennent
toxiques par rapport aux êtres vivants présents dans l’eau.
Toxicologie : étude des substances provoquant l’altération des fonctions organiques.
a. Manifestation de la toxicité
Deux cas de figure :
Manifestation directe de la toxicité au niveau d’une espèce. On distingue alors :
la toxicité aiguë : mortalité violente de toute la population
la toxicité subaiguë : une proportion de la population subsiste
la toxicité chronique : toxicité apparaissant après une exposition à de faibles
doses ayant un effet cumulatif.
Accumulation tout au long d’une chaîne alimentaire, c’est la bioaccumulation.
L’apparition des effets toxiques se fait au niveau des éléments terminaux de la chaîne
trophiques.
b. Bases de la mesure de la toxicité
Les mesures de la toxicité aiguë sont les plus courantes. Dans l’eau, l’inhibition de la mobilité
est plus recherchée que l’effet létal. Ex : test daphnies mesurant la concentration immobilisant 50% de
la population des crustacés en 24 heures = CI50 – 24 heures.
c. Mode d’action des toxiques
Les toxiques provoquent chez l’homme et les mammifères des altérations regroupées en :
effets somatiques : altérations des fonctions végétatives comme la conduction
nerveuse. Il s’agit de neurotoxiques. Ex : insecticides agissant au niveau des zones de contact entre les
cellules nerveuses.

3
La fonction respiratoire peut aussi être affectée par l’arsenic et les cyanures qui sont des
inhibiteurs d’enzymes de la respiration cellulaire.
D’autres organes sont touchés, ceux responsables de fonctions détoxifiantes (foie, reins)
effet germinaux : altération des fonctions de reproduction ou de la descendance. Ex :
stérilisation, effets tératogènes.
effets cancérogènes : c’est la génotoxicité, définie comme l’action du toxique sur le
matériel génétique (effets mutagènes).
2) Fondements de l’écotoxicologie
L’écotoxicologie est la science qui étudie l’effet des substances toxiques sur les écosystèmes.
a. Les approches (pour réaliser une étude écotoxicologique)
♦Les tests biologiques ou bioessais
Ce sont des tests de laboratoire. Un test idéal est un test simple, rapide, sensible, reproductible
et représentatif. Le test idéal étant inexistant, plusieurs tests sont donc associés.
Il existe donc des test létaux, par exemple :
le test daphnies. C’est le plus utilisé notamment dans le calcul de toxicité des effluents
industriels (test immobilisant 50% de la population).
Il existe aussi des tests sublétaux, par exemple :
recherche de la concentration diminuant de moitié l’intensité lumineuse émise par des
bactéries marines luminescentes, on parle de CE50 (concentration efficace).
Enfin, il existe des tests chroniques.
Des mesures de bioaccumulation sont aussi entreprises. Enfin, il peut y avoir des tests
tératogènes sur des poissons. La plus forte concentration sans effet observable (CSEO) est ensuite
déterminée.
♦Les espèces indicatrices ou bioindicateurs
Les espèces benthiques sont souvent choisies. Parmi les bioindicateurs les plus utilisés il y a :
bactéries et champignons. ex : les microorganismes saprobiontes (vivants dans les milieux
riches en matière organique) recouvrent le fond de pellicules blanchâtres, flocons ou filamenteux
comme Zooglea ramigera.
les germes indicateurs de pollution fécale en eau douce ou côtière. ex : coliformes,
streptocoques, salmonelles …
les algues : comme les algues filamenteuses saprobiontes (ex : Spirulina jenneri une
cyanophycée). Il y a aussi les diatomées benthiques (indices diatomiques) sur les rivières. Dans cette
méthode, une note de polluosensibilité a été attribuée à chaque espèce.
les plantes : les bryophytes sont particulièrement intéressantes pour l’analyse des
micropolluants qu’elles concentrent. Les association de plantes supérieures des cours d’eau
renseignent sur l’état de la rivière (niveau trophique, turbidité).
les animaux : méthode basée sur l’étude du peuplement d’invertébrés benthiques (larves
d’insectes, crustacés, mollusques et vers). L’indice est déterminé par les groupes les plus sensibles
présents dans l’échantillon. Parmi les animaux, les oligochètes, sensibles à la présence de
micropolluants, aux conditions physico-chimiques et écologiques sont utilisés.
IV LES RISQUES BIOLOGIQUES : BACTERIES, VIRUS, PROTOZOAIRES ET METAZOAIRES
1) Principales bactéries recherchées dans les eaux
Les bactéries sont couramment recherchées dans les eaux, principalement comme témoins de
contamination fécale. Les bactéries peuvent être ubiquistes (on les rencontre fréquemment),
spécifiques (d’origine fécale stricte) ou résistantes (résistant longtemps dans le milieu extérieur).
Bactérie
Caractéristiques
Action sur l’homme
Exemple
Streptocoques
Streptocoques fécaux = témoins
de contamination fécale
Peu pathogènes
Enterococcus faecalis
Staphylocoques
Présence d’espèces pathogènes
Affections cutanées et
intoxications
Staphylococcus aureus
Coliformes
thermotolérants
Témoins de contamination
fécale
Gastro-entérites
Escherichia coli
Pseudomonas
Beaucoup de saprophytes, des
espèces pathogènes
Surinfections cutanées,
infections ORL
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium
Sporulation, témoins de
contamination fécale
Infections graves
Clostridum perfringens

4
c. Autres espèces pathogènes présentes dans l’eau mais non fréquemment recherchées
Leptospires : il existe des espèces pathogènes provoquant des problèmes hépatiques. Chiens et
rats en sont les porteurs. La leptospirose est très répandue dans le monde. Les leptospires sont
éliminées dans les urines et peuvent survivre dans la terre et l’eau. La contamination se fait par
absorption.
Vibrio cholérique : responsable des épidémies de choléra. Ce sont des germes extrêmement
pathogènes provoquant diarrhées et vomissement constants (la mort peut survenir après 48 à 72
heures).
Légionnelles : pouvoir pathogène avec développement de fièvres ou pneumopathies. Leur
multiplication se fait dans les eaux chaudes et la contamination par les aérosols.
2) Les principaux virus rencontrés dans l’eau
Les principaux virus pathogènes pour l’homme, rencontrés dans l’eau sont :
des entérovirus :
- agents des hépatites. Le virus de l’hépatite A peut être transmis par ingestion
d’eau ou d’aliments. Les hépatites sont des maladies graves parfois mortelles
(surtout dans les pays en voie de développement).
- agents de la poliomyélite ou poliovirus. La contamination se fait à partir de
l’eau (ou des aliments). Ces virus attaquent les centres nerveux entraînant de
incapacités motrices.
responsables de gastro-entérites, de diarrhées, de méningites.
les papillomavirus : responsables des verrues contractées dans les piscines. Il y a donc des
normes pour les eaux de baignade et d’AEP.
3) Les protozoaires pathogènes rencontrés dans les eaux
Dans les eaux douces, les amibes libres sont des parasites potentiels. Ce sont les parasites les
plus nombreux, les plus fréquents et les plus variés. Deux genres sont particulièrement importants :
Naegleria et Acanthamoeba peuvent être retrouvés dans tous les milieux.
Naegleria fowleri est toujours pathogène. Parmi les Acanthamoeba, deux espèces sont toujours
pathogènes. Ces espèces sont particulièrement répandues car elles ont une résistance élevée.
Les modes de contamination :
Acanthamoeba : trancutanée à l’occasion d’un microtraumatisme
Naegleria : contamination intra-pulmonaire à partir des voies respiratoires à
l’occasion d’un bain.
Dans tous les cas, les localisations cérébrales sont les plus souvent mortelles.
On peut aussi citer comme autre type de protozoaires Cryptosporidium (non amibe) qui est
responsable de diarrhées surtout chez les enfants. Ce protozoaire est transmis par l’eau et les aliments
souillés.
Certains parasites sont cosmopolites alors que d’autres sont strictement limités à des zones
géographiques déterminées du fait de leurs exigences : température, cycle à hôte intermédiaire.
Dans les pays fortement industriels, le plus fréquent est Giardia. Cette fréquence est due à la
présence de réservoirs de parasites animaux variés et répandus (rats, chiens, chats …). Les différentes
espèces connues contaminant l’homme sont retrouvées fréquemment dans les eaux de rivière et des
lacs et sont résistants aux traitements de chloration appliqués aux eaux d’alimentation.
4) Les métazoaires parasites des eaux
a. Le ténia
Ces vers peuvent contaminer les réseaux d’alimentation en EP par ruissellement des eaux
superficielles. Certains sont présents dans les eaux usées et dans les eaux douces.
b. Les bothriocéphales
Ce sont des parasites de l’intestin de l’homme et d’autres mammifères. Les œufs se
développent dans les eaux sous forme de larve. Le développement nécessite trois hôtes successifs : un
copépode (mollusque), un petit puis un gros poisson. L’hôte définitif est l’homme qui s’infecte en
mangeant la chair mal cuite (ou crue du poisson).

5
c. Les trématodes
Parmi eux on a les douves dont Fasciola hépatica (la grande douve), parasite du foie de
l’homme et des ruminants. Les œufs disséminés par les déjections du bétail se développent dans l’eau
sous forme de larves ciliées. Elles pénètrent dans un mollusque. Après transformation en cercaire
(larve à un stade différent), elle quitte le mollusque et se fixe sur les plantes. L’homme s’infecte en
mangeant cru du cresson sauvage.
Dans ce groupe, on a aussi les bilharzies. Les genres Schisostoma sont pathogènes. Les œufs
sont éliminés dans les urines ou les selles. Le cycle est identique à celui des douves. Les cercaires
pénètrent activement à travers la peau et se transforment en adulte à travers un parcours dans les
poumons et le foie.
V LES POLLUTIONS : ASPECTS GENERAUX
Une pollution résulte de l’introduction dans un milieu de substances conduisant à son
altération. Un rejet n’est donc polluant que s’il entraîne une dégradation du milieu récepteur.
3) Les différentes pollutions
a. La pollution domestique
Elle provient des habitations, véhiculée par le réseau d’assainissement jusqu’à la station
d’épuration. Elle se caractérise par des germes fécaux, de fortes teneurs en matière organique, des sels
minéraux (N, P) et des détergents. Grâce aux STEP, les quantités rejetées sont moindres (de 50 à 90%
retenues).
b. La pollution industrielle
Elle provient des usines et elle est d’une grande diversité. On y trouve : matières organiques et
graisses, hydrocarbures, métaux, acides, bases et produits chimiques divers, eaux chaudes, matières
radioactives.
c. La pollution agricole
Elle provient des cultures ou des exploitations. Elle est caractérisée par de fortes teneurs en
sels minéraux (N, P, K) provenant des engrais, des purins et lisiers et par la présence de produits
chimiques de traitement (pesticides et herbicides).
d. Phénomènes naturels
Divers phénomènes naturels peuvent être à l’origine de pollution (telle les irruptions
volcaniques par exemple).
4) Conséquences d’une pollution
a. Conséquences sanitaires
Par définition, ce sont les conséquences sur la santé d’une population humaine. Les
conséquences peuvent être liées à l’ingestion d’eau, de poissons ou par contact ave le milieu
aquatique. Les conséquences sanitaires d’une pollution sont variables dans le temps en fonction de
l’usage de l’eau. ex : la pollution d’une nappe non exploitée, n’a pas de conséquences sanitaires
immédiates mais longtemps après si la nappe est utilisée pour l’AEP.
b. Conséquences écologiques
Ici sont traitées les conséquences en rapport avec la dégradation du milieu. On mesure ces
conséquences en comparant l’état du milieu pollué par rapport à ce qu’il aurait été sans pollution
(réduction des potentialités d’exploitation du milieu).
c. Conséquences esthétiques
Prise en compte des pollutions n’ayant pas de conséquences sanitaires ou écologiques
importantes mais perturbant l’image du milieu. Ex : bouteilles ou sacs plastiques. Celles-ci constituent
les conséquences les plus perceptibles.
 6
6
1
/
6
100%