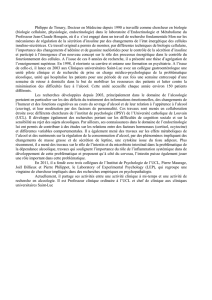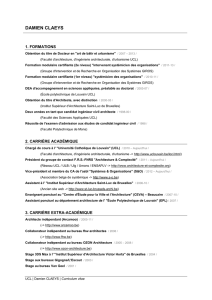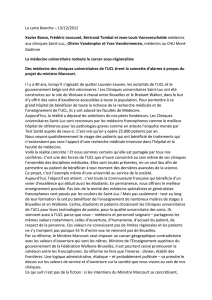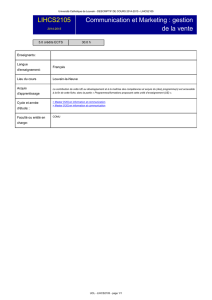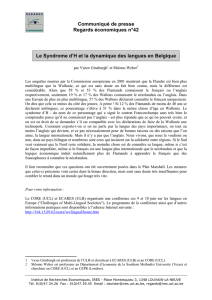Akkermansia, la bactérie qui pourrait soigner le diabète et l

Le 09 septembre 2016
Recherche UCL
Akkermansia, la bactérie qui pourrait soigner le diabète et l’obésité
Depuis 15 ans, le professeur Patrice Cani (UCL) et son équipe étudient les interactions existantes entre les
bactéries de l’intestin (appelé le microbiote intestin) et nos organes.
Environ 18 % de la population belge souffre d’obésité, première cause de développement du diabète et des
maladies cardiovasculaires. Soit un demi-million de pré-diabétiques et plus de 3 millions de personnes avec un
syndrome métabolique (taux élevé de glycémie, hypercholestérolémie, hypertension artérielle et surpoids). Les
personnes présentant un syndrome métabolique ont deux fois plus de risque de souffrir d’une affection
cardiaque et cinq fois plus de risque de développer un diabète de type 2. Des chiffres interpellant qui ont donc incité
Patrice Cani, investigateur du WELBIO à l’UCL, chercheur qualifié FNRS et professeur au Louvain Drug Research
Institute de l’UCL, à rechercher et comprendre les causes de ce phénomène afin de proposer un traitement
efficace. Et si une des solutions s’appelait Akkermansia muciniphila ?
C’est en 2007 que l’équipe de recherche UCL découvre, presque par hasard ( !), cette bactérie appelée
Akkermansia muciniphila. Ce qu’ils observent ? L’ingestion de prébiotiques, des substances non digérées utilisées
par certaines bactéries de nos intestins et qui exercent un effet positif sur l’obésité et le diabète, sont associés à
l’augmentation de la bactérie !. Cette bactérie a la particularité d’être naturellement présente dans l’intestin d’une
grande partie de la population.
En 2013, l’équipe a démontré chez la souris, que l’administration de cette bactérie pouvait fortement diminuer le
développement de l’obésité et des facteurs de risques cardiovasculaires associés. « En étudiant des souris
obèses et diabétiques de type 2, nous avons constaté avec le Dr Amandine Everard qu’Akkermansia était capable de
réduire le poids corporel et le diabète, de renforcer la barrière intestinale et de diminuer la graisse dans le foie ». Mais
passer de l’animal à l’homme n’est pas simple. Le défi a été lancé et relevé, grâce à la collaboration fructueuse
entre le Prof. de Vos (Université de Wageningen) et le Prof. Cani.
Du coup, en décembre 2015, Patrice Cani lance une étude d’intervention, en collaboration avec les Cliniques
universitaires Saint-Luc, afin d’évaluer les effets d’un traitement expérimental, à savoir l’administration de cette
bactérie, sur les facteurs de risques cardiovasculaires associés à l’obésité. Cette étude expérimentale est une
première mondiale ! Si ces expériences sont concluantes et encourageantes sur des souris de laboratoire, en sera-t-
il de même pour l’homme ? C’est précisément pour répondre à cette question que l’étude clinique est en route, en
collaboration avec le service d’endocrinologie et de nutrition des Cliniques universitaires Saint-Luc (Prof J-P Thissen,
Prof. M. Hermans, Prof. D. Maiter, Dr A. Loumaye).
Aujourd’hui, un projet de spin-off co-dirigé par le Dr Céline Druart est en cours de finalisation, afin de produire et
de commercialiser des thérapies liées au microbiote intestinal et à Akkermansia. Mais surtout, de faire profiter
le plus grand nombre de ces découvertes. C’est donc une véritable équipe qui s’est mise en place autour de cette
découverte UCL avec l’aide de la Sopartec (société de transfert de technologie et d'investissement de l’UCL) et de
parrains tels que Jean Stéphenne (ex-CEO GSK) et Jean-François Pollet (CEO et fondateur de Novadip).
Les recherches de Patrice Cani et son équipe n’auraient jamais vu le jour sans une série de financements : le Fonds
Baillet Latour, la Fondation Saint-Luc, le programme First spin-off de la Région wallonne, un POC ERC de
l’European Research Council, premier projet du genre attribué en FWB.
Les coordinateurs du projet recherchent des volontaires souffrant de ce type de pathologie afin de participer à l’étude clinique.
Les participants doivent cependant répondre à une série de critères très précis. Le descriptif complet des profils recherchés est
disponible sur le site internet créé à l’occasion de cette recherche clinique : www.microbes4u.be.
Qui ? Patrice Cani, professeur au Louvain Drug Research Institute de l’UCL : 02 764 73 97
1
/
1
100%