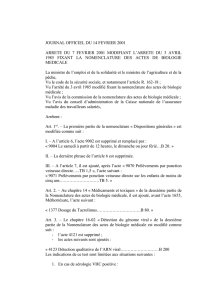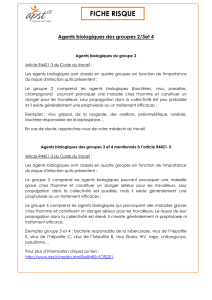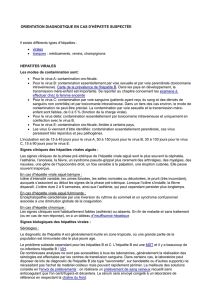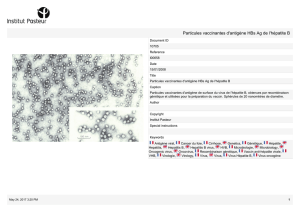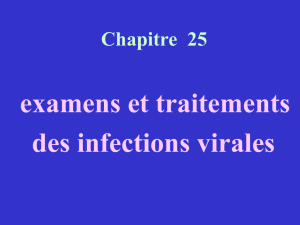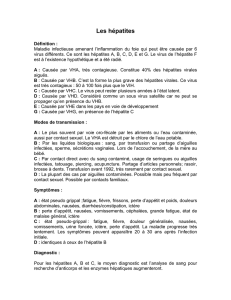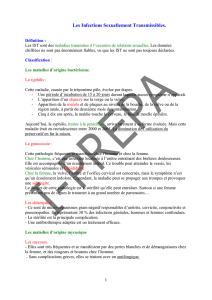Hépatites d`origine virale des Léporidés: introduction et

Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1991, 10 (2), 269-282
Hépatites d'origine virale
des Léporidés:
introduction et hypothèses étiologiques
J.-P.
MORISSE, G. LE GALL et E. BOILLETOT *
Résumé: En moins de dix ans, deux affections hépatiques virales très graves
se sont répandues chez les Léporidés (lapins et lièvres) dans de très nombreux
pays. Au mois de mai 1989, l'Office International des Epizooties a attribué à
la première de ces nouvelles affections, la dénomination de «maladie
hémorragique virale du lapin», avec inscription sur la Liste B du Code zoo-
sanitaire international. Cette maladie est cliniquement très proche du «syndrome
du lièvre brun européen». Cependant, de nombreuses inconnues subsistent sur
la nature exacte des virus du lapin et du lièvre car, bien qu'apparentés, ces virus
semblent différents et la transmission croisée entre espèces fait actuellement
l'objet de résultats contradictoires.
Malgré la mise en évidence récente de leur étiologie virale, les hépatites des
Léporidés sévissent probablement depuis plusieurs années en Europe ; elles
existent sous une forme clinique chez le lièvre en Europe du Nord depuis 1980
environ et sous une forme inapparente (ou ignorée) depuis 1975 chez le lapin
en Tchécoslovaquie. Ces maladies des Léporidés sont de véritables hépatites
virales et elles présentent avec certaines hépatites virales humaines (B et non-A
non-B),
sous leur forme fulminante, des ressemblances frappantes pour ce qui
concerne la clinique, les lésions anatomopathologiques et le mode de
transmission.
La contamination par voie fécale-orale, prédominante pour les hépatites A
et E, expliquerait aussi, dans le cas des animaux, la vulnérabilité toute particulière
des petits élevages fermiers, seuls utilisateurs de fourrages potentiellement
contaminés.
La diversité des virus (ARN et ADN) responsables, chez l'homme, d'hépatites
graves, permet de s'interroger sur la possibilité d'une étiologie également multiple
chez les Léporidés.
Bien qu'aucune transmission à l'homme n'ait été observée, même chez les
populations en contact avec le virus animal, les ressemblances entre hépatites
des Léporidés et hépatites virales humaines, justifieraient l'instauration d'une
concertation avec les milieux médicaux spécialisés.
MOTS-CLÉS : Epidémiologie - Hépatite E - Hépatites fulminantes - Hépatites
virales non-A non-B - Maladie hémorragique virale du lapin - Pathogénie -
Syndrome du lièvre brun européen.
* Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires, B.P. 53, 22440 Ploufragan, France.

270
GÉNÉRALITÉS
Le développement de la cuniculture au cours des vingt dernières années a entraîné,
du fait de l'intensification des techniques d'élevage, une augmentation de la fréquence
et de la gravité des affections respiratoires et digestives. L'étiologie de ces deux
syndromes a fait l'objet de recherches bactériologiques d'autant plus nombreuses que
le rôle exact des bactéries mises en évidence (pasteurelles, colibacilles, clostridies) est
souvent indissociable de celui des conditions d'environnement des animaux
(claustration, alimentation, hyperproductivité).
Bien que de nombreux virus aient été isolés chez le lapin, surtout lors de contrôles
réalisés chez les animaux de laboratoire, la virologie a longtemps été axée sur l'étude
de la seule maladie économiquement importante et dont l'étiologie virale soit
indiscutable : la myxomatose.
La mise en évidence en République populaire de Chine, en 1984 (16, 27, 34) d'une
maladie hémorragique virale (ou pneumonie hémorragique virale) à évolution
foudroyante a marqué un tournant dans l'étude de la pathologie du lapin (Oryctolagus
cuniculus).
C'est seulement en 1988 que le rapprochement a été fait entre cette maladie et
une affection cliniquement identique apparue sur le continent européen : d'abord
dans le sud de l'Italie en 1986 puis dans d'autres pays européens, ainsi qu'en Afrique
(Egypte et Tunisie) et même en Amérique (Mexique).
La nature hémorragique des lésions, l'atteinte hépatique massive, l'origine
apparemment alimentaire des troubles, ont été interprétées d'emblée, comme autant
d'éléments orientant vers une étiologie toxique. Cette hypothèse reprise et amplifiée
par les média a été présentée comme le résultat d'une pollution de l'environnement,
ce qui était un défi à la logique puisque seuls les lapins semblaient sensibles aux
toxiques (3, 5, 21).
Dans certains pays, comme l'Italie, une campagne de presse, attribuant l'origine
du problème aux retombées radioactives de Tchernobyl, a été à l'origine d'un véritable
désastre économique pour les éleveurs.
Enfin, les observations épidémiologiques et virologiques, jointes aux études
anatomopathologiques, ont clairement démontré l'origine infectieuse et plus
particulièrement virale de cette hépatite nécrotique primaire, secondairement
responsable de troubles de la coagulation (14, 15, 19, 21, 23, 33).
Au mois de mai 1989, l'Office International des Epizooties donnait à cette affection
l'appellation de «maladie hémorragique virale du lapin» et, en anglais, de viral
haemorrhagic disease (VHD), avec inscription sur la Liste B du Code zoo-sanitaire
international.
Si les particules virales sont facilement mises en évidence au niveau des hépatocytes,
leur adaptation en milieu cellulaire a longtemps été un échec, aussi la culture réussie
par des chercheurs chinois (notamment C.-Y. Ji) et rapportée dans le présent ouvrage
par W.-Y. Xu et H.-B. Huang fait-elle figure de première mondiale. Auparavant,
faute de pouvoir obtenir ce virus par culture, ses caractéristiques ont été étudiées sur
des broyats de foie, avec des résultats souvent discordants, suivant les auteurs : virus

271
ADN de type parvovirus pour certains (6, 10, 34) ou virus ARN de type calicivirus
pour d'autres (13, 23, 24).
Cette ambiguïté persiste, à moins que (hypothèse développée ultérieurement) nous
ne soyons en présence de deux virus différents s'exprimant cliniquement de façon
peu ou pas différenciée.
Depuis 1985 (et sans doute depuis plusieurs années), une autre espèce animale
appartenant au même ordre des Léporidés, le lièvre (Lepus europaeus et Lepus
timidus),
subit également de lourdes pertes dans plusieurs pays d'Europe du Nord
et de l'Ouest (8, 11, 17, 18).
Cette affection, connue en français sous le nom de «syndrome du lièvre brun
européen» et, en anglais, d'European brown hare syndrome (EBHS), présente les
mêmes caractéristiques lésionnelles que la VHD et, tout comme chez le lapin,
différentes étiologies toxiques ont été d'abord envisagées : ingestion de
mercaptodimethur (hélicide largement utilisé sur les cultures betteravières) ou
consommation exagérée de colza de variété «O.O».
Une origine bactérienne a également été suspectée par suite de l'isolement assez
fréquent de Clostridium sordellii sur les cadavres (17).
Après 1988, la mise en évidence relativement aisée au niveau hépatique de particules
virales morphologiquement identiques à celles de la VHD chez le lapin, jointe à la
similitude des lésions anatomopathologiques, ont incité certains chercheurs à proposer
pour les deux syndromes une appellation unique : «hépatite nécrotique infectieuse
des Léporidés» (19).
Pour la suite de l'exposé et compte tenu des recherches en cours, les appellations
VHD et EBHS seront utilisées respectivement pour le lapin et pour le lièvre.
EXTENSION GÉOGRAPHIQUE
Signalée pour la première fois en 1984 en République populaire de Chine et en
République de Corée, la VHD du lapin est observée sur quatre continents dans de
très nombreux pays (Tableau I).
Dans le cas particulier de la France, les premiers cas d'EBHS ont été observés
en 1985 (17, 18) et les premiers cas de VHD en juillet 1988 (21) ; depuis cette date,
la diffusion des deux maladies a été suivie grâce à un réseau d'épidémio-surveillance
reposant sur les informations recueillies auprès des laboratoires de diagnostics
départementaux répartis sur l'ensemble du territoire français. Les diagnostics
essentiellement nécropsiques font l'objet, pour partie, d'un contrôle virologique [test
d'hémagglutination (HAT), immuno-électromicroscopie, immunofluorescence] réalisé
par le Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires (15).
Ces renseignements permettent de connaître l'extension des affections, mais il est
impossible d'en évaluer la prévalence en raison du faible pourcentage de cas faisant
l'objet d'une demande de diagnostic. La Figure 1 montre la surperposition sur les
mêmes secteurs géographiques de la VHD sur lapins domestiques et sauvages et de
l'EBHS chez le lièvre.

272
TABLEAU I
Liste des pays ayant signalé la présence
des hépatites d'origine virale chez les Léporidés
ORIGINE ET MODE DE TRANSMISSION DE LA VHD ET DE L'EBHS
Origine
Si la VHD du lapin sous sa forme clinique a été observée pour la première fois
en République populaire de Chine et en République de Corée en 1984, il n'est pas
évident que le virus soit d'origine asiatique.
Des contrôles réalisés en Tchécoslovaquie sur des sérums conservés depuis 1975
et montrant la présence d'anticorps anti-VHDV sur un pourcentage élevé d'animaux
(Rodák, article dans le présent ouvrage) attestent que l'infection devait nécessairement
exister dès cette époque, soit sous une forme inapparente, soit sous une forme subaiguë
qui aurait pu passer inaperçue. Cette présence très précoce du virus sur le continent
Pays VHD EBHS
Asie
République populaire de Chine 1984
République de Corée 1984
Europe
Allemagne 1989 1987
Autriche 1989 1986
Belgique 1989 1985?
Danemark 1990 1982-1983
Espagne 1988
France 1988 1985-1986
Grande-Bretagne 1991
Grèce 1990 1988
Hongrie 1987
Italie 1986 1985-1986
Malte 1990 1989
Pologne 1989
Portugal 1988
Roumanie 1989
Suède 1980-1984
Suisse 1988
Tchécoslovaquie 1987
URSS 1986-1987?
Yougoslavie 1989
Afrique et Océan Indien
Egypte 1988
Liban 1989
Ile de la Réunion 1989
Tunisie 1989
Amérique
Mexique 1988

273
FIG. 1
Répartition de la VHD et de l'EBHS
sur le territoire français en 1990
Nombre de foyers répertoriés en 1990:
• lapins domestiques 570 VHD
A lapins sauvages 216 VHD
O lièvres 406 EBHS
Source: Réseau de Surveillance VHD-EBHS, CNEVA, Ploufragan, France.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%