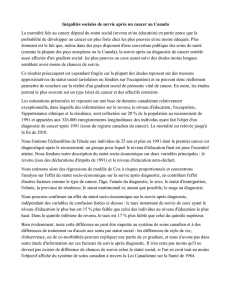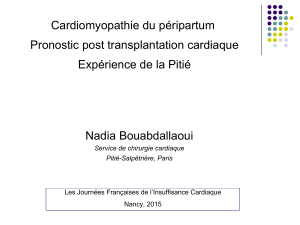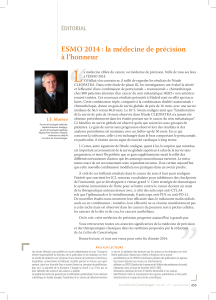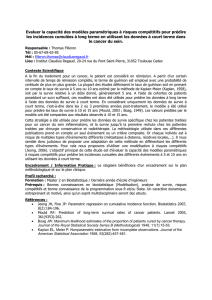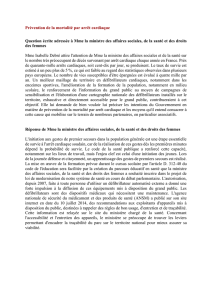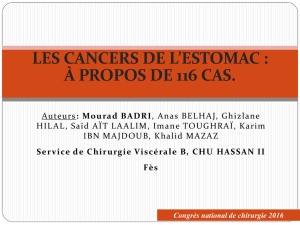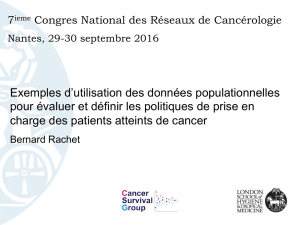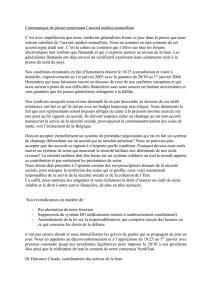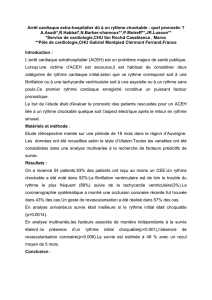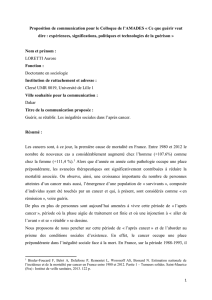(Dr BROHEE.pub \(Lecture\240seule\))

Article de synthèse
RMC-2011 4
1
GLOSSAIRE ET COMMENTAIRES
Dany BROHEE
Chef de service Oncologie Hématologie
CHU de Charleroi - site de Vésale
INTRODUCTION
Q
ue ce soit dans le New England Journal of Medicine, le Lancet ou une
autre revue d'investigation clinique, beaucoup ou quasi tous les articles don-
nent des résultats en terme de survie, terme générique non limité à la notion
de mort mais plus généralement à la survenue d'évènements en fonction du
temps .
L
e présent article se veut faire un inventaire de toutes les expressions
associées à la notion de survie.
L
a cancérologie a une part dominante dans le présent article et les com-
mentaires sont développés là où la littérature médicale abonde.
C
OMMENT SURVIVRE

Article de synthèse
RMC-2011 4
2
L
a forme la plus élémentaire, mais la plus robuste, consiste à énumérer les patients
survivants ou morts , ou ayant ou n’ayant pas développé l’évènement d’intérêt de l’ étu-
de, à l’échéance d’un temps donné. Ceci implique que tous les patients ont été suivis
pendant la période d’intérêt. Le temps total de l’étude comprend en plus du temps d’ob-
servation, le temps d’accrétion des patients, par ex 6 ans peuvent avoir été nécessaires
pour inclure 100 patients et 5 ans nécessaires pour connaître l’issue du dernier patient
inclus. Le résultat est exprimé généralement sous forme de pourcentage.
Cette expression des résultats, robuste, ne permet pas une vision dynamique des
évènements : est-ce que les décès (ou autres évènements) sont survenus d’un seul coup
ou par à coups ou sont-ils survenus plus ou moins régulièrement au cours du temps
Que faire des patients « perdus de vue »
L’expression des résultats est binaire. De façon conservatrice, il est indiqué pour
des longues durées d’observation de considérer les patients disparus comme décédés
ou ayant présenté l’évènement les rendant incapables d’être revus en suivi.
SURVIE BRUTE
Quelles autres méthodes
N
otre époque ne veut ne plus laisser le temps au temps, et veut avoir
des prédictions rapidement crédibles, « avoir des résultats » le plus tôt
possible. Les sondages foisonnent avant les élections et les probabilités
avant les faits. Idem en médecine.
D
’autres méthodes d’analyse et expression de la survie ont vu le jour,
pour avoir une vue dynamique de la survenue des évènements au cours
du temps, pour réduire le temps d’observation et estimer un pourcentage
de survie avant terme avant l’échéance brute.

Article de synthèse
RMC-2011 4
3
L
e temps de survie n’est pas une variable continue et infinie. Le temps espéré de sur-
vie finit à la limite de vie maximale de l’espèce humaine (notre horloge s’arrête à environ
120 ans) . La fin n’est pas brutale mais suit une courbe rapidement descendante à partir
de 65 ans suivant la loi de GOMPERTZ où la pression de mort s’accroit avec le temps
jusqu’à la limite de vie humaine. Plus on avance en âge, plus les chances de décéder
augmentent. La courbe de mortalité naturelle devient abrupte entre 60 et 80 ans. En co-
rollaire, avec le vieillissement, le gain de survie espéré avec un traitement de maladie
déterminée devient de plus en plus ténu.
L
a finitude de la vie doit être prise en considération quand on analyse les résultats thé-
rapeutiques sur les pathologies les plus tueuses comme le cancer et les maladies cardio-
vasculaires dont les fréquences augmentent exponentiellement après 60 ans. Avec l’âge,
les gains de survie espérés s’amenuisent et deviennent marginaux. Un gain de survie
pour cause déterminée est alors un bénéfice marginal qui demande de grands moyens et
de grands effectifs de patients pour le démontrer. En statistique, il existe une relation in-
verse entre le nombre à observer et l'amplitude de la différence mesurée dite
« significative ».
L
a mortalité , paramètre on ne peut plus binaire, peut se voir exprimée en terme de
décès spécifiques à la maladie étudiée et de décès d’autres causes (« les morts gué-
ris »). Cette façon de procéder permet d’isoler la « substantifique moelle » de la maladie
étudiée et ignorer le reste des pathologies concomitantes létales. Le problème est la va-
lidation des causes réelles de décès sans autopsie systématique, et même en cas d’au-
topsie, d’être certain de la cause de la mort. Il est souvent difficile de savoir si les au-
teurs dans leurs articles parlent de survie globale ou de survie spécifique quand ils an-
noncent les réductions de mortalité en pourcentage. Retenons que plus le pourcentage
est élevé, plus il y a de chance qu’il s’agisse de mortalité spécifique.
SURVIE ET FINITUDE
Guérir devient une notion relative: repousser la mort
pour cause spécifique au-delà de l'espérance de vie

Article de synthèse
RMC-2011 4
4
C
e concept est développé pour des populations, calculé soit à la naissance ou à un
âge donné, soit pour toute la population ou un sous-groupe (sexe, classe d'âge,...). C'est
typiquement une donnée actuarielle. L'espérance de vie s'exprime soit en années
(médiane de survie: 50% mourront avant le terme et 50% après ), soit en probabilité de
décès dans la décade suivante. Par ex, aux USA (données de 2004), l'espérance de vie
pour les blancs, était à la naissance de 78,3 ans, à 65 ans de 18,7 ans (65+18,7= 83,7
ans), à 75 ans de 11,9 ans (75+11,9= 86,9 ans). Les personnes ayant atteint un âge don-
né ont échappé aux « premières » causes de mort, leur espérance de vie diminue, mais
au total l'âge médian prévisible de décès augmente. Pour un américain de 70 ans, la
probabilité à 70 ans de mourir dans la décennie suivante est de 37% pour un homme et
26 % pour une femme. A 90 ans, 93% pour un homme et 88% pour une femme (table de
Graunt, année 2002). La différence homme/femme diminue quand on approche de l'âge
limite de vie.
L
'espérance de vie est très dépendante des conditions sanitaires des populations et
ne peut-être généralisée à l'ensemble des pays , riches ou en voie de développement.
Les espérances de vie calculées pour une année donnée seront changées quelques an-
nées plus tard.
S
i la quantité de vie ne peut être infiniment augmentée, le paramètre de survie d’inté-
rêt devrait être la qualité de vie restante. Comme pour l’arlésienne, on en parle beau-
coup, mais peu ont vu des études où la qualité de vie était un objectif primaire, avec un
end-point quantitatif bien défini et un design de puissance suffisante. La notion de qualité
de vie est compliquée car très dépendante de la personne interrogée: les malades se
considèrent presque toujours en meilleur état de santé que celui relaté par les proches
ou le personnel de santé.
C
ette façon d'appréhender la survie vient des gériatres. Il a été calculé aux USA en
1991 que 43% des patients âgés de 65 ans séjourneraient dans une maison de soins
avant leur décès. Ce paramètre n'est jamais utilisé pour un patient donné, mais devrait
être connu pour des choix sociétaux d'allocation des ressources en soins de santé .
ESPERANCE DE VIE
SURVIE ET QUALITÉ DE VIE
SURVIE SANS ETRE INSTITUTIONNALISE

Article de synthèse
RMC-2011 4
5
C
ette notion est nouvelle. Le sexe a toujours été tabou de par différents interdits reli-
gieux. La libération intellectuelle de l'être humain dans nos pays développés permet de
considérer cet aspect de la vie comme un critère de qualité. Les progrès sont lents, KIN-
SEY dans les années 50 a publié les premières statistiques comportementales, MAS-
TERS et JOHNSON dans les années 60 ont propulsé le sexe dans la physiologie expéri-
mentale, ZWANG dans les années 70, a développé en France le concept de fonction
érotique, à l'instar des autres fonctions fondamentales vue, goût, audition, tact, odorat.
Les premières données de « survie » apparaissent. Pour la population US, l'espérance
de vie sexuelle active est à l'âge de 55 ans, de 15 ans pour l'homme et 10,6 ans pour la
femme. L'état de santé joue un rôle majeur, avec des différences de 5 ans en moyenne
entre les plus sains et les plus débilités. Ce paramètre n'a pas encore été intégré dans
les objectifs thérapeutiques.
L
a méthode intéresse des grandes cohortes suivies dans le temps. Cette approche
donne une vision dynamique des évènements. La survie est exprimée à différents inter-
valles de temps arrêtés ; il n’y a plus une seule échéance finale, mais différentes échéan-
ces où les évènements sont comptabilisés. L’analyse de la courbe permet de voir si les
évènements surviennent progressivement, s’ils surviennent précocement puis se stabili-
sent, s’ils surviennent tardivement mais alors rapidement.
L
’inconvénient de la méthode est son besoin de grands effectifs et les échéances tem-
porelles. Les cas perdus entre deux échéances sont comptabilisés pour moitié, en consi-
dérant que les disparitions ont autant de chance de survenir dans la première moitié de
l'intervalle de temps que dans la seconde. Pour de grands effectifs et des survies lon-
gues, l'hypothèse est raisonnable.
La méthode est typiquement utilisée pour les statistiques de régions, de pays, de conti-
nent, ..
SURVIE SEXUELLEMENT ACTIVE
SURVIE ACTUARIELLE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%