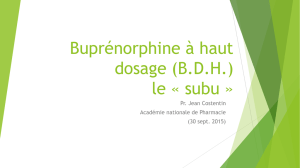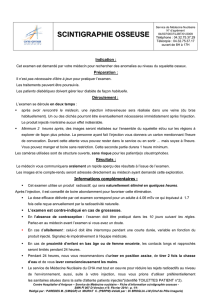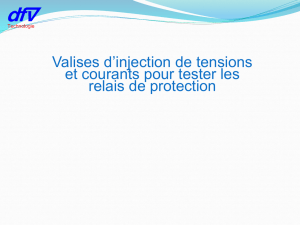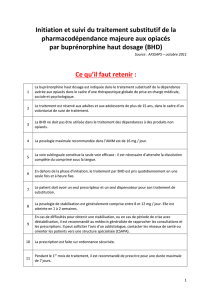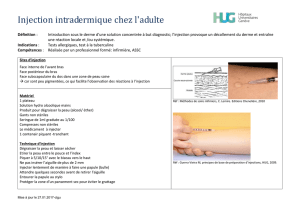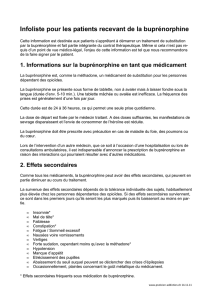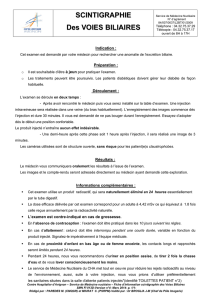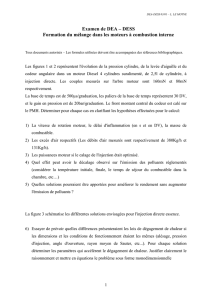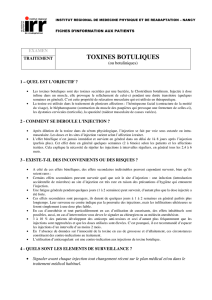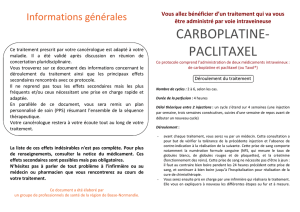Complications infectieuses induites par le mésusage de la buprÃ

La Revue de médecine interne 31 (2010) 188–193
Article original
Complications infectieuses induites par le mésusage de la buprénorphine
haut dosage (Subutex®) : analyse rétrospective de 42 observations
Infectious adverse events related to misuse of high-dose buprenorphine:
A retrospective study of 42 cases
D. Graua, N. Vidala, V. Faucherreb, Y. Léglisec, V. Pinzania,
J.-P. Blayaca, J. Reynesd, H. Peyrièrea,∗
aService de pharmacologie médicale et toxicologie, hôpital Lapeyronie, centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance (CEIP),
CHU de Montpellier, 191, avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier cedex 5, France
bService de médecine interne A, hôpital Saint-Éloi, CHU de Montpellier, 34295 Montpellier, France
cUnité de traitement des toxicodépendances, hôpital La-Colombière, CHU de Montpellier, 34295 Montpellier, France
dService des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Gui-de-Chauliac, CHU de Montpellier, 34295 Montpellier, France
Disponible sur Internet le 6 janvier 2010
Résumé
Propos. – Le mésusage de la buprénorphine haut dosage (BHD), principalement par injection, est à l’origine de complications, notamment
infectieuses.
Méthodes. – Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les complications infectieuses observées chez des patients injecteurs de BHD.
Quarante-deux dossiers ont été recensés (29 hommes et dix femmes) et les données ont été recueillies entre mars 1999 et décembre 2008.
Résultats. – Les complications infectieuses rapportées étaient des infections cutanées (27 cas), des endocardites infectieuses (neuf cas), des
infections ostéoarticulaires (quatre spondylodiscites, une sacroiliite) et une embolie vasculaire avec baisse de l’acuité visuelle.
Conclusion. – Si en France le bilan des traitements de substitution par la BHD est positif compte tenu du nombre de patients traités, la possibilité
d’injecter ce médicament peut être à l’origine de complications infectieuses graves et souligne l’importance d’une implication plus adaptée des
professionnels prenant en charge les toxicomanes substitués.
© 2009 Société nationale française de médecine interne (SNFMI). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Buprénorphine ; Mésusage ; Injection ; Complications infectieuses ; Endocardite
Abstract
Purpose. – Misuse of high-dose buprenorphine (HDB), mainly by injection, is responsible of frequent infectious adverse events.
Methods. – This is a retrospective study of infectious complications occurring in patients using HDB by injection. Forty-two cases were identified
(29 men and ten women) and the data were collected between March 1999 and December 2008.
Results. – The infectious complications included cutaneous infections (27 cases), endocarditis (nine cases), osteoarticular infections (four
spondylodiscitis and one sacroiliitis), and a vascular embolism with decrease in visual acuity.
Conclusion. – The results of HDB maintenance treatment must be improved, both from the point of view of substitution and to limit its misuse
by intravenous route injection. Health professionals have to play an important role in drug addict patients’ education and supervision, to prevent
buprenorphine injection and related infectious complications.
© 2009 Société nationale française de médecine interne (SNFMI). Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Buprenorphine; Infectious diseases; Misuse; Injection; Endocarditis
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : h-peyriere@chu-montpellier.fr (H. Peyrière).
1. Introduction
La buprénorphine haut dosage (BHD), commercialisée
en France depuis 1996 sous le nom de Subutex®, est un
0248-8663/$ – see front matter © 2009 Société nationale française de médecine interne (SNFMI). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.revmed.2009.10.433

D. Grau et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 188–193 189
agoniste–antagoniste des récepteurs morphiniques, indiqué dans
le traitement substitutif des pharmacodépendances aux opiacés
[1]. Son action d’agoniste partiel limite les effets dépresseurs
respiratoires observés plus fréquemment avec les agonistes
morphiniques. C’est en partie en raison de cette apparente sécu-
rité pharmacologique que la prescription se fait de fac¸on peu
contraignante sans qu’un système spécifique d’évaluation et de
surveillance ait été mis en place.
Selon un rapport de 2004 de l’Observatoire franc¸ais des
drogues et des toxicomanies (OFDT), la BHD serait injectée
par 11 % des personnes sous protocole médical et par 54 % des
personnes l’utilisant sans prescription [2]. Plus récemment, les
résultats de l’enquête Oppidum d’octobre 2008 indiquent que la
buprénorphine est injectée par 9 % des patients sous protocole
traités par Subutex®, 5 % des patients sous protocole traités par
buprénorphine générique et par 18 % des patients recevant de la
buprénorphine hors protocole [3].
Cette pratique limite l’impact des traitements de substitution
sur la réduction des pratiques d’injection, mais a surtout des
conséquences sanitaires préoccupantes locorégionales (abcès,
lymphœdèmes, nécroses...) et systémiques (contaminations
virales, candidoses systémiques...). Son utilisation détour-
née par certaines personnes en association à d’autres produits
(benzodiazépines, alcool...) est à l’origine de surdosages poten-
tiellement mortels [2].
L’objectif de cette étude est l’analyse rétrospective des
complications infectieuses observées chez des patients toxico-
manes à la suite du mésusage de la buprénorphine par voie
intraveineuse.
2. Patients et méthodes
Il s’agit d’une enquête rétrospective incluant les patients
ayant présenté des complications infectieuses liées à l’injection
de BHD et qui ont été pris en charge dans différents services du
Centre hospitalier universitaire de Montpellier. Ces cas ont été
notifiés au Centre d’évaluation et d’information de la pharmaco-
dépendance (CEIP) du Languedoc-Roussillon par des médecins
spécialistes dans la prise en charge des patients toxicomanes,
sur une période de 1999 à fin 2008. En effet, selon les articles
R. 5219-1 à R. 5219-15 du code de la santé publique, les pro-
fessionnels de santé doivent obligatoirement déclarer au CEIP
de leur région les cas de pharmacodépendance grave ou d’abus
grave d’une substance, plante, médicament ou tout autre produit
ayant un effet psychoactif, à l’exception de l’alcool et du tabac
[4].
Le mésusage est une utilisation non conforme aux recomman-
dations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à
l’article R.5128, à l’exclusion de l’usage abusif [5]. Cette défi-
nition englobe deux notions différentes, d’une part, la notion
d’utilisation avec indication « hors autorisation de mise sur le
marché (AMM) » ne s’intégrant pas dans une démarche thé-
rapeutique et, d’autre part, la notion d’utilisation erronée, ne
respectant pas les recommandations liées aux modes de prises
du traitement.
Les données suivantes ont été recueillies : âge, sexe, type
de toxicomanie, présence ou non de produits associés à
la buprénorphine, motif d’hospitalisation, présence ou non
de pathologies associées, suivi du traitement sous BHD,
complications infectieuses ainsi que l’agent bactérien respon-
sable, et enfin traitement et évolution de ces complications. Le
mode d’obtention de la buprénorphine (prescription médicale ou
non) a également été noté lorsque l’information était disponible.
3. Résultats
3.1. Description de la population étudiée
3.1.1. Démographie
Cette étude recense 39 patients, 29 hommes et dix femmes,
d’âge moyen de 31 ans (extrêmes 22–43). Certains patients ont
eu plusieurs infections.
3.1.2. Antécédents et histoire de la toxicomanie
Les patients déclaraient avoir antérieurement consommé
diverses substances : cannabis, morphiniques (héroïne, codéine),
cocaïne, ecstasy et autres, avant de s’injecter la BHD. Pour
deux d’entre eux, les produits consommés avant la buprénor-
phine n’étaient pas précisés. Vingt-sept d’entre eux pratiquaient
des injections d’héroïne parmi lesquels, quatre, avaient présenté
des abcès cutanés liés à l’injection. L’âge moyen à la première
injection était de 20,5 ans (extrêmes 16–29).
L’origine de l’obtention de la BHD est renseignée pour
20 patients : 16 patients l’avaient obtenue au travers d’une pres-
cription médicale, alors que quatre l’avaient achetée dans la
rue.
Trente-huit patients déclaraient injecter la BHD par voie
intraveineuse (i.v.) et un patient par voie intramusculaire (i.m.).
3.1.3. Co-morbidités
La présence de maladies associées ou de co-morbidités n’était
rapportée que pour 20 patients : dépression (deux fois), hépatite
C (11 fois), hépatite virale sans précision (une fois), hépatite B
(une fois), VIH (une fois), co-infection VIH–VHC (une fois), co-
infection VIH–VHB (une fois), co-infection VHC–VHB (deux
fois).
3.1.4. Polyconsommations
Vingt-deux patients (55 %) rapportaient la consommation de
substances, en association à la BHD, que ce soit dans le cadre
de protocoles thérapeutiques ou de la toxicomanie. Ainsi, huit
patients avaient une polytoxicomanie active : un patient déclarait
s’injecter de l’héroïne, deux patients consommaient du cannabis
dont un avec injections occasionnelles de cocaïne par voie intra-
veineuse et cinq patients consommaient d’autres drogues (non
précisées). Sept patients déclaraient consommer de l’alcool et
huit patients des benzodiazépines.
3.2. Complications infectieuses
Dans cette étude, les complications infectieuses observées
étaient localisées ou systémiques, les deux types d’infection
pouvant coexister chez un même patient.

190 D. Grau et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 188–193
Tableau 1
Infections systémiques recensées après injection intraveineuse de buprénorphine chez 15 patients.
NoAnnée de
survenue
Âge/sexe Motif de
consultation
Pathologies
associées
ATCD Obtention
BHD
Complications
infectieuses
Bactériologie Traitement Évolution
Endocardites
1 2001 31/M Infection cutanée VHC Injection
héroïne : abcès
Prescription
médicale
Endocardite,
emboles septiques
(cérébraux et
spléniques)
ND Augmentin®Favorable
2 2002 42/M AEG fébrile VHB, VHC Injection
héroïne
Prescription
médicale
Endocardite
aortique
ND Clamoxyl®,
remplacement valve
aortique
Favorable
3 2002 32/M Choc septique
avec embolie
pulmonaire
massive
ND ND ND Endocardite
tricuspidienne
Streptococcus puis
levure avec doute
sur un SAMS
surajouté
Vancomycine®,
Triflucan®,
tricuspidectomie
partielle
Favorable
4 2003 29/M AEG, fièvre ND Injection
héroïne,
cocaïne, alcool
Prescription
médicale
Endocardite
tricuspidienne
(2 épisodes)
SA Bristopen®,
Gentalline®, puis
Oflocet®, Rifadine®
Favorable
méthadone
5 2005 35/M Fièvre, douleur
thoracique
VHC Injection
héroïne, alcool
ND Endocardite
tricuspidienne,
pneumopathie
bilatérale abcédée
avec épanchement
pleural, embole
septique, arthrite
sternoclaviculaire
SAMS Oflocet®, Dalacine®,
Bristopen®,
Vancomycine®
Favorable,
insuffisance
tricuspide
méthadone
6 2005 26/M AEG, fièvre, toux,
douleur thoracique
VIH, VHC Injection
héroïne
Rue Endocardite
tricuspidienne,
abcès pulmonaire
et pyothorax,
ostéomyélite, choc
septique, abcès
fesse
SAMS Bristopen®,
Gentalline®, drainage
chirurgical, puis
Augmentin®,
Oflocet®
Favorable, fuite
tricuspide
méthadone
7 2006 43/F AEG fébrile VHC Injection
héroïne, alcool
ND Ulcération
cutanée,
endocardite,
embole septique,
« syndrome de
Popeye »
SAMS Vancomycine®,
Gentalline®,
Rocéphine®, puis
Bristopen®,
Gentalline®
ND
8 2006 28/F Détresse
respiratoire aiguë,
sepsis sévère ;
infection cutanée
TS, dépression Codéïne, BDZ Endocardite
tricuspidienne,
abcès jambes
SAMS Bristopen®
Gentalline®,
végectomie
tricuspidienne
ND
9 2008 25/M Fièvre, douleur
thoracique
Injection
cocaïne,
cannabis
Rue Endocardite
tricuspidienne,
embolie
pulmonaire, abcès
pulmonaire
SAMS Vancocine®,
Orbenine®,
Gentalline®,
végectomie
tricuspidienne
Favorable
méthadone

D. Grau et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 188–193 191
Tableau 1 (Continued )
NoAnnée de
survenue
Âge/sexe Motif de
consultation
Pathologies
associées
ATCD Obtention
BHD
Complications
infectieuses
Bactériologie Traitement Évolution
Spondylodiscite
10 2002 25/M Syndrome
rachidien avec
raideur
ND Cannabis,
cocaïne ;
injection
héroïne
Prescription
médicale
Spondylodiscite
L3–L4
ND Triflucan®, Dalacine®Favorable
11 2003 33/F Lombalgies VHC injection
cocaïne
Spondylodiscite Streptococcus
gordinii
Bristopen®,
Rifadine®, puis
Dalacine®, Oflocet®,
Favorable
méthadone
12 2007 M/36 Spondylodiscite Dépression Ecstasy,
cocaïne,
héroïne
Prescription
médicale
Spondylodiscite Klebsiella oxytoca Bactrim®, Ciflox®Favorable
méthadone
13 2007 F/42 Lombalgies Héroïne Prescription
médicale
Spondylodiscite Staphylococcus
coagulase
négative MS
Oflocet®, Bactrim®Favorable
méthadone
Sacroiliite
14 2003 26/M AEG, douleur
fesse
ND Injection
héroïne,
cannabis,
alcool
ND Sacroiliite SA Bristopen®, Ciflox®Favorable
méthadone
Autre
15 2003 37/M Baisse acuité
visuelle ; infection
cutanée
VHC Injection
héroïne
Prescription
médicale
Abcès pouce,
embolie
vasculaire :
hémorragie
rétinienne
Enterobacter
cloacae
Vancomycine®, puis
Ciflox®PO
Favorable
BHD : buprénorphine haute dose ; ATCD : antécédents ; AEG : altération de l’état général ; ND : non documenté ; BDZ : benzodiazépines ; SA : Staphylococus aureus ; SAMS : Staphylococus aureus méticilline
sensible ; MS : méticilline sensible ; VHB : virus de l’hépatite B ; VHC : virus de l’hépatite C ; p.o. : par voie orale ; TS : tentative d’autolyse.

192 D. Grau et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 188–193
3.2.1. Infections cutanées
Vingt-sept cas d’infections cutanées ont été rapportés, repré-
sentant 64,3 % de la totalité des complications infectieuses
observées. Vingt-quatre de ces patients avaient consulté en rai-
son de la présence de manifestations cutanées. Les trois restants
présentaient une altération de l’état général avec fièvre à leur
arrivée à l’hôpital.
Parmi ces complications, les abcès étaient les plus fréquents
et concernaient 23 patients ; ils étaient localisés au bras ou à
l’avant-bras dans 55 % des cas. Ces abcès étaient associés à
une lymphangite (deux cas), un phlegmon (un cas) et une fol-
liculite (un cas). L’injection intramusculaire de buprénorphine
dans la fesse chez un patient était à l’origine d’un abcès fis-
tulisé au point d’injection. Enfin, un cas d’ulcérations (pieds
et mains), deux cas de tuméfaction des pouces et du poi-
gnet, et un phlegmon palmaire ont été observés. Dans trois
observations, ces abcès étaient associés à une complication
infectieuse systémique. L’identification bactérienne était obte-
nue pour trois seulement de ces infections cutanées : la présence
de streptocoques a été identifiée dans deux abcès (bras et
fesse) et Staphylococcus aureus était mis en évidence dans
un abcès de la jambe chez un patient ayant une endocardite
(Tableau 1).
Huit patients présentant des abcès étaient traités par
Augmentin®(amoxicilline–acide clavulanique) et six par
Pyostacine®(pristinamycine). Des interventions chirurgicales
(trois greffes de peau, trois drainages chirurgicaux, une apo-
névrotomie, une incision et une intervention chirurgicale non
précisée) ont été pratiquées, seules ou en association avec
une antibiothérapie, et un traitement antiseptique (Bétadine®,
Hexomédine®, pansement alcoolisé) était également été utilisé
chez cinq patients.
3.2.2. Infections systémiques
Quinze patients (38,5 %) présentaient une atteinte systé-
mique : neuf cas d’endocardite infectieuse, quatre cas de
spondylodiscite infectieuse, un cas de sacroiliite et un cas
d’hémorragie rétinienne secondaire à une embolie vascu-
laire avec baisse de l’acuité visuelle. Dans trois cas, les
infections systémiques étaient associées à des abcès cutanés
(Tableau 1). Pour huit patients ayant présenté une infec-
tion systémique, le traitement de substitution aux opiacés
était orienté vers l’entrée dans un programme métha-
done.
Les neuf observations d’endocardite infectieuse représentent
60 % des infections générales. La localisation tricuspidienne
est dominante (six endocardites tricuspidiennes, une aor-
tique et deux de localisation non précisée). Chez 55 % des
patients ayant eu une endocardite, une complication sep-
tique était associée : emboles septiques chez deux patients,
atteinte pulmonaire chez trois autres patients. Les agents
microbiens incriminés dans ces endocardites étaient Sta-
phylococcus aureus (sept fois), streptocoque (une fois) et
des levures (une fois). Une observation réalisait une infec-
tion plurimicrobienne à streptocoque et à Staphylococcus
aureus.
4. Discussion
La prévalence du mésusage de buprénorphine par voie intra-
veineuse est élevée, alors qu’elle a été longtemps sous-estimée.
Selon des études franc¸aises, 32 % et 47 % des patients inclus
rapportaient s’être injecté de la buprénorphine par voie intravei-
neuse après initiation du traitement [6,7]. L’injection demeure
le mode d’administration le plus fréquemment rapporté quand
la buprénorphine est détournée de son usage thérapeutique.
Elle permet la conservation d’un rituel de prise que beaucoup
d’anciens héroïnomanes ne parviennent pas à abandonner.
Les facteurs associés à l’injection de buprénorphine ont été
recherchés dans plusieurs études avec des résultats contradic-
toires. Ainsi, la co-morbidité psychiatrique, et en premier lieu la
dépression, est associée à l’injection de buprénorphine dans cer-
taines études [6,8,9] mais pas dans d’autres [10]. Dans l’étude
Subgeo, le fractionnement des prises de buprénorphine était
associé à l’injection [8]. Dans d’autres travaux, l’impulsivité [9],
ainsi que l’injection antérieure d’autres substances que la bupré-
norphine [7,9] étaient des facteurs de risque d’injection de BHD.
Enfin, dans une étude récente, la sévérité de la dépendance, la
perception d’un dosage inadéquat de buprénorphine et la pré-
sence d’idées suicidaires/tentatives de suicide ont été associées
à un risque plus élevé d’injection de buprénorphine [6]. Dans
notre étude, la majorité des « injecteurs » de buprénorphine était
de sexe masculin (75 %), à rapprocher des 77,2 % d’hommes
dans les enquêtes menées en France [7]. Dans l’étude de Roux et
al., les hommes représentaient 67 % des injecteurs ; néanmoins,
le sexe n’était pas statistiquement associé à l’injection [8].
L’injection de buprénorphine peut être à l’origine d’infections
locorégionales ou systémiques, mais aussi d’hépatite ou du
« syndrome de Popeye » [11,12]. Les infections cutanées consti-
tuent l’une des complications majeures chez les injecteurs de
buprénorphine. Plus de la moitié des patients présentent des
abcès cutanés, de localisation variée, principalement au niveau
des bras et des avant-bras, à proximité du site de l’injection. Pour
ce qui est des abcès, il est difficile de les attribuer en totalité à
une cause infectieuse. Ils peuvent, en effet, également parfois
résulter d’un mécanisme de chimiotoxicité. Les composés du
Subutex®(amidon de maïs, stéarate de magnésium) sont pour
la plupart insolubles ; ils épaississent la solution en cas de dilu-
tion et semblent être dommageables pour le système vasculaire
en cas d’injections répétées. Ce sont les injections, en l’absence
de précautions d’asepsie, qui sont à l’origine des complications
infectieuses que l’on observe chez le patient toxicomane. La sub-
stance injectée est rarement directement responsable ; la flore du
patient, le liquide de dissolution (eau, salive, jus de citron) ou
l’aiguille (utilisée à plusieurs reprises, échangée, humectée avec
la salive) sont à l’origine de l’infection [13,14].
L’injection intraveineuse de BHD est ainsi à l’origine d’une
grande variété d’infections systémiques, souvent aggravées par
le statut immunitaire du patient. L’étude de Chai et al. rap-
porte qu’en 2005, 14 des 77 patients hospitalisés à l’hôpital
universitaire de Singapour pour une complication infectieuse à
Staphylococcus aureus sensible à la méthicilline, s’injectaient de
la buprénorphine. Ces patients étaient jeunes (moyenne 31,9 ans)
et plus souvent des hommes. Dans cette étude, 11 patients avaient
 6
6
1
/
6
100%