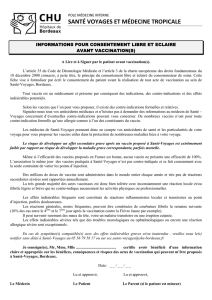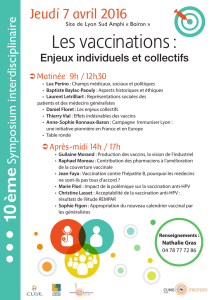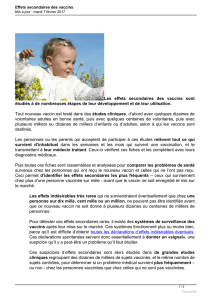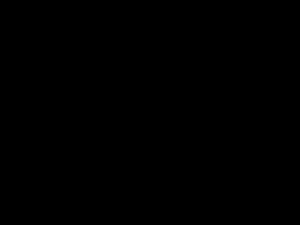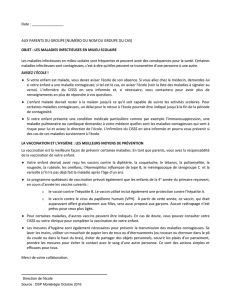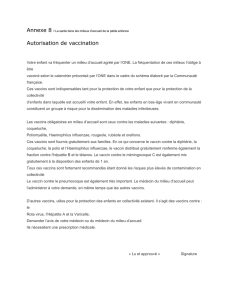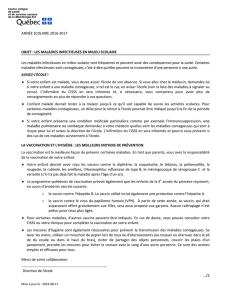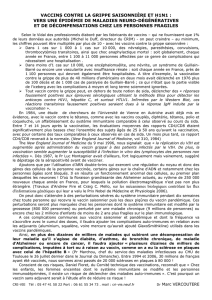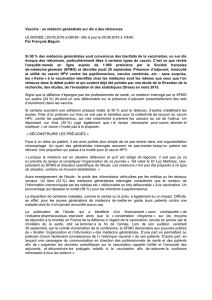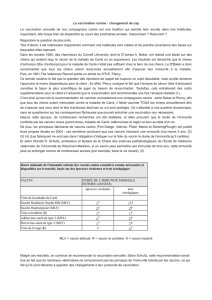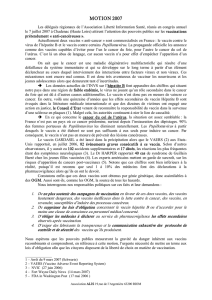Principales vaccinations des volailles et programmes

Ecocongo • 1
Agriculture
Principales vaccinations des volailles
et programmes
Mots clés : volaille, poules, poulet de chair, maladies, vaccination, prévention
Explications des mécanismes naturels de défense contre les maladies infectieuses et analyse de la vaccination : objectifs,
voie d’administration, chronométrage, calendrier, réactions post-vaccales, combinaisons…
La vaccination permet de baisser l’incidence des maladies sur un élevage en augmentant la résistance spécique
des volailles.
Auteur(s) : Alain Huart et collaborateurs
Date de publication : 2004
Catégorie(s) : Élevage et pêche
Province(s) : Kinshasa • Bandundu • Équateur • Province Orientale • Nord-Kivu • Sud-Kivu •
Maniema • Katanga • Kasaï-Oriental • Kasaï-Occidental • Bas-Congo
Partenaire(s) : Centre agronomique et Vétérinaire tropical de Kinshasa
Nombre de pages : 3
Identication : F-EP-A5-10
Programmes de vaccination
1. RAPPEL DES CONCEPTS ET PRINCIPES
Il existe plusieurs méthodes ou conduites sus-
ceptibles de limiter l’entrée de maladies dans
un élevage. Une première possibilité, c’est
de réduire la pression ou charge infectieuse
(nombre d’agents pathogènes dans l’environ-
nement). Ceci peut être réalisé en améliorant
les conditions d’hygiène générale de la ferme.
Une autre pratique susceptible de baisser
l’incidence des maladies c’est d’augmenter
la résistance spécique des volailles par la
vaccination.
Pour mieux comprendre le mode d’action
d’un vaccin, nous devrions d’abord apprendre
les mécanismes naturels de défense contre
les maladies infectieuses. La résistance ou
défense d’un animal contre les agents patho-
gènes peut être subdivisée en :
• La résistance passive ou « première ligne
de défense ».
• La résistance spécique, « deuxième front
de défense » ou immunité.
Ces deux modalités sont naturellement
déterminées par les facteurs génétiques
(race, souche), l’âge, le niveau ou l’étape
de production et les conditions générales de
l’animal.
1.1. La résistance non-spécique
Le premier front de défense est constitué de
barrières naturelles.
• La peau : protection mécanique par les
plumes et les cellules épidermiques kéra-
tinisées à forte capacité de regénération
(ou réparation).
• Les muqueuses (épithélium non kératinisé
composé d’une ou plusieurs couches de cel-
lules). Il s’agit notamment de la muqueuse
conjonctive de l’œil, la muqueuse res-
piratoire (poumons et sacs aériens),
la muqueuse digestive (du bec au cloaque),
de la muqueuse urogénitale (oviducte, uté-
rus et conduit vaginal).
• Le proventricule succenturié : Le proven-
tricule est une importante barrière pour
les agents pathogènes ingérés par la voie
digestive. Le PH très bas (degré très élevé
d’acidité) est le résultat de l’acide hydro-
chlorique (HCl) élaboré par les glandes du
gésier. Il tue pratiquement tous les virus et
bactéries contenus dans les aliments et eau
de boisson. Seules les formes larvaires et les
oocystes de la coccidiose peuvent résister
dans ce milieu à PH bas.
• L’exclusion compétitive ou résistance de
colonisation
La résistance par colonisation est offerte
par la ore bactérienne qui protège la peau
et les muqueuses contre les agents patho-
gènes. Elle est aussi appelée « exclusion
compétitive car dans la lutte pour l’occupa-
tion de la surface des muqueuses ce sont les
bactéries pathogènes qui sont perdantes. Le
mode d’action n’est pas seulement méca-
nique (colonisation par occupation spatiale
mais aussi chimique par l’acidication du
milieu).
Les poussins fraîchement éclos ne dis-
posent pas de cette ore de protection. Ils
devraient normalement la recevoir de leur
mère. Force est donc d’administrer cette
ore de démarrage au couvoir juste à l’éclo-
sion. Plus tard l’administration se fera par
l’eau de boisson.
• La défense cellulaire
Les leucocytes (ou globules blancs) de dif-
férentes formes et tailles (neutrophiles et
macrophages) sont présents dans le sang,
sous la peau, les muqueuses et différents
tissus, prêts à neutraliser les agents patho-

2 • Ecocongo
Agriculture
gènes qui traversent les barrières natu-
relles.
Ces globules blancs agissent de façon non
spéciques et tenteront d’éliminer tout
pathogène par la phagocytose. D’autres
cellules sanguines, les lymphocytes, procè-
dent tout autrement vs-à-vis de pathogènes
spécifiques. La « résistance spécifique »
d’un animal dépend de son « immunité » ou
seconde ligne de défense.
1.2. Immunité ou seconde ligne
de défense
1.2.1. Introduction
L’immunité est un mécanisme de défense
spécique, ceci veut dire que quand un ani-
mal a acquis un niveau de résistance contre
un agent pathogène donné, par exemple le
virus de la maladie de la pseudo peste aviaire,
cette immunité ne pourra pas inactiver
d’autres pathogènes, par exemple le virus de
la maladie de Gumboro. La fulgurante histoire
de la vaccination a ainsi commencé en 1796
par Dr Jenner (GB) qui le premier découvrit le
vaccin contre la variole humaine au départ de
la variante bovin (vaccinia). A sa suite, Pasteur
(FR) développera le vaccin contre le choléra
aviaire, le charbon et la rage.
1.2.2. Les antigènes
C’est une structure ou substance chimique ou
encore une particule étrangère à l’organisme.
Ils peuvent être des agents pathogènes (virus,
bactéries, moisissure, protozoaire, parasites)
des toxines produites par ces agents ; des
nutriments (lacto-globulines), des organes et
cellules étrangers et enn des médicaments
(provaquant des réactions allergiques).
Seuls les agents pathogènes et leurs toxines
nous intéressent quand il s’agit d’immunité.
Les déterminants antigéniques peuvent être
l’ADN, l’ARN, la membrane cellulaire , les
cellules enzymatiques ou des protéines…du
même agent pathogène prvoquant ainsi une
réponse immunitaire (formation d’anticorps)
spécique au déterminant. Un agent peut
donc développer plusieurs variantes appelées
sérotypes.
1.2.3. Les lymphocytes
En pathologie aviaire, on distingue deux types
de lymphocytes : les lymphocytes T et les lym-
phocytes B tous deux produits par la mœlle
osseuse. De la mœlle, certains lymphocytes
migrent vers le Thymus et deviennent « les
de production liées à la maladie clinique.
Par exemple le coryza ou le choléra aviaire.
• Prévention des effets des formes subclini-
ques des maladies. Prévenir les pertes de
productions et frais en produits vétérinaires
liées aux infections secondaires.
Exemple : augmentation de la susceptibi-
lité aux maladies opportunistes causée par
l’immuno-suppression dans la maladie de
Gumboro.
2.2. Éléments du programme
de vaccination
Les trois éléments de base d’un programme de
vaccination sont : la souche vaccinale, le chro-
nométrage de l’opération et la voie d’admi-
nistration. Les autres aspects du programme
concernent la fréquence des vaccinations:
opération unique (encéphalomyelite aviaire)
ou opération multiple avec primo vaccination
et rappels (PPA, Gumboro), faisant intervenir
plusieurs souches (gumboro forte, Bursine 2,
BI H120 et Bi H52…
La primovaccination prépare l’organisme au
rappel avec une souche généralement plus
immunogénique, plus invasive (tel le cas de
la PPA avec la souche Hb1 et le rappel avec
la souche lasota). Le rappel produit comme
nous l’avons dit un effet potentialisateur du
premier vaccin aussi appelé « effet booster ».
Le pouvoir immunogénique varie selon la voie
d’administration. Pour illustration, nous don-
nons l’exemple du vaccin contre la bronchite
infectieuse.
Type ou souche
Degré immunogénique
Voie d’administration
Séquences et chronométrage
des opérations de vaccination
• Pour la Bronchite et la PPA, respecter un
intervalle de 2 semaines minimum entre
deux vaccinations et 4 semaines entre la
deuxième vaccination et la troisième.
cellules T », les autres passent par la Bourse
de Fabricius et deviennent « les cellules B ».
Par la suite les cellules B et T migrent vers les
organes lymphoïdes (rate, glande de Harder,
mœlle osseuse, paroi intestinale). Ces cel-
lules se transforment en véritables « cellules
mémoires » responsables du fameux « effet
booster » lors des vaccinations de rappel.
Les macrophages jouent un rôle déterminant
dans la réponse immunitaire. La séquence des
actions se présente comme suit : présentation
de l’antigène aux cellules T et B ; activation
des ces dernières ; phagocytose et ingestion
des pathogènes ; réparation tissulaire, sécré-
tion des différentes substances (interleukins)
pour stimuler ou supprimer les réactions
immunitaires etc.
L’interféron est une glycoprotéine produite
directement par les cellules corporelles juste
après l’infection. L’interféron quittera la cel-
lule pour protéger les cellules voisines contre
l’infection seulement pour une très courte
période (approximativement une semaine).
C’est pourquoi, il n’est pas recommandé
d’administrer deux vaccins vivants dans un
court intervalle de temps (jours).
1.2.4. Anticorps
Ce sont des protéines appartenant au groupe
des globulines et ainsi appelées immunoglo-
bulines (Ig) classées selon leur poids molé-
culaire, leur structure et leur fonction : on
distingue ainsi :
IgG : présente dans le sang, et le vitellus.
IgA : responsable de l’immunité locale, pré-
sente dans les muqueuses.
IgM : 5 x la taille des IgG, apparaissent rapide-
ment dans le sérum sanguin juste après
l’infection ou la vaccination et dispa-
raissent aussi rapidement.
1.2.5. Immunité passive et immunité
active
Les anticorps que nous trouvons dans le sang
proviennent ou sont transmises soit passive-
ment par la mère à travers le vitellus (c’est
l’immunité maternelle), soit par la vaccina-
tion (immunité active), soit à la suite d’une
infection récente (immunité active).
2. IMMUNISATION ACTIVE OU VACCINATION
2.1. Objectifs
• Prévention des maladies : prévenir et maî-
triser la morbidité, la mortalité, les pertes

Ecocongo • 3
Agriculture
• Prévoir au moins 4 semaines entre l’admi-
nistration du dernier vaccin vivant et un
vaccin inactivé (PPA, Gumboro, Réovirus,
Bronchite) et un intervalle de 8 semaines est
recommandable avant la vaccination contre
la BI avec une souche inactivée.
• Prévoir 30 à 60 jours pour les vaccinations
contre PPA et la bronchite pour les poulettes
de ponte.
• Éviter de donner dans un intervalle rap-
proché les vaccins AE (encephalomye-
lite), BI (Bronchite infectieuse), LTI
(Laryngotrachéite), choléra souche vivante
ou MG (mycoplasma) souche vivante comme
ces vaccins se développent sur la muqueuse
respiratoire. (Interférence et très forte
réaction vaccinale).
• Le vaccin contre l’encephalomyelite ne peut
être donné aux poulettes futures pondeuses
avant l’âge de 6 semaines et au plus tard
4 semaines avant le début de ponte.
• Les vaccins bactériens inactivés contre la
mycoplasmose, le choléra et coryza aviaire
peuvent être admninistrés à partir de 4 à 6
semaines et au plus tard 4 semaines avant
le début de ponte.
• Respecter une période d’attente de 7 jours
après la distribution des antibiotiques dans
l’eau de boisson ou dans l’aliment et avant
l’administration des vaccins bactériens
vivants (choléra, MG, coryza).
• Le vaccin contre la maladie de Marek doit
être administré au couvoir en dose entière
unique le premier jour.
Séquence et chronométrage
en rapport avec l’immunité
maternelle
Les poules parentales reçoivent des vaccins
vivants et inactivés dans le but de remonter
les niveaux d’anticorps circulants qui seront
transférés aux poussins éclos. Ces anticorps
maternels protègent naturellement le jeune
poussin mais peuvent interférer avec les vac-
cins vivants. Ce problème est bien illustré
par la vaccination contre gumboro. Dans les
régions exposées aux souches sauvages, pour
prévenir les atteintes précoces, il est recom-
mandé de vacciner le plus tôt possible en
tenant compte du niveau de rémanence des
anticorps maternels qui tombe généralement
entre les 2 à 3 premières semaines.
Il n’existe plus d’immunité pour éviter la
maladie lorsqu’elle résulte d’une contami-
nation tardive, après la 3e et la 4e semaine
d’âge. Or, c’est justement entre la 4e et la 7e
semaine que les conséquences de l’infection
virale sont les plus dangereuses.
Réactions post vaccinales
On distingue deux types de réactions post vac-
cinales. Le premier type de réaction survient
après inoculation d’un vaccin inactivé suite
à une mauvaise manipulation. Par exemple
une injection tout près de la tête ou dans le
cou peut provoquer une inammation sur le
site d’injection, inammation de la tête et
parfois un retournement du cou. Certains vac-
cins bactériens (MG,Coryza, Pastereula) ont
tendance à provoquer une forte réaction tis-
sulaire à cause de la présence d’endotoxines.
Un matériel de vaccination contaminé par les
bactéries peut aussi provoquer des inam-
mations sévères et la formation d’abcès. Le
deuxième type de réaction survient à la suite
d’une administration d’un vaccin vivant au
contact de la muqueuse respiratoire causant
des signes cliniques d’une pathologie des voies
respiratoires supérieures les 3 à 4 jours sui-
vant la vaccination... (larmoiement, écoule-
ment nasal, inammation de la face, jetage
et balancement de la tête).
En règle générale, les erreurs d’administra-
tion et de manipulation de vaccins suivants
peuvent provoquer des réactions plus ou
moins sévères :
1. Nébulisation très ne.
2. Vaccination d’un lot positif au test de myco-
plasmose.
3. Vaccination de lots malades ou en état
d’immunosuppression.
4. L’usage d’une souche vaccinale trop forte
pour l’âge du troupeau.
5. Long intervalle entre les premières vaccina-
tions et les vaccinations de rappel.
6. Faible niveau technique d’exécution aban-
donnant de nombreux poussins non vacci-
nés.
7. Vaccin vivant se répandant dans des lots
d’âges multiples.
8. Atmosphère surchargée en ammoniac et
poussières (lésions de la muqueuse nasale
et trachéale).
Combinaisons de vaccins
(vaccins polyvalents)
Le calendrier de vaccination de poulettes
futures pondeuses est généralement très
long et son exécution très fastidieuse pour
de grands effectifs. Pour faciliter l’adminis-
tration et minimiser le stress, on recourt sou-
vent aux combinaisons de vaccins. Il existe
plusieurs combinaisons de vaccins vivants
Newcastle-Bronchite-Gumboro (PPA-IB-IBD)
ou encore Encephalomyelite et variolo diphte-
rie (AE –Pox) ceci à cause de la ressemblance
des vaccins, du calendrier et des voies d’admi-
nistration.
Dans les lots de pondeuses commerciales, on
connaît beaucoup de combinaisons de vac-
cins inactivés : Mycoplasma gallisepticum MG,
mycoplasma synoviae MS, Vaccin EDS 76 contre
la chute de ponte, Newcastle et bronchite
infectieuse. Dans les lots de poules paren-
tales, on recommandera les combinaisons
suivantes Gumboro, Newcastle, Bronchite et
REO. Il est par ailleurs recommandé, toujours
dans le souci de diminuer la charge de stress
sur les poules, d’associer l’administration
d’un vaccin polyvalent à diverses autres mani-
pulations telles que débecquage, comptage ou
le transfert (changement de bâtiment).
Vaccins vivants vs vaccins
inactivés : programmes
On distingue deux types de programmes de
vaccination pour les poules en ponte. Le pre-
mier recourt aux vaccins vivants donnés à
30-90 jours d’intervalle, le second recourt aux
vaccins inactivés donnés juste avant le début
de la ponte et aucun vaccin vivant durant la
période de ponte.
Dr César BISIMWA
1
/
3
100%